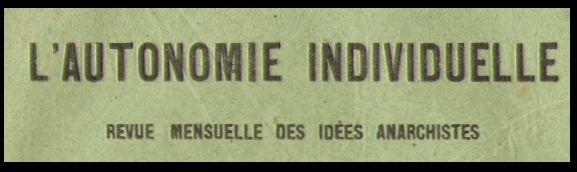L’homme ressent des besoins.
De par sa constitution physiologique même, les premiers qui l’ont sollicité le plus impérieusement furent d’abord la nourriture, le vêtement, l’habitation.
Mais à mesure que la civilisation se développe, les besoins se multiplient, augmentent d’intensité. Aux besoins primitifs s’ajoutent bientôt ceux de sécurité, d’hygiène, de locomotion d’instruction, de moralité, de distraction, de vanité, de sensation du beau, etc.
Tout ce qui sert à la satisfaction de ces divers besoins est de la richesse.
« Un clou est de la richesse ; un hectolitre de blé est de la richesse ; la faculté qu’a le professeur de savoir donner une leçon est de la richesse comme le résultat de cette leçon ; l’air est aussi de la richesse, etc. En économie politique, le sens du mot richesse est donc plus étendu que dans le langage ordinaire, où richesse est pris dans le sens d’opulence et d’abondance de biens. » (J. Garnier. — Éléments de l’Économie politique.)
Avec Ad. Smith, J.-B. Say, Rossi, Dunoyer, Bastiat, J.-S. Mill, J. Garnier et H. Passy, nous disons donc, pour nous résumer, que la Richesse c’est : l’utilité et la valeur, les produits et les services. Tandis que, pour les physiocrates Malthus, Sismondi, Droz, Dutens, E. Daire, etc., les produits matériels seulement sont de la richesse. En éliminant ainsi « les résultats du travail s’appliquant aux hommes, ils méconnaissent l’analogie de ces résultats avec ceux du travail s’appliquant aux choses ». Pour être complet, mentionnons aussi l’opinion de Mac Culloch, Ricardo, A. Clément et Walras qui n’accordent la qualité de richesse qu’aux choses ayant de la valeur ou échangeables. Ceux là, ainsi que les physiocrates « mutilent la science en omettant une partie des choses qui satisfont les besoins des hommes, la richesse naturelle. Ils sont conduits à dire qu’un pays où la nature a répandu ses dons n’est pas un pays riche, ce qui est diamétralement opposé au sens usuel du mot richesse ».
En repoussant ces deux théories et en admettant, avec nous, que la Richesse, c’est l’universalité des choses qui satisfont les besoins des hommes, on est amené, si l’on veut être précis, à la diviser en matérielles et en immatérielles. Les premières sont celles qui résident dans les choses, ainsi que l’air, les subsistances, les minéraux, etc.; les secondes comprennent celles qui résident dans les hommes, comme les talents, le savoir, les services, etc.
Puis, dans un autre ordre d’idées, on subdivise encore la Richesse comme suit :
1°. Les richesses naturelles, ainsi qualifiées parce qu’elles sont octroyées toutes faites par la nature. Nous citerons dans cette catégorie : « l’air, la lumière, la force de la vapeur, l’électricité et toutes les forces et agents de la nature, comprenant la force végétative et la richesse métallique des terres susceptibles de production (sols cultivables, potagers, mines, étangs, cours d’eau); telles sont encore les facultés intellectuelles et physiques des hommes. »
Parmi ces richesses — qui devraient toutes être, logiquement, collectives et gratuites — il en est qui ont été accaparées, et leurs propriétaires n’en cèdent la possession ou l’usage qu’à titre onéreux. De là, cette arbitraire sous-classification des richesses naturelles en gratuites et en onéreuses. Il va sans dire que nous nous refusons énergiquement à admettre comme scientifique cette sous-classification qui tend de plus en plus à disparaitre sous la poussée formidable des idées socialistes. C’était l’opinion de Proudhon que Bastiat, dans ses Harmonies économiques, et Carey dans son livre Past, present and future, admettaient aussi ; avec cette différence toutefois, c’est que Carey et Bastiat considéraient la gratuité des agents naturels comme un fait accompli.
2°. Les richesses appelées produites, artificielles ou sociales, lesquelles ne se peuvent obtenir que par des moyens qui ne sont pas gratuits, qui nécessitent une dépense de force, des sacrifices, etc., comme les subsistasses, les habits, les maisons, les machines, les produits de toute nature, comme aussi les talents, le savoir et les services de toute sorte. Pour en jouir, il faut les avoir produites ou achetées en les échangeant contre d’autres valeurs. En effet — et la conclusion des économistes est ici inattaquable — les richesses sociales pourront devenir de moins en moins onéreuses ; mais, quel que soit le développement que prenne le machinisme, la science, le progrès en un mot, elles ne sauraient devenir absolument gratuites.
3°. Quelques économistes ajoutent encore aux précédentes les richesses qu’ils croient à la fois « naturelles et sociales ». Ils citent comme exemple les « diverses parties du sol dans les pays occupés où règne un commencement de civilisation ; telles encore les facultés de l’esprit et du corps. » Cette troisième catégorie de richesses a été ajoutée aux deux ci-dessus, comme la sous classification des richesses naturelles en gratuites et onéreuses, dans le but de légitimer la rente, le fermage et le monopole. L’une et l’autre sont toutes de convention, puisqu’elles tendent à disparaitre et qu’une classification doit être immuable pour être rigoureusement scientifique.
A. Rougé.