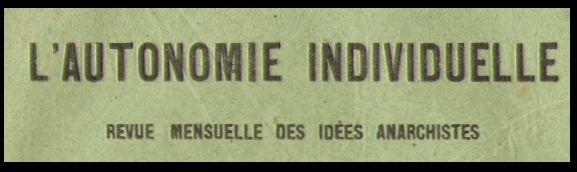(Résumé de la défense présentée en cour d’assises le 30 déc. 1887)
(Suite et fin).
Les criminalistes ont donné plusieurs raisons pour autoriser les pénalités : 1. l’expiation ; 2. la réparation envers la victime ou la Société ; 3. la défense de la Société par la répression, l’exemple et l’amélioration du coupable.
Pour l’expiation, on en a fait justice : l’individu n’étant pas libre, on ne peut lui faire expier par un châtiment l’action qu’il a commise, par plus qu’on ne peut faire expier à une tuile l’assassinat d’un passant. La deuxième raison ne vaut pas mieux que la première : le délit étant fatal, l’auteur n’en peut être responsable, et le punir pour réparer le mal qu’il a suscité serait folie. Il y aurait alors aggravation et non remède. Mais tout cela n’est guère défendu aujourd’hui que par quelques spiritualistes endurcis. Depuis un demi-siècle, les continuateurs de Bentham Mill, MM. Maudsley, Maleschott, Fouillée, Lombroso, H. Spencer et les transformistes n’acceptent que la troisième raison, c’est-à-dire le droit qu’aurait la Société de se défendre ou l’espèce d’éliminer les individus qui entravent son développement. Mais nous nions le droit social détruisant le droit individuel, puisque la Société a été faite pour les individus et non inversement. Vous prétendez « qu’en entrant dans la Société, par une sorte de pacte tacite, je me suis engagé à obéir aux lois que moi-même, en tant que citoyen, je contribue à établir. Si je romps le pacte, on me réprime et on m’impose une compensation ; en cela, rien d’injuste, parce qu’il n’y a rien là en définitive de contraire à ma volonté. J’ai voulu vivre en société, pour cela j’ai voulu des lois sociales : lorsque ces lois me contraignent, c’est moi qui me contrains par elles, c’est ma volonté antérieure qui réprime ma volonté présente, c’est moi qui, en tant que législateur, me défends contre moi-même en tant que violateur de la loi. » (A. Fouillée. — La pénalité et les collisions de droits). À cela, nous répondons par l’argument de Cesar Beccaria en l’étendant à toutes les peines quelles qu’elles soient : « Les droits qui constituent la souveraineté se composent nécessairement des droits abandonnés, sacrifiés primitivement par les individus dans le contrat social. Par conséquent le droit de punir de mort suppose, dans chaque membre de la Société, l’abandon, le sacrifice primitivement consenti de sa vie. Or, qui a jamais voulu donner à d’autres hommes le droit de lui ôter la vie ? Si cela était, comment accorder ce principe avec la maxime qui défend le suicide ? Ou l’homme a le droit de se tuer lui-même, ou il ne peut céder ce droit à un autre ni à la société entière. Donc, la peine de mort n’est appuyée sur aucun droit. » (C. Beccaria. — Traité des délits et des peines). Et nous ajoutons : Pas plus qu’il n’a dû sacrifier sa vie à la Société, pas plus l’homme n’a pu faire le sacrifice de sa liberté. Si cela était, le contrat serait nul, puisque le trafic des esclaves est aussi interdit, sinon plus, que le suicide. Seulement, avant d’employer ce sophisme, il faudrait prouver que tous les hommes ont adhéré à ce fameux contrat — prétexte de tous les despotismes ; et il n’en est rien.
Dès notre naissance, nous avons été jetés dans la Société et l’on ne nous a pas demandé si nous voulions y vivre. Les lois, on nous les a imposées. Nous ne les avons pas faites et la plupart d’entre nous les repoussent comme attentatoires à la liberté politique et économique de l’individu. Nous nions donc ce contrat et nous affirmons, si l’on emprisonne qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit, qu’on commet une violation arbitraire du droit individuel que nous mettrons toujours bien au dessus du droit social.
Mais si, abandonnant toute question de droit, on ne se réclame que de l’intérêt de l’espèce, avec les darwinistes, le sujet change de face. C’est ce que nous allons voir.
La défense sociale peut s’appliquer, nous l’avons déjà dit, de trois façons, savoir : 1. par l’exemple ; 2. par l’amélioration du criminel ; 3. par la répression. Pour acquit de conscience, nous dirons que l’exemple ne peu suffire à détruire les effets du milieu climatérique et social, de l’hérédité, des passions et des besoins. Le nombre toujours croissant des criminels le prouve suffisamment. Qui oserait soutenir que les exécutions capitales ont empêché un seul crime ? Personne.
L’amélioration du criminel par l’emprisonnement est une véritable dérision. « On le sait, nos prisons sont des lieux de perversion plutôt que de conversion. » (Guyau. — Critique de l’idée de sanction.) C’est en vain que Stuart Mill a écrit : « Cet homme a commis un acte grave, il n’était pas libre en le commettant ; mais je le châtie pour son bien, afin que le souvenir de la peine s’associe dans son esprit à l’idée de l’acte et l’en détourne une autre fois. » (La philosophie de Hamilton.) Non, cela n’est pas. Pourrait-on empêcher une tuile qui tomberait sur la tète d’un passant, de récidiver en la punissant ? Non, on ne peut également, en employant le même moyen, empêcher la criminalité ; par cela même que, vous le constatez comme nous, elle est fatale. Et, en supposant possible le redressement d’un criminel, il ne pourrait se faire dans ces circonstances puisque « pour que la peine corrige, il faut qu’elle soit acceptée comme juste. » (V. Cousin.) Ce qui ne pourrait être.
Reste la répression simple. Nos modernes philosophes se basent, pour en démontrer l’utilité, sur leur compréhension du système social. C’est quelque chose comme une machine dont chaque individu est un rouage ; et, continuant l’analogie, toujours d’après eux, cette machine a le droit d’extirper, « de réprimer » le rouage qui la gêne ; naturellement, c’est le plus faible. La réfutation est facile : « Dans une locomotive, par exemple, la vapeur contraint le piston, qui contraint la bielle, qui contraint les roues, et ainsi de suite. L’ordre réalisé par cette série de nécessités toutes extérieures est lui-même extérieur et superficiel : dans l’intimité des choses, la division subsiste, chaque partie lutte contre toutes les autres, et si elles aboutissent néanmoins à un concours, à une apparente harmonie, c’est par une action contre nature qui ne dure jamais éternellement. Toute machine se dérange, et tout ordre qui n’est qu’imposé, non consenti, aboutit tôt ou tard au désordre : c’est l’ordre des choses matérielles, non des êtres vivants. » (A. Fouillée. — Les Sociétés humaines ou animales.) Si l’on suppose logique la doctrine darwinienne, malgré ce que nous venons de dire, nous ajouterons : « Faut-il donc, si je ne suis qu’un rouage, que je me laisse écraser entre les roues de votre grande machine plutôt que de me conserver au dépens d’un autre rouage ? ( A . Fouillée. — L idée moderne du droit). Plus énergiquement, avec M. Caro, nous vous dirons encore : « Vous frappez dans un homme un ensemble de hasards et de coïncidences empiriques dont il est absolument innocent. Vous l’avouez vous-mêmes, et pourtant vous frappez ! Quelle inconséquence et quelle dureté ! Oui, quelle inconséquence!… Cela rappelle ces prêtres qui veulent accorder leur religion avec la science. Du reste, le droit de punir, comme la religion, n’accepte pas ces compromis ; ayant le cynisme de son ignorance, il ne se réclame que de la responsabilité morale basée sur le libre arbitre. Il en est si bien ainsi que les peines qu’on inflige sont infamantes ; tandis que « si les punitions n’étaient de la part de la Société que des moyens de défense, ce seraient des coups, ce ne seraient pas des punitions. (P. Janet. — Cours de philosophie.) Et puis, en acceptant ce principe, il y aurait uniformité de peine pour mêmes délits. Un mari qui tue sa femme devrait être aussi frappé que l’auteur d’un assassinat ayant la cupidité comme mobile, puisque l’un est aussi dangereux que l’autre pour l’ordre de la machine sociale. Au contraire, nos juges recherchent avec un grand soin les mobiles qui ont pu faire agir l’accusé comparaissant devant eux, et ils condamnent suivant les résultats de leur enquête. Ils acquittent Mme Clovis Hugues ; ils frappent de la peine capitale M. Gamahut. Il appert donc que le droit de punir n’est basé que sur le libre arbitre. Démontrer, comme les transformistes l’ont fait, qu’il n’existe pas, c’est affirmer que l’institution judiciaire est contraire au progrès, contraire à la science, — comme la religion, sa sœur ainée. Mais si, contre toute raison, ils maintiennent leur prétendu droit social primant le droit individuel au nom de l’utilitairianisme, avec M. Caro (Le doit de punir) nous leur opposerons ceci : « À ne considérer que l’utilité, l’intérêt d’un seul est aussi sacré que celui d’un million d’hommes ; il peut s’immoler au bien public, — c’est l’acte d’un héros ; mais si on le sacrifie de force et sans son consentement, ceux qui le sacrifient usurpent le nom de juges, ils sont des bourreaux. » C’est notre conclusion.
Mais qu’on ne s’y trompe. Utilitairianiste, certes nous le sommes ; seulement notre utilitairianisme est individualiste et a en profonde horreur le communisme, nécessaire à une humanité-enfant et nuisible à une collectivité d’individus se soumettant aux forces de la nature puisque, comme l’a dit le grand Bacon, c’est le seul moyen d’en triompher, mais se sentant le pouvoir de marcher sans entraves politiques et économiques vers « l’humanité définitive » de H. Spencer. Nous tenions à faire cette déclaration pour dissiper tout malentendu et bien faire sentir à nos lecteurs quelle est notre conception du droit.
G. Deherme.