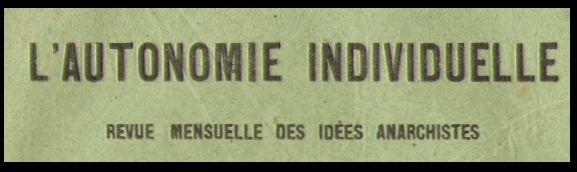1Dans notre travail, nous ne parlerons que de la bourgeoisie française pour simplifier la question, quoiqu’en réalité le pouvoir mercantil soit international.
La Révolution ne fut que la consécration de la prépondérance bourgeoise qui s’était manifestée bien avant cette époque. En effet, si la terre restait toujours aux mains des nobles, les capitaux, la grande puissance des temps modernes, commencent à s’amasser dans celles des négociants. De 1515 à 1568, il y eut plus d’or en France, dit Bodin, qu’on n’eut pu en recueillir auparavant en deux cents ans. Les bourgeois deviennent les maîtres de l’argent2V. Duruy, histoire des temps modernes..
Lorsque la Convention proclama la République, la situation politique qu’avaient laissée nos grands rois, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, était détestable. En quelques semaines, elle rétablit la grandeur française à l’extérieur, par ses armées de volontaires ; à l’intérieur, par ses proclamations, ses décrets, qui semblaient vouloir établir l’égalité politique et économique des citoyens. Voila la poussée que fit faire les deux journées révolutionnaires des 10 août et 2 septembre 1792. Qui sait ce qui serait advenu si les conventionnels avaient conservé l’énergie dont ils s’étaient montrés prodigues au début de leur pouvoir ? Mais non, comme tout homme, ou agglomération d’hommes, dans les mains desquelles on met un pouvoir quelconque, la « pourriture d’assemblée » s’était emparée d’eux, et ceux-là même qui n’ont pas assez d’éloges pour eux ne sont-ils pas contraints d’avouer qu’à plusieurs reprises les faubourgs durent aller les trouver en armes pour les empêcher de faiblir, de trahir même.
Quoi qu’il en soit, le peuple, qui avait versé son sang pour placer le tiers-état au pouvoir, était peu à peu éliminé de la discussion des affaires publiques ; voici, du reste, ce qu’en pensait un de nos publicistes le plus éminents, M. Maurice La Châtre : « Mais, hélas ! si admirable que fût cette victoire sur la royauté, elle ne put affermir la souveraineté du peuple ; une nouvelle caste, la bourgeoisie, chercha à se rendre maitresse du terrain et entrava la marche de la Révolution. Bientôt la Convention, travaillée par les meneurs, et déjà scindée en deux. factions, celle des Girondins et celle des Jacobins, devint le théâtre de scènes violentes ; une foule d’hommes corrompus et avides transformèrent l’Assemblée nationale en une sorte d’arène, et poussèrent la France dans les abimes de l’anarchie3Il est probable que La Châtre entend ici par anarchie la définition qu’en donnent la généralité des dictionnaires..»
Dans cette lutte de mesquines ambitions qui s’étaient déclarées entre les deux plus importants groupes de la Convention, les Montagnards l’emportèrent d’abord ; ils font décréter l’installation d’un tribunal criminel chargé de poursuivre toutes les entreprises réactionnaires ; ils font adopter une loi pour l’établissement d’un Comité de Salut public composé de neuf membres dont les attributions consistaient à surveiller et à diriger l’action du pouvoir exécutif s’amollissant de plus en plus. Les Girondins, qui ne peuvent empêcher le vote de ces mesures, cherchent à discréditer Robespierre, Saint-Just, Marat ; ce dernier est même décrété d’accusation mais le tribunal l’acquitte et le peuple le ramène en triomphe.
Peu après, les Girondins obtiennent, en revanche, un décret nommant une commission extraordinaire pour examiner les arrêtés pris par la Commune : c’était la suspecter.
Jusqu’à la chute des Girondins, ce ne fut que tiraillements, luttes stériles, parce qu’elles n’avaient pour but que la satisfaction d’inavouables ambitions.
Ces querelles de parti n’intéressaient aucunement le peuple qui, naturellement, en était exclu. « Nos patriotiques assemblées de la Législative, de la Convention (Montagnards, Girondins, n’importe, sans distinction de parti) appartenaient entièrement à la classe bourgeoise4Michelet, La Révolution française..». Armonville, cardeur de laine, était le seul ouvrier conventionnel.
Quoique cela puisse paraître un paradoxe, nous croyons que cette course à la dictature partait d’une idée généreuse : les hommes politiques d’alors, comme de toutes les époques, avaient chacun la conviction qu’eux seuls pouvaient faire le bonheur de la France et, peut-être même, de l’humanité, en déniant toutefois à celle-ci la capacité et le droit de se sauver elle même. On avouera que le préjugé monstrueux qu’ont les masses de se donner toujours des maîtres— préjugé soigneusement entretenu par tous les dirigeants — est peu propre à désabuser les sauveurs de peuple.
Seuls, quelques Cordeliers, Girondins, et les Hébertistes, restèrent toujours mêlés au peuple ; ils furent aussi les seuls qui auraient pu mener la Révolution à bonne fin5Nous entendons par là que son véritable but n’aurait pas dû être seulement l’émancipation d’une caste, mais de tous les êtres humains. S’il en avait été ainsi, nous ne serions pas aujourd’hui contraints de constater la décadence bourgeoise. « Pour mieux rendre le peuple libre, ils le soumettaient à l’individu. » Parmi eux, Fauchet prêchait au Palais-Royal l’utilité de « fonder la société humaine sur le devoir de donner à chacun de ses membres la suffisante vie. » Son journal, la Bouche de fer, se faisait le propagateur des doctrines socialistes et agraires. Le baron Clootz, dans sa constitution, disait : « Les hommes seront ce qu’ils doivent être quand chacun pourra dire le monde est ma patrie, le mande est à moi. Alors plus d’émigrants. La nature est une, la société est une. » Marat s’écriait : « Quand un homme manque de tout, il a le droit d’arracher à un autre le superflu dont il regorge. » C’est entre ces hommes — Girondins, Hébertistes et Cordeliers — aux vues larges et originales, et les nullités jacobines, à la philosophie sentimentale et au sectarisme autoritaire implacable et sanguinaire, que la lutte s’engageait.
Ce fut d’abord les principaux meneurs girondins qui succombèrent ; le 2 juin 1793 ils furent décrétés d’accusation. Robespierre et ses satellites s’emparèrent alors presque entièrement du pouvoir, l’autoritarisme en fut plus effréné et la liberté se noya dans le sang des adversaires du dictateur.
Pourtant, s’apercevant que les proclamations et les lois de la Convention ne lui donnaient ni la nourriture du corps — le pain, ni la nourriture intellectuelle — la liberté, le peuple écoutait de plus en plus les Hébertistes lui exposant les théories socialistes du girondin Fauchet. Ceux-ci devinrent donc une force que Robespierre, en bon despote, ménagea, pour mieux l’écraser ensuite.
L’autocratie de la Convention devenait de plus en plus intolérable, à tel point que Camille Desmoulins, qui avait toujours été le chien couchant du député d’Arras, écrivait dans le Vieux Cordelier : « On reconnaît que l’état présent n’est pas celui de la liberté ; mais on nous dit de prendre patience ; que nous serons libres un jour. Pense-t-on que la liberté, comme l’enfance, ait besoin de passer par les cris et les pleurs pour arriver à l’âge mûr ? La liberté n’a ni vieillesse ni enfance. La liberté n’est pas une actrice de l’Opéra promenée avec un bonnet rouge ; la liberté, c’est le bonheur, c’est la raison, c’est l’égalité, c’est la justice, c’est la déclaration des droits de l’homme!… — Voulez-vous que je la reconnaisse ? que je tombe à ses pieds ? que je donne tout mon sang pour elle ? — Ouvrez les prisons à ces deux cent mille citoyens que vous appelez suspects ; car dans la Déclaration des droits de l’homme, il n’y a point de maisons de suspicions ; il n’y a que des maisons d’arrêt ; il n’y a point de gens suspects ; il n’y a que des prévenus de délits fixés par la loi. » Et il conclut par une tirade à la Jean-Jacques : « O mon cher Robespierre, ô mon vieux camarade de collège, souviens-toi de ces leçons de l’histoire et de la philosophie que l’amour est plus fort, plus durable que la crainte ! »
(A suivre)
G. D.
- 1Dans notre travail, nous ne parlerons que de la bourgeoisie française pour simplifier la question, quoiqu’en réalité le pouvoir mercantil soit international.
- 2V. Duruy, histoire des temps modernes.
- 3Il est probable que La Châtre entend ici par anarchie la définition qu’en donnent la généralité des dictionnaires.
- 4Michelet, La Révolution française.
- 5Nous entendons par là que son véritable but n’aurait pas dû être seulement l’émancipation d’une caste, mais de tous les êtres humains. S’il en avait été ainsi, nous ne serions pas aujourd’hui contraints de constater la décadence bourgeoise