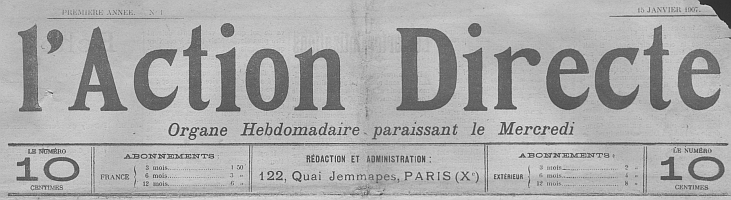C’est, sans doute, un fait important que les manifestations du 12 janvier à Berlin et dans quelques autres villes de Prusse. La social-démocratie allemande ne nous a pas habitués à ce mode d’action. Mais, quelle est, au juste, la portée de cet événement ?
Disons, d’abord, que ceux qui, en France et ailleurs, profitent de l’occasion pour faire la leçon aux dénigreurs de la social-démocratie, se hâtent un peu trop. Sont-ils bien sûrs que la journée du 12 janvier marque une orientation nouvelle dans la bonne vieille tactique du parti socialiste allemand ? Sont-ils bien sûrs que la peur de l’action des masses, le préjugé de la légalité qui fait le fond de la vieille tactique, a définitivement fait place à une tactique nouvelle, révolutionnaire non seulement en paroles, mais aussi en actes ?
Et puis, il ne faut pas oublier que la critique des dénigreurs a bien eu sa part dans la résolution tardive de la social-démocratie de faire un essai de sortir de l’ornière commode de la légalité. Bien plus, cet essai même donne raison aux critiques antérieures. Nous a‑t-on assez rebattu les oreilles par des objections tirées de ces fameuses « circonstances » spécifiquement allemandes qui s’opposeraient absolument à une action de la rue ! Des manifestations extra-légales, faites sans l’autorisation gouvernementale, c’était bon pour les Français, pour les Belges, pour les Italiens, pour les Autrichiens (pour les Russes, surtout!)… Mais en Allemagne, en Prusse, y pensez-vous ? « Le fusil qui tire, le sabre qui tranche » sont là qui guettent les pauvres social-démocrates osant se montrer dans la rue, malgré la police, pour n’en faire qu’une bouchée. L’action de la rue en Allemagne ce serait, nous répétait-on, une aventure folle où sombrerait pour longtemps le travail persévérant de quarante années…
Eh bien, l’événement a démontré l’inanité de ce plaidoyer. Le croquemitaine gouvernemental n’était si terrible que parce qu’on en avait trop peur. Les circonstances spécifiques de l’Allemagne étaient faites surtout de cette mentalité spécifique et traditionnelle qu’un célèbre écrivain allemand d’avant 1848 a flagellé par ces mots : « Chaque Prussien porte son gendarme dans son propre cœur ».
Le mal profond de la social-démocratie allemande, c’est de n’avoir pas su, depuis quarante ans, transformer la mentalité de ses adhérents. Elle se bornait à transformer leurs conceptions, leurs idées, leur manière de penser, sans rien changer à leur volonté efficace, à leur manière d’agir. Révolutionnaires par leurs pensées, ils demeuraient des gens de routine, des philistins par leurs actes.
La journée du 12 janvier marque-t-elle, à ce point de vue, un changement profond et définitif ? Bien superficiel et rudement optimiste qui l’affirmerait.
En effet, cette action directe des socialistes allemands, ne l’oublions pas, se produit à propos d’une revendication qui ne dépasse point le cadre traditionnel de leur activité, le cadre électoral et parlementaire. C’est dire que le succès même de cette campagne, loin d’aiguiller la social-démocratie sur une voie nouvelle, doit l’enfoncer plus profondément dans la vieille ornière électorale et parlementaire. La « machine à voter », la fabrique à sièges parlementaires ayant reçu un aliment nouveau, absorbera des énergies nouvelles. Les élections au Reichstag ont déjà beaucoup perdu de leur attrait psychologique. Les élections au Landtag prussien, au Parlement de l’État dirigeant de l’Empire, faites sur des bases plus ou moins démocratiques, referaient une espèce de virginité aux espérances bien flétries de l’action électorale et parlementaire.
Ainsi, la logique de cette action directe conduit à sa propre négation, puisque, en fin de compte, elle ne fera que rehausser l’éclat du parlementarisme.
Telle fin, telle origine. La lutte, si directe soit-elle, pour le Suffrage universel en Prusse a, en effet, pour origine l’accentuation croissante de la tactique parlementaire de la social-démocratie.
Il y a 15 ans, les social-démocrates étaient bien rares qui songeaient seulement au Landtag prussien. Ed. Bernstein, ce parlementariste logique avec lui-même, fut le premier à propager l’idée de la participation aux élections prussiennes. Et ce fut encore ce réformiste clairvoyant qui, le premier, parla de la pression du dehors, des manifestations, voire de la « grève de masses » pour obtenir le Suffrage universel en Prusse. Il savait ce qu’il faisait. Et, d’ailleurs, toute l’action social démocrate favorisait ses idées. L’énergie accumulée cherchait une issue, — je veux dire : la masse toujours croissante des votants social-démocrates cherchait à se faire valoir sur des champs électoraux toujours nouveaux. Tel Napoléon, poussé par la logique de son action conquérante à faire des conquêtes toujours nouvelles, tels les milliardaires de nos jours, poussés par l’augmentation de leur capitaux à élargir sans cesse leur champ d’exploitation. À chaque mode d’activité sa logique particulière.
Après avoir étendu son action électorale aux Conseils municipaux, à tous les Landtags (parlements des États composant l’Empire) possibles, aux Conseils des prud’hommes (y compris la section des patrons!), elle a fini par participer aux élections pour le Landtag prussien, maudit, abhorré, boycotté pendant 30 années. Mais là, elle se heurta à un obstacle insurmontable. Malgré toute sa bonne volonté de lier partie avec les libéraux bourgeois, elle ne réussit pas à obtenir un seul mandat, les libéraux prussiens préférant toujours un réactionnaire forcené au social-démocrate le plus édulcoré. L’obstacle, c’était le système électoral. Une expérience deux fois répétée a montré que, sous ce système, il ne fallait pas songer à obtenir le moindre mandat.
De là, la poussée croissante à courir sus au privilège électoral des classes possédantes en Prusse, privilège qui, il y a 10 à 15 ans, laissait la social-démocratie bien tranquille. Oui, bien tranquille ! Et pourquoi ? Parce qu’elle croyait pouvoir se passer des mandats au Landtag prussien, sa foi dans la force révolutionnaire de son action au Parlement de l’Empire étant restée encore intacte.
La lutte pour le Suffrage universel en Prusse est donc bien l’aboutissant d’une tactique parlementaire de plus en plus exclusive, de plus en plus absorbante. Les allures d’action directe qu’elle revêt, pour l’instant, ne sauraient nous tromper là-dessus.
Il est, d’ailleurs, très significatif que les manifestants de Berlin entonnaient cette bonne berceuse électorale qui chante l’infaillibilité du « suffrage libre » :
« Das freieWahlrecht ist das Zeichen,
In dem wir siegen…»
(« C’est le suffrage libre qui nous assure la victoire ».)
Et pourtant, on pouvait croire que les ouvriers de Berlin, au moins, qui sont l’élément le plus avancé de la social démocratie, étaient déjà guéris de ce que Marx appelait le crétinisme parlementaire…
Le Congrès de Stuttgart a mis en évidence l’isolement moral de la social démocratie. Après ce Congrès, Kautsky lui-même écrivait que les temps de l’hégémonie allemande dans l’Internationale étaient passés. L’action nouvelle inaugurée le 12 janvier relèvera-t-elle le prestige de la social démocratie aux yeux des autres partis socialistes ? C’est bien possible, c’est même certain. D’autant plus que ce type accompli d’un parti socialiste parlementaire reste, malgré tout, le modèle et le contrefort de la tactique parlementaire internationale. Mais il est non moins certain que l’action nouvelle est bien loin de marquer une orientation révolutionnaire de la social démocratie.
La lutte pour le Suffrage universel vaut mieux que le Suffrage universel lui-même. Mais à condition qu’elle dépasse son objet, qu’elle soit un moyen d’aguerrir les masses ouvrières, d’augmenter leur puissance d’action propre et spontanée. À condition aussi et surtout de ne pas ressusciter la foi enfantine en la toute-puissance de l’action électorale.
Ces conditions, on ne les voit pas, malheureusement, réalisées dans l’action de la social-démocratie.
Au point de vue syndicaliste, cette action, si directe qu’elle soit, se fait, en somme, — « pour le roi de Prusse ». C’est une action directe parlementarisée.
B. Krithewsky