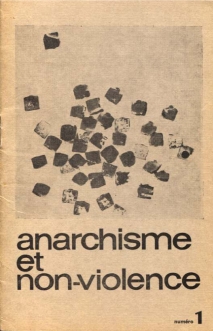« Il est étonnant que les peuples chérissent si fort le gouvernement républicain et que si peu de nations en jouissent ; que les hommes haïssent si fort la violence et que tant de nations soient gouvernées par la violence.»
Montesquieu (Pensées)
— O —
Il nous est apparu intéressant, dans ce premier numéro d’une revue consacrée à l’anarchisme et à la non-violence, d’étudier la nature et les formes de la violence afin de mieux connaître son visage, et de mieux la reconnaître sous ses masques. Cela nous semble être une condition préalable à tout travail ultérieur visant à la disparition dans notre vie et dans notre civilisation des moindres traces de cet état naturel qu’est la violence et à la promotion de l’anarchie, cet « ordre par l’harmonie », comme le disait si bien Louise Michel.
Une première remarque s’impose, c’est la mauvaise conscience de la violence. En général, sauf pour quelques disciples de Calliclès1Platon : Gorgias 482e — 484a. ou de Nietzsche2Ainsi parlait Zarathoustra — Par-delà le bien et le mal. qui ont le courage de leurs idées et de leurs actes, la violence se dissimule sous des raisons fallacieuses ou sous des apparences plus bénignes. Si l’on en croit les livres de droit, de morale, de théologie, on n’a qu’à se louer de la sagesse de nos savants, de nos chefs politiques et sociaux, de la bienveillance de nos dieux et de l’harmonie de nos institutions publiques. En fait, il suffit d’ouvrir ses oreilles et ses yeux pour voir les individus et les communautés opprimés par la tyrannie individuelle ou collective sous toutes ses formes. La loi, elle-même, qui devait assurer la justice entre le fort et le faible, est le moyen le plus assuré et le plus légal pour écraser le faible.
C’est peut-être là qu’il faut trouver le sens de la révolte anarchiste en face de la dureté de ceux qui profitent de leur puissance (physique ou intellectuelle) et aussi, hélas ! devant l’aveuglement et l’inconscience des opprimés qui, bien souvent il faut le dire, n’ont que ce qu’ils méritent3Cf. La Boétie : Discours sur la servitude volontaire. et se complaisent dans leur situation par une sorte de masochisme plus ou moins inconscient.
Une des causes de l’emploi de la violence est l’instinct naturel de possession, qu’il soit individuel ou collectif (État par exemple), comme l’a bien démontré P.-J. Proudhon4La Guerre et la paix. lorsqu’il expose qu’il est faux de penser avec Grotius que la guerre est une injustice du côté de l’assaillant qui vise à s’approprier de ma personne et de mes biens et une juste action du côté de l’assailli. Il développe sa pensée en indiquant que l’injustice — ou la justice, comme on voudra — de la guerre est totale chez les deux et inséparable même de l’idée de guerre. En effet, ce qui est en question, c’est la propriété, source du différend. Si l’assaillant veut mes biens et ma personne, s’il m’en dénie la possession, c’est que j’en ai à l’origine revendiqué la possession. Dans cette optique, l’assailli n’est pas plus fondé à se défendre que l’assaillant à attaquer. Tous deux vivent dans une même fausse philosophie, j’entends celle de la propriété5Définie de manière pittoresque, par l’auteur, par le vol.. Tout exercice d’un pouvoir est illégal, car il vise à maintenir ou à étendre ce vol initial.
Cela nous amène à expliquer pourquoi l’homme, et aussi l’animal, en est venu à vouloir posséder : c’est principalement dans la crainte de ne pas pouvoir survivre, de ne pas pouvoir trouver à temps un toit, de la nourriture, une compagne et des enfants pour l’aider dans des époques préhistoriques où tous ceux qui naissaient n’étaient pas assurés dans leur existence ; c’est la peur de manquer qui est à l’origine de ce premier vol qu’est la propriété qui engendre en fait les guerres, quels que soient les motifs officiels qui l’agrémentent : État, patrie, religion, liberté, etc. Tout le monde n’a pas le courage d’un Hitler proclamant qu’il luttait pour accroître son espace vital… En termes moins choisis, l’agresseur veut réduire sa pénurie actuelle, l’agressé défendre son bifteck. P.-J. Proudhon ne disait-il pas dans une forte remarque que la « guerre est fille du paupérisme, elle a la cupidité pour marraine et son frère est le crime » ?
Travaillons donc à supprimer la cause (amélioration des techniques, limitation des naissances, etc.), nous aurons travaillé à supprimer ses effets désastreux.
Il est constant de remarquer combien cette peur de manquer a amené les hommes à posséder plus qu’ils n’avaient en fait besoin pour survivre à cause de l’atmosphère fratricide de méfiance généralisée et de ce fait à opprimer ceux que la nature n’avait pas doué à leur égal de force physique ou de ruse intellectuelle.
De cet état de défiance est sortie une autre cause d’agressivité, la compétition, la concurrence, puisqu’on en est venu à juger un homme à ses possibilités de survie, donc de domination. Sur cette cause s’est greffé un besoin de réputation qui est un emploi de la violence par procuration et comme à distance6Un peu à la façon de Lyautey disant qu’il fallait montrer ses armes pour n’avoir point à s’en servir. qui peut cesser d’être un moyen pour devenir à lui-même sa propre fin, comme on le voit dans des disputes d’honneur mettant en cause des individus, des collectivités ou des États et éclatant souvent pour des riens on des futilités comme l’histoire nous l’enseigne.
Ce dont il faut prendre conscience, c’est que la guerre :
- est une survivance anachronique dans un siècle de puissance technique et scientifique ;
- prouve que l’esprit de l’homme, toujours dans sa préhistoire, n’a pas suivi les réalisations positives de son intelligence, qu’elle est une défaite de la raison, de l’humanité qui est insupportable pour les hommes de sens rassis ;
- ne se limite pas aux luttes entre États, mais qu’elle se trouve partout où il y a une volonté latente de se battre au lieu de convaincre, c’est-à-dire aussi bien dans les armées, dans les Églises, dans l’exploitation des colonisés, des prolétaires, que dans certaines formes d’enseignement plus proches du catéchisme que de la réflexion, dans l’abrutissement des enfants par certains parents ou la dictature de l’amant, du mari que du prolétariat…
En conséquence, il importe, et c’est le but des articles de ce numéro et de ceux qui suivront, de définir à la fois des techniques pour éviter tout recours à la violence, même sous ses formes larvées et des techniques non-violentes pour « imposer » enfin un règne des rapports interhumains plus nobles, plus égalitaires et plus justes.
À cet égard, le titre de notre, de votre revue est significatif, car la non-violence appartient bien à une philosophie anarchiste7Nous disons une et non pas la, car nous savons bien d’abord que l’anarchisme n’est pas monolithique et parce que nous avons d’excellents camarades qui, par humeur personnelle ou conviction plus ou moins rationnelle, sont contre ces positions et nous-mêmes nous ne savons pas exactement jusqu’où peut aller notre non-violence. Encore une raison pour justifier la nécessité de cette revue pour une œuvre d’explication. qui se refuse d’employer les moyens des oppresseurs, même pour s’en libérer et, instaurer un équilibre plus serein. On ne sait jamais où s’arrête la violence, même et surtout celle produite au nom de la vertu et de la liberté.
De plus, on risque à employer les moyens de ceux qui nous opprimer de se mettre à leur niveau et de voir notre idéal sali par les instruments destinés à le réaliser.
Christian Meriot
- 1Platon : Gorgias 482e — 484a.
- 2Ainsi parlait Zarathoustra — Par-delà le bien et le mal.
- 3Cf. La Boétie : Discours sur la servitude volontaire.
- 4La Guerre et la paix.
- 5Définie de manière pittoresque, par l’auteur, par le vol.
- 6Un peu à la façon de Lyautey disant qu’il fallait montrer ses armes pour n’avoir point à s’en servir.
- 7Nous disons une et non pas la, car nous savons bien d’abord que l’anarchisme n’est pas monolithique et parce que nous avons d’excellents camarades qui, par humeur personnelle ou conviction plus ou moins rationnelle, sont contre ces positions et nous-mêmes nous ne savons pas exactement jusqu’où peut aller notre non-violence. Encore une raison pour justifier la nécessité de cette revue pour une œuvre d’explication.