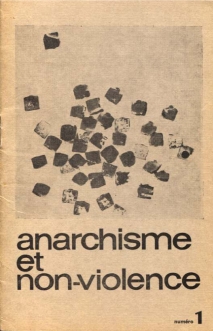Nous disions dans l’éditorial que l’idée de non-violence n’est pas originale pour le mouvement anarchiste : témoin cet article d’Hem Day paru dans l’Unique, numéros 54, 55 et 56 de janvier-février, février-mars et mars-avril 1951.
Hem Day est l’animateur des cahiers de Pensée et Action qui ont édité notamment Pour vaincre sans violence de Barthélemy de Ligt.
Rabelais, ce grand maître, avait écrit au fronton de l’abbaye de Thélème : « Fais ce que tu veux. » C’était là affirmation libertaire, puisqu’elle voulait signifier que les habitants de l’abbaye entendaient ne vouloir être ni maîtres, ni esclaves. Étendue, cette affirmation pouvait signifier que le milieu qui allait s’instaurer éliminerait toute prescription, toute interdiction qui s’exerceraient par voie de contrainte ou de répression.
Ni chef qui commande, ni soldat qui obéit ; l’autorité qu’on exerce et celle qu’on supporte étaient tenues en égale horreur.
Cela veut dire aussi que l’anarchiste n’accepte aucune violence et entend n’en pratiquer soi-même sur personne.
La violence n’est pas anarchiste. Cette négation, il faut la réhabiliter au sein de l’anarchisme, car trop d’aigris, de mécontents, de révoltés d’une heure se sont abrités sous l’égide de cet idéal pour couvrir des gestes ou des actes qui n’avaient rien à voir avec les idées libertaires.
Je n’entends cependant point jeter la pierre à ceux qui, acculés par une société criminelle, se virent dans l’obligation d’user de moyens violents pour se défendre. Je comprends leur déterminisme. Produits d’un milieu dont ils étaient les victimes, il était normal qu’ils se décident d’user des moyens que la société n’avait cessé de faire prévaloir et d’utiliser trop souvent pour les mater. L’exemple venait de haut, il fut utilisé par ceux qui, las d’être sacrifiés, se jurèrent de retourner ces mêmes méthodes contre leurs oppresseurs.
Le coupable est mal venu de protester de nos jours puisque son imprévoyance, son égoïsme, sa soif de pouvoir et d’autorité ont fait qu’il a donné naissance à des sentiments discutables sans doute, mais justifiables par certains côtés. Que les maîtres s’en prennent à eux-mêmes avant tout lorsqu’il leur arrive d’être quelque peu secoués par les révoltés de tout un monde indigné de tant de bassesse, de lâcheté et d’orgueil !
Mais déjà pointe sur vos lèvres cette question pressante qui se devine aisément :
Les anarchistes n’ont-ils jamais jeté des bombes ?
Certes, les anarchistes ont jeté des bombes. L’époque de « la propagande par le fait » n’est pas une légende inventée de toutes pièces par ceux-là même qui devaient en déformer ou en triturer les mobiles, qui poussèrent certains anarchistes à ces actes désespérés.
Les lanceurs de bombes eurent leurs apologistes. Des écrivains tels que Paul Adam et Laurent Tailhade n’hésitèrent point à exalter leurs faits et gestes, tandis que toute une meute se ruait à leurs chausses pour les accabler et les vouer aux gémonies.
Avec le recul du temps, comme ces bombes paraissent puériles et inoffensives à côté des engins puissants utilisés par les armées modernes ! Songez aux bombes atomiques, voyez Hiroshima et, si vous en avez l’envie, jugez ! Où est le criminel ?
Mais si les uns furent exécutés et voués au mépris, les autres furent glorifiés et décorés ; ainsi le veut une certaine civilisation.
D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’il y eut quelques lanceurs de bombes anarchistes que, nécessairement, l’on doit formuler à l’encontre de l’anarchisme l’accusation de violence, et de prétendre qu’il n’est rien que violence.
Je ne porterai point de jugement pour ou contre les tyrannicides, mais il me sera permis cependant de faire remarquer que bon nombre d’actes individuels de violence politique, mis au compte des anarchistes, n’eurent point des anarchistes pour auteurs.
Il fut une époque où l’anarchisme avait bon dos. Dès qu’un attentat était perpétré, on ne devait point chercher plus loin : le coupable avait signé lui-même son acte, c’était un anarchiste. La légende a perduré et, de nos jours, les plumitifs de la presse bien pensante ont tellement déformé l’information que l’opinion publique reste convaincue que seuls les anarchistes sont capables de tels gestes.
Pourtant, qu’on relise l’histoire, elle est toute jonchée de crimes et d’assassinats : princes et rois, grands de la cour et de l’Église, meurtres religieux. Voyez les martyrs immolés pour le prestige et les ambitions, les meurtres politiques d’hier et d’aujourd’hui, depuis Brutus jusqu’à Staline, sans oublier Mussolini et Hitler.
Quelle hécatombe et combien infinitésimaux se révèlent alors les attentats anarchistes par rapport à la multitude de ceux commis par tout un monde aux idées et opinions les plus diamétralement opposées !
Il faut le redire afin d’extirper cette pensée courante qui s’est ancrée chez beaucoup : les anarchistes n’ont pas le monopole de la violence.
Sans doute, les anarchistes ne sont pas de bois ; hommes tout comme le reste des humains, ils opposent une sensibilité souvent plus grande que certains au mal et à l’injustice. Plus que d’autres, ils ressentent l’oppression, et leurs réflexes plus vifs les conduisent à formuler leurs protestations plus violemment parfois.
Affaire de tempérament individuel et qui n’est pas exclusif lui non plus à l’anarchiste, mais ceci n’est point l’expression de la théorie anarchiste en particulier.
Situant admirablement le problème dans son A.B.C. de l’anarchisme, mon ami Alexandre Berkman écrivait à ce sujet :
« Vous demanderez peut-être si le fait de professer des idées révolutionnaires n’influence pas naturellement quelqu’un dans le sens de l’acte violent. Je ne le crois pas ; les méthodes violentes sont aussi employées par des gens d’opinion très conservatrice. Si des personnes d’opinion politique directement opposées commettent des actes semblables, il n’est guère raisonnable de dire que leurs idées sont la cause de tels actes.
« Des résultats semblables doivent avoir une cause semblable, mais cette cause, ce n’est pas dans les convictions politiques qu’il faut la découvrir, mais bien plutôt dans le tempérament individuel et le sentiment général au sujet de la violence.
«— Vous avez peut-être raison quand vous parlez de tempérament, direz-vous. Je vois bien que les idées révolutionnaires ne sont pas la cause des actes politiques de violence, sinon tout révolutionnaire commettrait de tels actes. Mais ces vues révolutionnaires ne justifient-elles pas dans une certaine mesure ceux qui commettent de tels actes ?
«— Cela peut sembler vrai à première vue. Mais, si vous y réfléchissez, vous verrez que c’est une idée entièrement inexacte. La meilleure preuve en est que les anarchistes qui ont exactement les mêmes idées au sujet du gouvernement et de la nécessité de son abolition sont souvent d’opinion différente sur la question de la violence. Ainsi les anarchistes tolstoïens et la plupart des individualistes condamnent la violence politique, tandis que d’autres anarchistes l’approuvent, du moins la justifient ou l’expliquent.
« De plus, beaucoup d’anarchistes qui croyaient autrefois à la violence, comme moyen de propagande, ont changé d’opinion à ce sujet et n’approuvent plus de telles méthodes.
« Il y eut une époque, par exemple, où les anarchistes préconisaient les actes de violence individuelle connus sous le nom de « propagande par le fait ». Ils ne s’attendaient pas à changer, par de tels actes, le système gouvernemental et capitaliste en un système anarchiste et ne pensaient pas non plus que la suppression d’un despote abolirait le despotisme. Non, le terrorisme était considéré comme un moyen de venger les maux dont souffrait le peuple, d’inspirer la crainte à l’ennemi et d’attirer l’attention sur le mal contre lequel l’acte de terreur était dirigé. Mais la plupart des anarchistes ne croient plus aujourd’hui à la « propagande par le fait » et n’approuvent pas des actes de cette nature.
« L’expérience leur a appris que, bien que de telles méthodes aient pu être justifiées et utiles autrefois, les conditions de la vie moderne les rendent inutiles et même dangereuses pour la diffusion de leurs idées. Mais leurs idées restent les mêmes, ce qui signifie bien que ce n’est pas l’anarchisme qui leur avait inspiré leur attitude de violence. Cela prouve que ce ne sont pas certaines idées ou certains « ismes » qui conduisent à la violence, mais que ce sont d’autres causes.
« Il nous faut donc regarder ailleurs pour trouver l’explication convenable. Comme nous l’avons vu, des actes de violence politique ont été commis non seulement par des anarchistes, des socialistes et des révolutionnaires de tout genre, mais aussi par des patriotes et des nationalistes, des démocrates et des républicains, des suffragettes, des conservateurs et des réactionnaires, par des monarchistes et des royalistes et même par des hommes aux opinions religieuses et des chrétiens dévots. »
N’a-t-on pas écrit les pires insanités sur cet idéal en affirmant qu’il n’est que désordre, alors que le désordre et la violence sont engendrés par le capitalisme et les États ?
On ne le dira jamais assez, l’anarchisme, c’est l’ordre sans gouvernement ; c’est la paix sans violence. C’est le contraire précisément de tout ce qu’on lui reproche, soit par ignorance, soit par mauvaise foi.
Il est difficile d’empêcher quelqu’un d’être de mauvaise foi, mais il n’est pas impossible, lorsqu’on a éclairé ceux qui ignoraient ce qu’est l’anarchie, que les gens de mauvaise foi soient mis dans l’impossibilité de continuer à nier par les mensonges qu’ils débitent sachant que ce qu’ils disent est faux et erroné.
Nous allons éclairer la lanterne de certains et, pour ce faire, cueillir dans les écrits des principaux théoriciens de l’anarchisme tout ce qui se rapporte à la violence et à la non-violence, ainsi ferons-nous œuvre utile.
Ces critériums n’ont point la prétention de faire apparaître l’anarchisme sous un aspect bon enfant qui servirait l’idée que je me suis proposé d’exprimer. Ils ne visent qu’à montrer, comme l’écrivait Zencker, que « la violence et la propagande par le fait ne sont pas inséparablement liées à l’anarchisme », tandis que Mackay, lui, est plus affirmatif, puisqu’il n’hésite pas à écrire dans les Anarchistes : « L’anarchisme rejette la violence et la propagande par le fait. »
W. Godwin, s’il n’appelle pas anarchisme sa doctrine sur le droit, l’État et la propriété, n’en fut pas moins amené à considérer l’État comme une institution juridique contraire au bien-être universel, et la propriété le plus grand obstacle au bien-être de tous.
« Le vrai sage, écrira-t-il dans Recherches sur la justice en politique et sur son influence sur la vertu et le bonheur de tous, ne recherche que le bien-être universel. Ni égoïsme, ni ambition ne le poussent, ni la recherche des honneurs, ni celle de la gloire. Il ne connaît pas la jalousie. Ce qui lui ravit le repos de l’âme, c’est le fait de considérer ce qu’il atteint relativement à ce qu’il a à atteindre et non à ce que les autres ont atteint.
« Mais le bien est un but absolu ; s’il est accompli par quelqu’un d’autre, le sage n’en est pas déçu. Il considère chacun comme un collaborateur, personne comme un rival » (page 361).
Pour réaliser ce changement qui sera le bien-être de tous, W. Godwin veut convaincre les hommes et il pense que tout autre moyen doit être rejeté.
« La force des armes sera toujours suspecte à notre entendement, car les deux partis peuvent l’utiliser avec la même chance de succès. C’est pourquoi il nous faut abhorrer la force. En descendant dans l’arène, nous quittons le sûr terrain de la vérité et nous abandonnons le résultat au caprice et au hasard. La phalange de la raison est invulnérable : elle avance à pas lents et sûrs et rien ne peut lui résister. Mais si nous laissons de côté nos thèses et si nous prenons les armes, notre situation change. Qui donc, au milieu du bruit et du tumulte de la guerre civile, peut présager du succès ou de l’insuccès de la cause ? Il faut donc bien distinguer entre instruction et excitation du peuple. Loin de nous l’irritation, la haine, la passion ; il nous faut la réflexion calme, le jugement sobre, la discussion loyale » (page 203).
Voici maintenant P.-J. Proudhon, considéré par beaucoup comme le père de l’anarchisme. Qu’écrit-il dans son livre De la Justice ?
« Se faire justice à soi-même et par l’effusion du sang est une extrémité qui existe peut-être chez les Californiens, rassemblés d’hier pour la recherche de l’or, mais dont la fortune de la France nous préserve » (page 466).
Et il ajoute :
« Malgré les violences dont nous sommes témoins, je ne crois pas que la liberté ait besoin désormais, pour revendiquer ses droits et venger ses outrages, d’employer la force, la raison nous servira mieux ; la patience, comme la Révolution, est invincible ! » (pages 470 – 471).
L’auteur de L’Unique et sa propriété, l’individualiste Max Stirner, n’a pas hésité d’affirmer, avec beaucoup de pertinence, que la loi suprême pour chacun de nous est le bien-être individuel. Pour y arriver, la transformation intérieure de l’individu est la condition sine qua non. Il ne nie pas la valeur de la force puisqu’il la trouve une belle chose, utile dans bien des cas, et il écrit : « On va plus loin avec une main pleine de force qu’avec un sac plein de droit. » Sans doute, mais encore y aurait-il lieu de préciser ce que Stirner entend par force, cette force au-dessus des lois qui semble effrayer tant de gens légaux, car le stirnérisme est l’irrespect même de tout ce qui est droit et État.
Restons en compagnie des individualistes anarchistes, et voyons ce qu’ils ont écrit sur la violence et la non-violence afin que chacun puisse ainsi se faire une idée d’ensemble de ce que les anarchistes de toutes les écoles, de toutes tendances ont formulé sur la violence.
Benjamin R. Tucker n’hésite pas à affirmer que la violence se justifie si la liberté de parole et celle de la presse sont supprimées ; mais il ajoutera qu’«il ne faut user de la violence que dans des cas extrêmes ». La révolution sociale, il l’entrevoit par l’opposition d’une résistance passive, ce qu’il appelle plus communément le refus d’obéissance.
« La résistance passive est l’arme la plus puissante que l’homme ait jamais maniée dans la lutte contre la tyrannie. »
Plus loin il dira, entre autres choses : « La violence vit de rapines, elle meurt si ses victimes ne se laissent plus dérober. »
André Lorulot, dans les Théories anarchistes, écrit : « Ce n’est pas en violentant et en frappant les hommes que nous voulons affranchir, que ce but rénovateur sera atteint. Ils croiront davantage au contraire à la nécessité du despotisme et approuveront toutes les entreprises liberticides dirigées par des meneurs d’hommes contre les indisciplinés. »
Cependant il ajoutait :
« Il est impossible de blâmer et de juger qui que ce soit, car la lutte est souvent une nécessité douloureuse. Qu’elle soit cela, puisque l’heure n’est pas encore venue où les choses vont se modifier. Frappez, mais n’en faites pas un système, ni un principe. Frappez, quand c’est utile et quand vous ne pouvez pas l’éviter, partisans de la vie libre et de la rénovation humaine. Regrettons toujours d’en venir à cette nécessité et n’oublions pas que la haine injustifiée ne peut que contrarier l’oeuvre des pionniers de l’harmonie sociale » (page 241).
E. Armand, dans son Initiation individualiste anarchiste, abordant le geste révolutionnaire et l’esprit de révolte, montre ce qui différencie l’individualisme antiautoritaire de l’organisation révolutionnaire, l’acte de l’individu et celui des manifestations révolutionnaires, émeutes ou guerres civiles. L’individualiste veut savoir pour qui et pour quoi il marche. S’il ne nourrit pas une hostilité préjudiciable contre la force, « ce n’est pas à la force qu’il en a, c’est à l’autorité, à la contrainte, à l’obligation, dont la violence est un aspect, ce qui est tout différent » (page 117).
Stephen T. Byington, anarchiste individualiste cité par E. Armand au chapitre XI du livre précité, a exprimé ces pensées au sujet de la violence :
« Employer la menace ou la violence contre quelqu’un de paisible, c’est ainsi qu’agissent les gouvernements et c’est un crime mais employer la violence contre un criminel, pour réprimer son usage criminel de la violence, est tout autre chose. D’une façon générale les anarchistes considèrent la spoliation et la fraude brutale comme équivalentes à la violence et justifiant de violentes représailles. »
Stephen T. Byington poursuit son exposé en montrant que la violence contre les personnes paisibles est contraire aux principes de l’anarchisme et il affirme que l’anarchiste qui y a recours ne connaît rien à l’anarchisme.
« Mais jamais cet emploi de la violence n’a été préconisé par les principes anarchistes, car il n’est pas un seul anarchiste qui se sente obligé de répondre à la violence par la violence sauf s’il y voit une utilité quelconque. »
Point n’est besoin d’invoquer Tolstoï, l’apôtre de la non-violence par excellence, et qui, incontestablement, a développé dans la partie philosophique de son œuvre, un idéal essentiellement anarchiste. S’il n’appelle pas anarchisme sa doctrine sur le droit, l’État et la propriété, il la considère comme devant être une vie libérée de toute emprise gouvernementale.
Tolstoï répudie la violence comme moyen et la dénonce même comme contraire à toute possibilité de libération.
« Il y a des hommes qui prétendent que la disparition de la violence ou du moins sa diminution pourrait s’effectuer si les opprimés secouaient violemment le gouvernement qui les opprime, et quelques uns d’entre eux agissent même de cette façon. Mais ils se trompent comme ceux qui les écoutent, leur activité ne fait que renforcer le despotisme des gouvernements et ces essais de libération sont à ceux-ci un prétexte favorable à l’augmentation de leur puissance. »
L’ensemble des théoriciens anarchistes qui ont écrit sur la violence reconnaissent qu’elle n’a rien à voir avec les principes mêmes de l’anarchisme. Certains reconnaissent qu’elle peut ou doit être utilisée dans la lutte libératrice comme moyen d’action, sans jamais en faire on principe intangible.
Errico Malatesta, cet indomptable militant, écrivit jadis :
« La violence n’est que trop nécessaire pour résister à la violence adverse et nous devons la prêcher et la préparer si nous ne voulons pas que les conditions actuelles d’esclavage déguisé où se trouve la grande majorité de l’humanité persistent et empirent. Mais elle contient en elle-même le péril de transformer la révolution en une mêlée brutale, sans lumière d’idéal et sans possibilité de résultats bienfaisants. C’est pourquoi il faut insister sur les buts moraux du mouvement et sur la nécessité, sur le devoir de contenir la violence dans les limites de la stricte nécessité.
« Nous ne disons pas que la violence est bonne quand c’est nous qui l’employons et mauvaise quand les autres l’emploient contre nous. Nous disons que la violence est justifiable, est bonne, est morale, est un devoir quand elle est employée pour la défense de soi-même et des autres contre les prétentions des violents et qu’elle est mauvaise, qu’elle est « immorale » si elle sert à violer la liberté d’autrui.
« Nous considérons que la violence est une nécessité et un devoir pour la défense, mais pour la seule défense. Naturellement, il ne s’agit pas seulement de la défense contre l’attaque matérielle directe, immédiate, mais contre toutes les institutions qui par la violence tiennent les hommes en esclavage.
« Nous sommes contre le fascisme et nous voudrions qu’on le vainquît en opposant à ses violences de plus grandes violences. Et nous sommes avant tout contre tout gouvernement qui est la violence permanente.
« Mais notre violence doit être résistance d’hommes contre des brutes et non lutte féroce de bêtes contre des bêtes.
« Toute la violence nécessaire pour vaincre, mais rien de plus ni de pis. » (Le Réveil de Genève, n° 602.)
Sébastien Faure, dans son article, Il y a violence et… violence. (Libertaire du 21 octobre 1937), étayait la justification d’une certaine violence qu’il rattachait en tant qu’anarchiste au cas de légitime, défense.
Son article n’était autre que la réponse faite jadis à F. Elosu (La Revue anarchiste, novembre 1922), où, là aussi, il citait un texte d’André Colomer au sujet de la justification d’une certaine violence.
« Si la violence devait seulement. nous servir à repousser la violence, si nous ne devions pas lui assigner des buts positifs, autant vaudrait renoncer à participer en anarchiste au mouvement social ; autant vaudrait, se livrer à sa besogne d’éducationniste ou se rallier aux principes autoritaires d’une période transitoire. Car je ne confonds pas la violence anarchiste avec la force publique. La violence anarchiste ne se justifie pas par un droit ; elle ne crée pas de lois ; elle ne condamne pas juridiquement ; elle n’a pas de représentants réguliers ; elle n’est exercée ni par des agents ni par des commissaires, fussent-ils du peuple ; elle ne se fait pas respecter ni dans les écoles, ni par les tribunaux ; elle ne s’établit pas, elle se déchaîne ; elle n’arrête pas la Révolution, elle la fait marcher sans cesse, elle ne défend pas la société contre les attaques de l’individu ; elle est l’acte de l’individu affirmant sa volonté de vivre dans le bien-être, dans la liberté. »
Mon intention n’est pas de polémiquer, mais d’exposer sans prétendre voguer sur les nuages de l’absolu.
Je concède, volontiers, qu’il est délicat de rejeter dans son intégralité la violence, mais force m’est de constater que chez certains anarchistes partisans de la violence on veut la limiter, lui assigner une tâche toute spéciale, momentanée, car tous reconnaissent la parenté de cette violence avec l’autorité.
Ces considérations s’expliquent, se justifient, puisque la violence gouvernementale ou étatique incarne l’autorité dont je combats la persistance. Nul ne peut prévoir dans l’évolution des choses ce que sera cette libération que certains supposent violente et d’autres pacifique.
La synthèse évolution-révolution, jadis entrevue par Élisée Reclus la fin de son livre L’Évolution, la révolution et l’idéal anarchique, peut se réaliser à l’encontre de bien des prophéties.
«… Cette vie dans un organisme sain, celui d’un homme ou celui d’un monde, n’est pas chose impossible et puisqu’il s’est avéré en théorie que la violence ne saurait être érigée en principe, l’effort anarchiste peut consister en tout lieu et cause à n’utiliser cette violence que dans certains buts, jusqu’à certaines limites, voire dans quel esprit. Cette violence anarchiste, Sébastien Faure la reconnaît, et il veut en indiquer la nature, les nécessités des luttes engagées, l’inébranlable déterminisme qui en fait l’obligation de l’envisager comme une fatalité regrettable, mais inéluctable. »
Je le redis une fois de plus, ce qui a été fatalité inéluctable hier peut ne plus l’être demain. Les nécessités de réalisation d’un idéal peuvent faire envisager d’autres moyens de lutte que ceux employés jusqu’ici, et, en ce domaine, il serait puéril de rester conservateur d’une technique qui s’avérerait impuissante face à l’évolution de nouvelles méthodes de répression.
C’est ce que mon ami Barthélemy de Ligt avait réalisé déjà. Anarchiste, il avait entrevu, après la guerre civile d’Espagne, les effroyables hécatombes que nécessiteraient les luttes pour la libération humaine.
Nous avions eu ensemble nombre de conversations, surtout après mon retour d’Espagne et utilisant de son mieux l’apport de cette expérience, il consigna dans une brochure, Le Problème de la guerre civile, ce que lui inspiraient les besoins et les méthodes de lutte de l’heure.
Voici ce qu’il écrivait :
« La violence est partie intégrante du capitalisme, de l’impérialisme et du colonialisme, et ceux-ci sont par leur nature même violents, tout comme la brume par sa nature est humide. L’exploitation et l’oppression de classes et de races, la concurrence internationale pour les matières premières, etc., ne sont possibles que par l’application systématique d’une violence toujours croissante. Éliminez la violence, et toute la structure sociale actuelle s’effondrera. D’autre part, nous pouvons dire en toute sûreté, que plus la violence est employée dans la lutte de classes révolutionnaire, moins cette dernière a de chances d’arriver à un succès réel.
« Nous acceptons la lutte pour un nouvel ordre social. Nous acceptons la lutte de classes pour autant qu’elle soit une lutte pour la justice et la liberté, et qu’elle soit menée selon des méthodes réellement humaines. Nous participons énergiquement au mouvement d’émancipation de tous les hommes et groupes opprimés. Mais nous essayons d’y introduire et d’y appliquer des méthodes de lutte en accord avec notre but. Parce que nous savons par d’amères expériences personnelles aussi bien que sociales, que lorsque dans n’importe quel domaine nous faisons usage des moyens qui sont essentiellement en contradiction avec le but poursuivi, ces moyens nous détournerons inévitablement de celui-ci, même s’ils sont appliqués avec la meilleure. intention. »
Il nous restera à rechercher quelles seront les méthodes qui pourraient remplacer avec efficacité la lutte nécessaire et indispensable pour le renversement de l’iniquité sociale présente, méthode pacifistes et non violentes qui liquideraient la guerre, toutes les guerres.
Hem Day