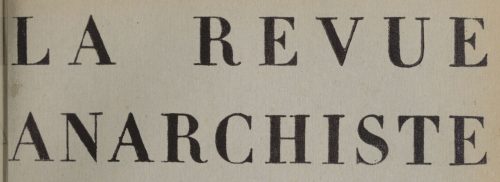« Tu t’appelles libre ? Es-tu quelqu’un qui avait le droit de s’échapper d’un joug ? Il y en a qui perdent leur dernière valeur en quittant leur sujétion… Peux-tu te fixer à toi-même ton bien et ton mal et suspendre ta volonté au-dessus de toi comme une loi?…»
Nietzsche.
Les Sociétés, comme la nature, ont horreur de l’individu. Toutes les lois physiques, physiologiques, juridiques, morales, sociales sont faites contre lui. Et la vie elle-même, la vie organisée et indéfiniment bourgeonnante, n’est que l’histoire de combinaisons complexes et ennemies qui s’efforcent toutes, en même temps, de réaliser et de dissoudre des individus. Ces lois complexes des phénomènes physiques et chimiques, qui s’appellent l’association, la combinaison, la synthèse ne sont que des armes permanentes que la vie emploie contre des individus qui pourraient se constituer.
À l’intérieur même de notre organisme, quand des cellules s’insurgent, échappent au rythme ordonnateur, s’individualisent, la science — du moins dans son état actuel — prononce le mot de : cancer.
L’individu serait-il un accident biologique ?
L’individualisme serait-il une sorte de cancer social ? Un cancer social dont tous les corps constitués et les Morales et les Lois chercheraient, par une thérapeutique préventive (qui s’appelle l’éducation, l’instruction, la culture) à affaiblir l’existence et l’action ?
Et une étude du XXe siècle par rapport à l’individu nous permettra-t-elle, à la fois de répondre à cette question et de savoir si les progrès du corps social, si l’emprise grandissante de la Science sur les forces et masses physiques favorisent ou restreignent le développement des individus ?
C’est ce que nous allons rechercher.
— O —
Il serait évidemment injuste, et en grande partie inexact, de dire : Le XIXe siècle, ou le XVIe siècle, ou le XIIIe ont été plus favorables à l’individu que le vingtième. Si, d’une part, certains liens, plus mous de l’organisation sociale semblaient, en une certaine mesure, favoriser l’essor et les libertés de quelques individualités fortes, la solide emprise mentale que les religions faisaient peser sur tous les esprits annihilaient les efforts d’une individualité en instance d’évasion. Quand on lit les Essais d’un Montaigne, la biographie d’un Descartes on est comme honteux des supercheries et des mille petites lâchetés quotidiennes dont ces esprits libres étaient contraints de s’envelopper pour sauvegarder leur liberté civile et sociale. Et c’est en se contraignant à vivre aussi simplement qu’un yoghi hindou que le grand Spinosa a dû la méprisante liberté qui lui a permis d’ébranler le monde moral et mental et de tirer du système cartésien les conséquences révolutionnaires que l’auteur du Discours de la Méthode, par amour de la paix — et de sa peau — semblait se dissimuler à lui-même. Ne les blâmons pas. Ces hommes portaient sur eux, en eux, des bombes autrement dangereuses et efficaces que celles avec lesquelles certains s’imaginèrent, voici trente ans, changer l’aspect et modifier les lois du monde social…
Mais si nous n’admettons pas cet éloge sans fondement des siècles morts, nous pouvons noter, cependant, que les progrès de la civilisation sont toujours des progrès contre l’individu, au bénéfice de la pluralité.
En arriverions-nous, ainsi, sur les traces de J.-J. Rousseau et de certains de ses disciples, à faire une sorte d’éloge de la vie sauvage, à croire qu’en simplifiant graduellement et en faisant disparaître le milieu social et mental qui nous sert de gangue, les individus parviendront à se réaliser et à s’affirmer avec une croissante liberté ? Non.
La vie sauvage est l’oppression et la dispersion, l’absorption de l’individu par la nature. La vie sociale, créée par des individus agglomérés organise l’oppression graduelle de l’individu par la collectivité. La vie sauvage par ses conditions mêmes, organise une oppression encore plus grande, et l’individu, enserré par le rets indéfiniment multiplié des exigences matérielles, n’a guère le temps, comme Robinson dans son île, que d’organiser chaque jour sa lutte pour la vie et pour la subsistance.
La vie sociale, par les mille facilités qu’elle crée et organise, libère évidemment l’individu d’un certain nombre de ces soucis élémentaires qui émiettent une personnalité. Elle lui permet de se concevoir comme type. Elle lui permet de se dire, comme Montaigne : « J’emporte partout ma solitude avec moi ». Elle ne lui permet guère de se réaliser comme être, l’existence de l’individu allant à l’encontre de la plupart des exigences du contrat social, qui se formule, vous le savez bien, par la vieille et hypocrite rengaine : « Tous pour un, un pour tous ». Alors que la maxime de l’individualisme, formulée par le même Montaigne, pourrait être, en partie, contenue dans la phrase fameuse : « C’est une absolue perfection, et comme divine, de jouir loyalement de son être ». Or, la vie sociale, la vie du corps social organisé, implique l’idée que cette jouissance loyale lèse ses intérêts, ses lois, déchire l’hypothèque qu’elle se croit en droit de prendre sur tous ceux qui sont enserrés dans la gangue des sociétés organisées.
En d’autres termes, si l’individu a besoin de la Société pour ne pas disperser son activité en mille besognes matérielles qui émettent et annihilent son individualité, la société ne peut considérer l’individu (en tant qu’individu) que comme un accident et tend, par tous les moyens directs ou indirects dont elle dispose, à ramener l’individu au rang d’élément social, de cellule sociale.
Il suffit, du reste, de définir clairement ce que l’on peut entendre par individu pour préciser cet état de choses.
— O —
Le mot individu soulève, en effet, le plus gros problème non seulement de la biologie et des Sciences naturelles, mais aussi de la philosophie et de la métaphysique.
Un individu, affirme le dictionnaire, se dit de chaque être organisé, soit animal, soit végétal, par rapport à l’espèce à laquelle il appartient.
« L’individualité est ce qui fait qu’un être est tel être et qu’il a une existence distincte des autres êtres ».
Or, combien d’hommes, s’ils ont conquis la dignité de pouvoir faire au moins un impartial et impitoyable examen de conscience, combien d’humains peuvent se targuer d’avoir vraiment une existence distincte et autonome, de n’être pas seulement des aspects, des cas répétés de genres et d’espèces?…
Je dirai, à titre de remarque, d’illustration — et il n’entre, certes, nulle intention d’ironie dans cette observation un peu mélancolique — je dirai que ceux-là même qui font profession d’individualisme doctrinaire croient trop souvent devoir, par leur mise extérieure, par le choix de leurs vêtements, et la coupe de leurs cheveux, par l’aspect même de ce que les Latins appelaient habitus, manifester qu’ils portent l’uniforme d’individualiste ; tout comme d’autres portent celui d’artiste, d’intellectuel, d’universitaire, voire d’agent de la contrainte sociale.
Il ne s’agit pas, au demeurant, de blâmer ce quasi instinctif enfantillage ; nous cherchons à étudier, objectivement, sans passion, les caractères et caractéristiques de l’individu, comme nous étudierions, loupe en main, les caractéristiques d’une feuille, d’une fleur, d’une racine… Mais cette objectivité même dans la recherche et dans le jugement, pour simple et aisée qu’elle puisse sembler, est une des vertus les plus difficiles que le chercheur doive acquérir et conserver. Les hommes en route vers le douloureux affranchissement, eux-mêmes, n’aiment guère à se voir démontrer que, s’ils échappent au grégarisme collectif c’est pour devenir la proie orgueilleuse de petits grégarismes parcellaires, que, s’ils n’ont pas choisi le milieu social qui les a sécrétés et qui les conditionne, ils se sont immédiatement englués dans un autre milieu, enrobés dans d’autres préjugés, que l’individu qui se cherchait, fier de son travestissement oublie de continuer sa route, comme le Roger de l’Arioste oubliait chez Alcine la dure et féerique entreprise qu’il avait assignée à sa vaillance…
Mais il ne faudrait pas, de ces constatations nécessaires et qu’une conscience brave doit examiner sans hypocrisie, faire une raison de désespérer et de ne pas progresser sur la route qui permet à l’individu de se réaliser, de s’affranchir dans la mesure où les lois de la vie tolèrent cet affranchissement, car tout ce qui vit tend et s’efforce vers l’individualité, depuis l’arbre qui brise la pierre qui le porte jusqu’à l’homme qui brise les traditions et les règles du milieu mental et social dans lequel il est plongé. Or, s’il semble impossible d’enfreindre certaines lois organiques est-il aussi fatalement interdit de refondre certaines lois mentales et sociales ? Et cette science dont le XIXe siècle fut si fier concourt-elle, peut-elle concourir à l’affranchissement de l’individu, en le dotant d’un impressionnant empire sur la matière, et de sens si prolongés et si perfectionnés qu’il finirait par ressembler à ces hommes-dieux que Wells a imaginés dans son Mr. Barnstaple ?
— O —
La science appliquée, dont l’industrie exploite et concrétise les découvertes, est l’art de doter l’homme d’organes adventices, de sens artificiels qui lui permettent d’amplifier son action sur le monde matériel. La télégraphie, la T. S. F., le téléphone ne sont rien autre chose que la prolongation des organes de la parole et du son ; l’automobile, l’avion nous dotent d’une rapidité sur le sol ou dans l’air dont nos organes propres sont incapables. La machine prolonge et multiplie nos sens, nos nerfs, nos muscles ; c’est encore de l’homme, en fer ou en ondes ; elle lui donne le pouvoir de déplacer ou de modifier des masses et des forces que ses organes normaux, ne pourraient ébranler.
Ainsi, l’homme nu et désarmé des premiers âges, sans avoir acquis autre chose que le développement de ses organes, devient une sorte d’enchanteur dans le monde des phénomènes naturels et voit graduellement s’accroître son emprise physique sur le monde physique.
Ainsi il devient, par toutes ces forces dont il dispose, une sorte de géant pragmatique. Mais l’individu n’y gagne rien ; car, comme dans un conte symbolique de ce Wells dont nous parlions tout à l’heure, comme dans Place aux Géants, la Société ne saurait permettre que ces organes ainsi prolongés, amplifiés, que ces forces ainsi domptées soient mises à la disposition de l’individu. Elle qualifierait « révolte » ou « crime » l’acte par lequel des individus prétendraient conserver pour eux seuls une découverte susceptible d’augmenter la puissance de l’homme dans la prison de l’espace.
D’autre part, cette conquête progressive du monde matériel par la multiplication des machines, du machinisme, a nécessité une organisation industrielle, des sociétés humaines, a déterminé une ère industrielle, un âge industriel qui conditionne étroitement, non seulement des foules spécialisées dans la production, mais le milieu social tout entier. Les gouvernements, les états, les nations se sont développées, défaits, modifiés dans la mesure où le jeu du développement industriel l’exigeait.
Des guerres ont explosé, des états ont changé de structure, des combinaisons ethniques se sont désagrégées parce que des mines de fer, de charbon, parce que des puits de pétrole, parce que des gisements de minéraux ou de métaux, parce que l’ouverture de nouveaux comptoirs ou le jeu pernicieux des Bourses exigeaient inexorablement ces modifications.
Des exemples ? Ils sont multiples et actuels.
C’est commandité par les grands industriels de la Péninsule et par les actionnaires américains qui avaient mis de l’argent chez ces industriels que le dictateur de l’Italie peut, en 1920, organiser son coup d’État, à l’heure même où les usines transalpines semblaient, en proclamant la dictature ouvrière, renverser tout le régime de l’oligarchie industrielle. Depuis, il semble qu’il n’y ait plus qu’un seul individu debout sur l’Italie sujette, alors que les puissants intérêts économiques qui ont subventionné son aventure peuvent, d’un seul coup, briser leur fondé de pouvoir, le jour où son omnipotence leur semblera inutile ou nuisible.
Mais si la dictature monarchique ainsi concédée et appointée par les entreprises industrielles ne semble tolérer, dans le pays, aucune velléité individualiste, la dictature des masses réunies et agglomérées par les exigences de l’industrie, la « dictature du prolétariat », ne tolère pas davantage des libertés de l’individu.
Car fascisme et soviétisme n’auraient pu se produire dans un monde sans machines et sans industrialisme et n’ont aucun rapport avec les despotismes féodaux et militaires des siècles passés.
La dictature est l’aboutissement logique des civilisations industrielles. Pour ne point porter ce titre, l’oppression de l’individu aux États-Unis et dans la soi-disant « libre Angleterre » est aussi lourde que dans les empires de la faucille ou du faisceau.
Ainsi le XXe siècle industriel, pour avoir voulu doter l’homme de sens et d’organes perfectionnés et quasi-surhumains, a fait s’appesantir sur les individus une servitude plus irrémédiable que celle imposée par la nature aux Sociétés primitives.
Et les individus qui voudraient briser de tels jougs ne pourraient le faire qu’en s’agrégeant entre eux, et qu’en s’imposant ainsi une autre servitude collective, librement voulue, sans doute, mais aussi négatrice des espoirs individualistes.
Dans cette étude sommaire, dans cet aperçu à vol d’oiseau, je ne puis, certes qu’esquisser les éléments d’un thème qui demanderait un lourd volume pour être traité avec toute l’extension qu’il comporte.
Mais, de l’examen même des sociétés industrielles actuellement organisées — pour des raisons géographiques, historiques, ethniques — en nations, il ressort que le XXe siècle, au fur et à mesure qu’il semblait amplifier l’emprise de l’homme sur la matière, restreignait les possibilités d’évasion, d’épanouissement de l’individu.
— O —
Est-ce à dire que tout espoir soit interdit de voir se développer l’être individuel ? Que sous l’inexorable nécessité sociale l’individu ne soit plus qu’un prisonnier sans espoir ?
Non.
L’histoire même de la pensée humaine contredirait cette anticipation désolante : elle nous rappelle que, si l’individu est étroitement captif dans le milieu matériel, il possède, dans le monde spirituel, mental, un domaine propre. Ce domaine il peut, dès maintenant, le rendre autonome, inaccessible et, grâce à lui, entrevoir, pour des temps sociaux futurs, entièrement différents des nôtres, les possibilités les plus magnifiques.
Mais une erreur commune est de confondre l’unité humaine et l’individu humain, de croire qu’il y a autant d’individus qu’il y a d’hommes, alors que le don d’individualité, comme le génie musical, scientifique, philosophique, est une chose rare, avarement départie. Notre erreur est de vouloir doter l’individu de déguisements et de fantômes, sans rechercher ce qui fait son originalité et son unité spécifique. Notre erreur est de nous prétendre individualistes et de n’avoir ni la force, ni le courage, ni la patience de nous entraîner à être des individus ; de croire que l’on apprend sans effort à être un individu, alors qu’il faut une tenace gymnastique, pour apprendre le jeu du pianiste, du cycliste, du dactylographe…
C’est cette étude qu’il nous sera peut-être donné de poursuivre de compagnie, au cours de ces chapitres sincères, de ce monologue libre, que, face à ma raison, j’ai essayé de proférer, pour les quelques individus qui se cherchent, en soulevant désespérément l’énorme masse mentale et sociale qui pèse sur eux et qui les tient…
Ganz-Allein