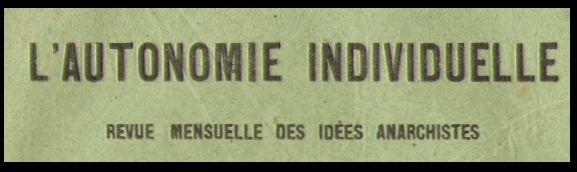La science économique doit être considérée comme une des parties de la science sociale nécessaire au progrès du bien-être de l’humanité. Cette science, déterminant les lois de la production et de la consommation par la méthode expérimentale, qui n’admet pour vrais que les faits dont l’observation ou l’expérience ont démontré la réalité, n’est pas à contester.
Ce qui est contestable, c’est l’Économisme, cette religion du hasard, qui établit sur des circonstances transitoires des principes permanents et qui fait découler de ces principes la science économique aux lois naturelles immobiles et aux phénomènes immodifiables.
Les philosophes, et après eux les économistes, ont considéré une nation comme une collection d’hommes qui, se distinguant par une communauté d’origine, vivent en société. La sociabilité étant un trait caractéristique de l’espèce, l’individu devient une abstraction comme corrélatif à la réalité de la société, d’où découlent des lois qui sont l’expression des rapports. Certains d’entre eux ont été considérés par l’économie politique comme des lois naturelles qu’elle a eu pour but de déterminer en traitant de la nature, de la formation, de la consommation et de la distribution des richesses des nations.
Par richesses, les économistes entendent ce qui provient des biens naturels transformés par le travail en choses utiles qui, directement ou indirectement, produisent du plaisir ou empêchent de la peine. Ils assignent donc comme but : de créer des utilités pour satisfaire les besoins, tout en produisant plus avec le moins de travail possible.
La production des richesses s’obtient par la terre, le travail et le capital, appelés instruments de production, en appliquant le travail à la terre et en employant le capital à assister le travailleur.
La terre est considérée comme la source des matériaux. La terre (ou la mer), en plus de la matière et des produits qu’elle donne, est également un agent naturel en diminuant la peine ou l’effort des travailleurs.
Le travail est tout exercice mental ou physique que font les hommes pour s’approprier les choses qui les entourent ; – par suite, dans les meilleures conditions : par la science, ou connaissance de la cause des choses, par la division du travail, ou organisation simple ou complexe du travail.
Le capital est la réserve nécessaire, sinon pour travailler mieux, du moins pour travailler plus économiquement et avec succès. Considéré comme du travail accumulé par l’épargne, il se divise en : capital fixe, ce qui doit durer sous forme d’outils, de machines, d’ateliers, de matières premières devant servir à la reproduction ; – capital circulant, ce qui consiste en nourriture, vêtements, combustible choses nécessaires pour soutenir le travailleur pendant qu’il est à l’œuvre.
La richesse est distribuée entre la terre, le travail et le capital. Si une seule personne réunit ces trois instruments de production, elle obtient la totalité, et s’il y a deux ou trois personnes, le partage s’effectue en deux ou trois parts, non d’une façon égale, mais selon certaines lois suivant lesquelles la distribution a lieu.
La part des possesseurs de la terre, pour l’usage d’un agent naturel, se désigne par rente ; celle des capitalistes, pour l’apport de leur capital, consiste en prélèvement sur le produit terminé et livré, s’appelle intérêt ; celle des travailleurs, pour ce qui paie réellement la peine du travail, se nomme salaire, dont le taux est fixé selon les lois de l’offre et de la demande qui en déterminent la valeur1L’économie politique dont nous indiquons ici très sommairement les points généraux, sera reprise dans chacune de ses parties : le Capital, le Salaire, l’Offre et la Demande, la Valeur, L’Échange, etc., qui feront l’objet d’études sociales traitées successivement traitées dans nos prochains numéros..
Préoccupé, exclusivement de la richesse, l’économisme, qui justifie et consacre la féodalité capitaliste, traite :
De la richesse dans l’intérêt des individus et de la société, – en admettant que le plus grand nombre manque du nécessaire pour permettre à quelques-uns de posséder le superflu ; de la production et de la distribution des richesses, – en acceptant que le produit revienne à des oisifs dans sa presque totalité, sous forme d’intérêts, de rentes, et ce, au détriment des producteurs dont la minime part est le salaire, c’est-à-dire le strict nécessaire permettant la conservation et la reproduction de l’espèce ; de la consommation des richesses, – en justifiant le famélisme de milliers d’individus pour quelques-uns crevant de pléthore.
Les principes qui ont inspiré les économistes semblent être ceux émis par Aristote dans son livre La Politique, que l’on peut considérer comme résumant toute la science économique jusqu’au XVIIIe siècle : « La Nature a créé certains êtres pour commander et d’autres pour obéir. C’est elle qui a voulu que l’être doué de prévoyance commandât en maître, et que l’être capable, par ses facultés corporelles, d’exécuter des ordres, obéit en esclave, et c’est par là que l’intérêt du maître et celui de l’esclave se confondent ». Certains termes changés, le fond est toujours le même et, en plus, avec le but d’établir scientifiquement des lois qui président et concourent à l’organisation du vol, de la spoliation, de l’exploitation de l’homme par l’homme.
L’économie politique, comme science, ne date que du siècle dernier, avec les physiocrates Quesnay, Turgot, Gournay qui le premier émit le fameux Laissez faire, laissez passer. Quesnay, le fondateur de la nouvelle école économique, cherche à établir une science d’après les lois naturelles et constantes qui régissent les sociétés humaines où « l’autorité souveraine doit être unique et supérieure à tous les individus de la société ». Son système économique consiste dans une division de la nation en trois classes : la classe productive, tous ceux qui se consacrent à l’agriculture ; la classe des propriétaires, tous ceux qui vivent de la rente ou du produit net de la terre ; la classe stérile, les industriels, commerçants, domestiques qui n’augmentent pas la richesse de la nation. Il fait supporter tous les frais du gouvernement à l’agriculture, comme étant la seule source de richesse de la nation.
Mais la science économique ne trouve son réel développement que dans le livre ; paru en 1776, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, par Adam Smith2Orthographié « Adam Schmith » dans le texte original, (note du site internet La-presse-anarchiste). Le premier, il explique les principes fondamentaux de l’économie politique, il découvre la puissance créatrice du travail comme source principale de la richesse, il décrit la division du travail et en déduit les avantages, il constate le rôle utile des machines, toutefois sans en prévoir toute la force accélératrice ni les résultats. Bien qu’établissant la nécessité du haut salaire, il est partisan du statu quo régi par les lois de l’offre et de la demande.
Les idées et les principes d’Adam Smith sont continués par Malthus qui, ajoutant une théorie sur la population, représente la misère comme une fatalité inévitable. Il considère la force d’une nation, non pas sur la quantité des habitants, mais par le rapport de la population à la quantité d’aliments disponibles il en fait résulter la nécessité de mettre un obstacle à l’augmentation de la population qui tend à s’accroître en raison géométrique, tandis que les subsistances ne s’accroissent qu’en raison arithmétique.
Toutes ces théories sont reprises par Ricardo qui en élargit le champ par ses déductions logiques et rigoureuses. Il constate l’opposition des intérêts antagonistes dans une nouvelle théorie de la rente, à laquelle il donne pour principe fondamental que la propriété doit se vendre ou se louer d’autant plus cher qu’elle rapporte davantage, et, que le prix des marchandises se fonde sur la quantité de travail qu’elles exigent.
Jusqu’ici, c’est l’ancienne méthode métaphysique basée sur des abstractions, J.-B. Say y substitue la méthode expérimentale ou d’observation, en déterminant plus exactement la science économique qu’il popularise en France, par une certaine clarté dans ses définitions devenues plus précises. Mais il incarne en lui le dogmatisme économique bourgeois en représentant le capital comme du travail accumulé par l’épargne et comme la source unique de la richesse, en prescrivant le minimum de salaire à accorder aux travailleurs.
Les autres économistes, les épigones Senier, Mac Culloch, G. Garnier, Dunoyer, Ch. Comte, Baudrillart, Carey, ne font que s’inspirer des quatre pères du nouvel évangile bourgeois et, à part quelques surenchérissements dans des définitions souvent féroces, ils n’apportent ni découvertes ni changements à l’économisme. Les interventionnistes Sismondi, Droz, Adolphe Blanqui, Ramon de la Sagra, de Laveleye, J.-S. Mill, sans changer les principes fondamentaux de l’économie politique, font cependant certaines critiques à l’orthodoxie économique, sur la réalité et l’efficacité de ses résultats que celle-ci fait découler des lois dites naturelles et immuables. Ils représentent : que la science de la richesse ne saurait consister en ce que la grande masse sociale soit vouée à la misère pour que quelques-uns puissent s’enrichir, qu’il n’est pas nécessaire de soumettre le gouvernement des sociétés aux lois de la production, de la formation et de la consommation établies par les économistes, et que « la vieille économie politique est limitée et temporaire dans sa valeur, surtout lorsqu’elle admet que la propriété individuelle et l’héritage sont des faits inéluctables et que la liberté de production et d’échange est le dernier mot du progrès ».
Pour établir les lois économiques concordant avec les lois naturelles, pour en démontrer les développements, par l’analyse des causes et des effets qui gouvernent le monde économique, par la méthode, l’ordre, la clarté apportés dans les définitions, les économistes ont fourni de réels matériaux à la science sociale. Mais par l’usage et les résultats, ils ont démontré l’impuissance de leur système économique basé sur une division arbitraire de la production en deux groupes bien distincts : ceux qui font travailler et ceux qui travaillent.
Il ne pouvait en être autrement. Leurs systèmes devenaient l’expression de leur personnalité, ils s’incarnaient en eux les physiocrates, presque tous propriétaires, donnaient la priorité à la terre et J.-B. Say, qui avait passé par l’industrie et le commerce, la donnait au capital. De même les plus libéraux, ceux par exemple qui rejetaient toute intervention de l’État dans les rapports économiques : ils justifiaient les monopoles, ils consacraient une sorte d’exceptions pour certains individus qui, de par leur position, tendraient toujours à en abuser – et l’abus infirme toute idée de libéralisme.
Avec de réelles connaissances scientifiques, les économistes possédaient une somme égale de préjugés inhérents à une classe privilégiée. Aussi ont-ils été considérés comme les prêtres d’une nouvelle religion bourgeoise à établir en formulant la norme qui détermine des intérêts antagonistes. Dans leur dogmatique myopie, pour sauvegarder leurs privilèges, ils ont fait surgir le terrible problème afférent à la lutte des classes, dont la solution sera l’anéantissement de leurs spécieuses théories.
Comme privilégiés de la société, ils ont défendu l’omnipotence et les intérêts de leur classe en se donnant pour mission de justifier les inégalités sociales qui résultent de la naissance et de l’héritage, du trafic et de la spoliation, de sanctifier une société où la propriété est le droit d’user et d’abuser, ce droit étant réservé à des financiers, boursiers, agioteurs qui le transmettent à leurs descendants abâtardis avec des besoins plus grands, des vices raffinés, des goûts de lucre et d’oppression rendant l’iniquité sociale de plus en plus monstrueuse.
Julendré.
- 1L’économie politique dont nous indiquons ici très sommairement les points généraux, sera reprise dans chacune de ses parties : le Capital, le Salaire, l’Offre et la Demande, la Valeur, L’Échange, etc., qui feront l’objet d’études sociales traitées successivement traitées dans nos prochains numéros.
- 2Orthographié « Adam Schmith » dans le texte original, (note du site internet La-presse-anarchiste)