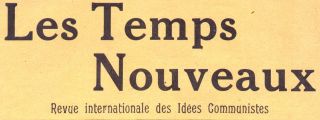« Je m’intéresse aux problèmes de la production, mais je ne puis le faire qu’en spectateur. Je crois qu’il va sortir des changements dans les méthodes agricoles : deux formules en présence, agriculture purement extensive ou agriculture intensive. Je pense que ce dernier mode conviendrait mieux à la France, qu’il faudrait exploiter comme un jardin, un vaste jardin. Cela n’exclut pas le machinisme perfectionné, bien au contraire ; mais il faudra un matériel très spécial, et, non pas celui que nous offre l’Amérique, et qui n’est adapté qu’à la culture purement extensive.
Quant à la production industrielle, il y aura des luttes internationales extraordinaires. Je crois que l’Europe (je ne parle pas de nous — pauvres de nous!) et l’Amérique, seront sérieusement handicapées dans la lutte avec le Japon. Ce pays s’est développé industriellement d’une façon incroyable pendant la guerre, à tel point que ses représentants commerciaux nous offrent maintenant des produits manufacturés, entre autres soieries, cotonnades, lainages, à un bon marché impossible à concurrencer, malgré les tarifs de douane.
Le Japon, s’il n’a pas les matières premières à discrétion, entre autres la houille, a une réserve de main-d’œuvre à un taux de salaires très bas. Le Japon n’a pas tous les besoins de l’ouvrier européen pas de vin, pas d’alcool, pas de viande, peu d’habillement, peu de logement, pas de dépense de chauffage, quelle que soit la rigueur de l’hiver, pas le luxe idiot de nos modes. Il faudra un temps considérable pour que ce peuple arrive à acquérir les mêmes besoins que nous.
D’un autre côté, comme armement industriel, un matériel neuf, perfectionné, avec un personnel dirigeant d’une haute compétence technique, une main-d’œuvre d’un grand rendement et d’une ingéniosité remarquable, une émulation exaltée par un chauvinisme exagéré. Tel est le redoutable adversaire que les vieilles nations vont trouver devant elles. Je serais curieux de connaître l’avis des hommes de la C.G.T. sur les difficultés de ce problème économique. Qu’ils ne pensent pas s’en tirer avec une formule simpliste, comme la fraternisation internationale de tous les salariés. Il y a déjà des barrières qu’il est difficile de faire tomber entre les travailleurs des diverses nationalités européennes ; que sera-ce donc avec ceux du Japon, qui n’ont ni la même formation intellectuelle et morale, ni les mêmes besoins, ni le même idéal, et qui probablement résoudraient le problème d’une tout autre façon. »
Dr L. M. L.
— O —
Je ne prétends pas répondre aux questions du Dr L. sur la concurrence japonaise. Je me permets simplement d’émettre quelques réflexions, sans d’ailleurs les rattacher directement ou logiquement à ce qui précède.
C’est le point de vue du consommateur qui me paraît devoir l’emporter. Le Japon n’a pas la prétention de pouvoir produire pour le monde entier, même en ne considérant que certaines catégories de produits fabriqués (soieries, cotonnades, lainages, etc.). Quant aux articles spéciaux où sa concurrence est écrasante, il sera tout à fait avantageux de lui laisser le monopole de la fabrication.
L’Angleterre ne s’est pas acharnée à fabriquer du sucre ; quand les autres nations européennes, et en premier lieu l’Allemagne, lui en fournissaient à un prix inférieur an prix de revient.
Il se produit ainsi une division du travail, et c’est tout bénéfice pour l’humanité, tout moins pour les acheteurs.
Au point de vue général, il y aurait tout intérêt à une meilleure, division du travail, si cette spécialisation était déterminée en premier lieu par la présence des matières premières sur place, en second lieu par l’existence de la force motrice (charbon, chutes d’eau). Mais, d’autres causes sont souvent intervenues pour modifier cet arrangement.
Par exemple, les pays producteurs de matières premières sont à un stade de civilisation primitive, et il est moins coûteux de transporter ces matières dans un pays pourvu de l’outillage nécessaire et possédant une main-d’œuvre éduquée. Une fois l’avance prise, un monopole de fait reste établi pour longtemps. Ainsi, le coton récolté dans l’Inde, et surtout aux États-Unis, était transporté en Angleterre pour être filé et tissé. Malgré la concurrence américaine grandissante, l’Angleterre reste le grand marché des cotonnades.
En France, un centre important de tissage de cotonnades se trouve à Roanne, où il n’y a ni force motrice, ni plantations de coton, ni même de filatures. Les filés viennent normalement du département du Nord, lequel reçoit le coton des États-Unis. Les tissages de coton se sont concentrés à Roanne, parce qu’il existait déjà dans les Cévennes des tissages de soierie (à la main), qui faisaient vivre la population pauvre de la montagne, et proche voisine des magnaneries de la vallée du Rhône. Le tissage du coton s’est installé là, à cause de la présence d’une main-d’œuvre déjà éduquée, facteur très important, si l’on réfléchit qu’il s’agissait primitivement du tissage à la main, où un apprentissage d’assez longue durée est indispensable. Enfin, après 1870, Roanne prit un grand développement, et sa bourgeoisie s’enrichit sans aucun mérite, à cause de la suppression de la concurrence faite par Mulhouse, qui fabriquait également des cotonnades de fantaisie.
Je donne ces exemples pour montrer la complexité du problème 1Il n’en est pas moins vrai que les nouvelles nations, les nations récemment nées à la vie économique moderne, ne sont pas empêtrées par ces vestiges du passé, vestiges historiques, de l’évolution économique. C’est un avantage dont ont joui les États-Unis, l’Allemagne, le Japon.. Une fois qu’une industrie s’est implantée en tel endroit, elle y jouit de certains avantages : main-d’œuvre éduquée, collaboration d’industries accessoires, d’ateliers de réparation, etc.
Pour le Japon, c’est surtout le bon marché de la main-d’œuvre qui a été le facteur le plus important dans l’essor de son industrie, au point de vue tout au moins de l’exportation. Mais les ouvriers japonais finiront par avoir des besoins, et par exprimer des exigences, peut-être plus vite que ne l’imagine le Dr, L. Alors, le Japon restera le maître du marché, seulement pour les articles où le bon marché de la main-d’œuvre n’aura pas été le seul facteur en cause.
Jusque-là, les consommateurs européens profiteront de la frugalité de l’ouvrier japonais. Les producteurs des autres pays n’auront qu’à s’abstenir d’essayer une concurrence ruineuse pour telles ou telles spécialités, à moins d’un immense progrès technique permettant de ne pas tenir grand compte des prix de main-d’œuvre.
Jusqu’ici, et j’arrive à des considérations plus générales, jusqu’ici, et encore aujourd’hui, et demain encore, jusqu’à ce que s’établisse dans le monde entier une équivalence plus ou moins approchée des conditions de vie, la civilisation de certains pays a été et est en partie fondée (mais le sera de moins en moins), sur la misère et le travail de pays à population plus résignée.
Je ne parle pas seulement de l’esclavage qui a été le fondement de la civilisation antique, y compris les loisirs des philosophes. Aristote a dit que l’esclavage disparaîtrait quand les machines marcheraient toutes seules. Le machinisme est venu, et le salariat, esclavage moderne, existe toujours, ce qui permet à notre bourgeoisie de jouir d’un confort agréable. Nous savons que dans un même pays il y a une classe de travailleurs et une classe de parasites. Mais, en dehors de cette exploitation directe, il existe un certain profit, un profit supplémentaire, prélevé sur les producteurs à besoins restreints.
Le salaire, en effet, représente ce qui est nécessaire aux travailleurs pour vivre, ou plutôt ce qu’il croit lui être nécessaire. Il en résulte déjà, dans ces mêmes pays, que la prospérité des villes est en partie fondée sur le labeur ingrat des campagnards, vivant de peu et privés de jouissances coûteuses. Ce contraste explique en partie (en partie seulement), le dépeuplement des campagnes. Mais un nouvel équilibre est en train de s’établir ; les paysans sont devenus plus exigeants.
La civilisation européenne s’est développée par le travail, mais aussi par l’exploitation des pays pauvres et des colonies. Les tapis d’Orient, par exemple, les cachemirs, etc., étaient achetés à très bas prix dans des pays où la vie est extrêmement simplifiée, où les besoins sont très peu développés. Je ne parle que pour mémoire de la conquête coloniale avec le pillage comme but ; les méfaits des conquistadors espagnols n’ont enrichi qu’une petite caste.
La méthode coloniale anglaise ou hollandaise est infiniment supérieure au profit ; elle permet d’exploiter régulièrement le pays en faisant travailler à bas prix, et d’une façon méthodique, des populations indigènes, dont on se garde de développer les besoins, et qu’on maintient dans l’ignorance.
À ce point de vue, le Japon peut être considéré comme un pays colonial, jouissant (si j’ose dire), d’un self governement.
En résumé, un pays fortement développé au point de vue économique, c’est-à-dire grand producteur de richesses, jouissant d’un change élevé, prélève encore un profit supplémentaire sur les pays où les besoins sont restés primitifs. C’est, en partie, parce que des indigènes se contentent d’un sac pour vêtement, que les femmes européennes peuvent mettre un corset. Cette réflexion pourrait en entraîner d’autres sur une simplification désirable de l’existence. Mais je ne partage pourtant pas les illusions de J.-J. Rousseau ; par exemple, c’est dans les pays où les besoins sont restés infimes que des famines se produisent encore, et que la mortalité infantile est constamment très élevée.
M.Pierrot
- 1Il n’en est pas moins vrai que les nouvelles nations, les nations récemment nées à la vie économique moderne, ne sont pas empêtrées par ces vestiges du passé, vestiges historiques, de l’évolution économique. C’est un avantage dont ont joui les États-Unis, l’Allemagne, le Japon.