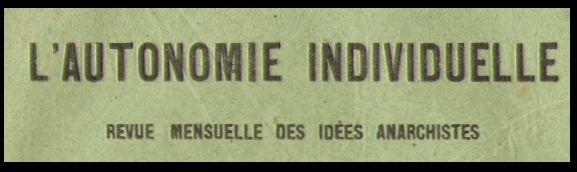Dans notre précédent article, nous avons décrit les divers développements de l’idée communiste et, dans ses antécédents, indiqué la source des théories et des systèmes. Nous continuerons par un rapide examen des hommes et des choses ainsi que des milieux d’où sont sorties les nouvelles théories que nous nous proposons d’analyser. De cet exposé ressortiront les causes d’indifférence ou d’engouement obtenu par certaines théories et, en même temps, se trouveront établies les phases successives du communisme se transformant en collectivisme, dernière forme du socialisme utopique.
Avant 1848, le communisme n’était pas encore entré dans les faits, il occupait les esprits, exerçait une certaine influence, sans cependant sortir des idées ou utopies sociales. Les théories sociales de St-Simon et de Fourier, sinon communistes, mais aussi utopiques, avaient brillé d’un vif éclat ; elles avaient rencontré, parmi la bourgeoisie éclairée, un grand nombre d’adhérents, sans pénétrer jusqu’au peuple. Les théories humanitaires ou icariennes, dans leur formule simpliste, séduisaient plus le peuple et convenaient mieux à ses besoins faits de sentiments. L’égalité allait devenir le grand principe au nom duquel devaient se soulever les opprimés, entrainés par des rêveurs au tempérament mystique, poussés par des sophistes politiques. La bourgeoisie clora le doctrinarisme perdait toute influence, allait retrouver dans l’industrialisme une nouvelle puissance — ses effets s’étaient fait sentir.
La Révolution de 1848 vint remplir tous les cœurs d’espérance, prenant un caractère social et presque européen par son influence ; le communisme y trouva un grand appui. L. Blanc et F. Vidal, appuyés par le peuple, faisaient admettre par le gouvernement provisoire des systèmes sociaux qui étaient discutés au Luxembourg et expérimentés par les Ateliers nationaux. Le mauvais vouloir et l’impéritie des gouvernants firent échouer une tentative d’organisation du travail dont les résultats montrèrent l’inanité. Du reste, ces ateliers n’avaient été acceptés que comme un palliatif à la misère grandissante à laquelle l’incurie dirigeante réservait, comme solution, les massacres de Juin.
Après cette infâme boucherie, les revendications prolétariennes furent complètement étouffées par la réaction plus que jamais triomphante avec le coup d’État de 1851, ainsi que par les répressions des États européens. Le communisme était presque anéanti, se confondant dans une opposition républicaine aux idées politiques et libérâtres, jusqu’en 1864 où il réapparait avec l’Association internationale des Travailleurs.
Si l’Internationale a été créée sous l’influence de Karl Marx, elle est due surtout aux nécessités d’une époque où tout était en voie de transformation.
Le prolétariat, après 48 et les journées de Juin, finissait par perdre une grande partie de ses illusions sur « la conquête des libertés politiques » que lui seul payait si chèrement. Il commençait par comprendre que ne profitant de ces libertés que dans une très fable part, il servait d’instrument, parfois de sanction, dans des révolutions faites au profit d’une opposition bourgeoise. Après chaque gouvernement, les choses restaient en l’état, il ne faisait que changer de maîtres qui, selon les circonstances, le traitaient avec la rigueur extrême des précédents. Et s’il manifestait pour ses rêves de bonheur de l’humanité qui lui étaient si chers, aussitôt les gouvernants y répondaient à coups de fusil.
Si cette évidence ne lui apparaissait que vaguement sans s’en rendre un compte exact, pourtant, sur une chose, il était absolument fixé c’est qu’il continuait à crever de faim.
Jusque-là, les libertés conquises par le prolétariat n’avaient servi qu’aux trafics du capitalisme qui était devenu prépondérant dans la société. L’industrialisme, devant le perfectionnement continu des machines, prenait des proportions considérables et semblait vouloir tout envahir. La production augmentant sans cesse appelait de nombreux débouchés qui, par les nouveaux moyens et le bon marché des transports, multipliaient les échanges. Les échanges n’avaient pour limites que la concurrence de jour en jour plus grande. La surproduction et la concurrence toujours croissante avaient amené la baisse du prix des produits, et chaque baisse était supportée, en grande partie, par le prix de la main-d’œuvre ou salaire. L’exploitation dominait, réduisant le salaire à sa plus simple expression, le strict nécessaire.
Cette situation ne pouvait qu’empirer. Les travailleurs protestèrent en organisant la résistance par le seul moyen à leur disposition, la grève. Pour soutenir leurs prétentions et leurs exigences, les capitalistes firent venir des ouvriers de l’étranger travaillant à meilleur marché. La lutte devenait plus intense et les grèves plus générales, ayant pour résultat une misère plus noire. C’est alors que s’est imposé, pour les travailleurs, la nécessité d’une solidarité universelle, en créant l’Association internationale des Travailleurs.
Le 28 septembre 1864 avait lieu, dans St-Martin’s Hall, un grand meeting public où s’étaient réunis officiellement des délégués ouvriers de plusieurs nations européennes. Ce meeting fut le début de l’Internationale qui avait eu pour préliminaires une réunion ouvrière à l’occasion de l’Exposition universelle de Londres de 1862. Il fut procédé à la nomination d’un comité chargé de la rédaction des statuts de l’Association qui seraient soumis au premier congrès fixé pour l’année suivante. Un conseil général fut également nommé, devant siéger à Londres.
Sa création n’eut pas à subir une grande opposition de la part des gouvernements. En France, tout d’abord, on avait été assez enthousiasmé par l’idée d’une réunion d’ouvriers fondant « les assises du travail ». Le discours d’un ministre anglais avait servi de base aux discours des délégués. Nul ne prévoyait les conséquences d’une pareille association, ni ce qu’elle contenait ni ce qu’elle était appelée à faire.
Ses débuts rencontrèrent pourtant un obstacle dans la pusillanimité du gouvernement belge ; il ne permit pas la réunion du premier congrès, en septembre 1865, comme il avait été fixé à St-Martin’s Hall.
Le premier congrès n’eut lieu que le 3 septembre 1866 à Genève. Les statuts élaborés a Londres sous l’inspiration de K. Marx, furent adoptés presque sans changement ; ils étaient précédés d’un énoncé qui a été résumé ainsi :
« L’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation ne doivent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais à établir pour tous les mêmes droits et les mêmes devoirs.
L’assujettissement des travailleurs au capital est la source de toute servitude politique, morale et matérielle.
Pour cette raison, l’émancipation économique des travailleurs est le grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique. »
Après quelques résolutions prises pour l’organisation et le fonctionnement de l’association, on prit en considération : la réduction de la journée de travail à 8 heures, l’abolition des armées permanentes. Les discussions continuèrent incertaines, vagues, presque apeurées on refusa d’examiner les grands problèmes touchant à l’ordre et à la société.
Au deuxième congrès, en 1867, à Lausanne, les résolutions se montrèrent encore timides, se bornant toujours aux faits sociaux. On critiqua les sociétés coopératives, le but étant non la hausse des salaires, comme le voulaient les Trade’s Unions, mais l’abolition du salariat ; — et la propriété collective, la suppression de l’hérédité ne furent pas prises en considération. Après discussion, il fut décidé que l’émancipation économique était inséparable de l’émancipation politique. À cette époque, l’Internationale avait fait de rapides progrès ; l’ineptie gouvernementale produisait son effet : elle fit s’élever à 300,000 le nombre de ses adhérents. Le troisième congrès se réunit en septembre 1868 à Bruxelles. Le communisme autoritaire s’y affirma sous la théorie du collectivisme, consistant à attribuer à la collectivité tous les instruments de travail. Il fut résolu que l’Internationale soutiendrait les grèves, non comme moyen d’affranchissement, mais comme une nécessité de la lutte entre le travail et le capital. À ce moment, les grèves s’étendaient partout et, en France, elles étaient traitées par les balles de la troupe et les condamnations des tribunaux. Le résultat de ces iniquités fut de donner à l’Internationale un accroissement considérable d’adhérents consacrant sa puissance.
En septembre 1869, le quatrième congrès se tint à Bâle. Après un remarquable rapport de C. De Paepe, la résolution suivante fut adoptée : « Le congrès déclare que la Société a le droit d’abolir la propriété individuelle du sol et de faire rentrer le sol à la communauté ». Bakounine y développa ses idées de réforme par la liquidation sociale universelle, par l’abolition de l’état politique et juridique.
Pendant la guerre de 1870, l’Internationale continua de s’étendre ; elle protestait contre la guerre, approuvait la Commune de Paris sans la soutenir. Ses idées politiques s’affirmèrent davantage, elle engageait les ouvriers à entrer dans le mouvement politique, même en s’alliant au radicalisme bourgeois.
On avait remarqué et constaté que K. Marx, l’inspirateur du conseil général, tendait, par ses manœuvres, à devenir le dictateur du parti ouvrier international. Il avait caressé cette chimère, se confiant à ses mérites. Des protestations s’élevèrent, elles ne produisirent que des exclusions, et tout un groupe, Bakounine en tête, se retirait pour fonder l’Alliance de la Démocratie socialiste. Le congrès de La Haye, en septembre 1872, fut consacré aux rivalités de personnes qui devaient amener la désorganisation et la mort de l’Internationale ; il fut voté plusieurs excusions par une majorité toute dévouée à K. Marx qui, pour soustraire le conseil général aux divisions, le faisait transporter à New-York. Après quelques congrès tenus par chaque parti, le dernier qui eut lieu fut celui de Gand, en 1879, où les principes opposés se prononcèrent davantage, où la perte de l’Internationale fut consommée.
La cause de son effondrement pourrait se résumer ainsi : Division et rivalités de personnes, puis dissentiment, soupçons suivis d’injures et souvent de calomnie. Ce serait également indiquer la plaie profonde du prolétariat tout entier.
Mais encore, il faut ajouter les fautes commises, dès le début, en n’ayant pas su concilier les diverses aspirations des membres internationaux — soit comme en Angleterre où l’on tendait à l’accroissement des salaires par les coalitions et les grèves, soit comme en France, en Allemagne, où l’on tendait bien plus à la suppression des iniquités sociales par un changement radical de la Société. En se montrant irrésolue, timide dans le domaine pratique, et impuissante à l’égard des grèves, elle a provoqué l’abandon d’un grand nombre de corps de métiers.
Elle n’a pas accordé toute la liberté nécessaire aux groupes constitués. Les travailleurs qui les composaient avaient besoin de se former eux-mêmes, pour se dégager des idées reçues et des préjugés de milieu, pour acquérir les connaissances économiques dont l’étude devait porter sur l’idée socialiste même et non être limitée aux faits sociaux.
Karl Marx a voulu substituer à toute initiative ses idées et sa formule économique ; elles ne pouvaient être comprises de tous ni satisfaire les travailleurs. Après avoir affirmé que leur émancipation devait être leur œuvre, il continuait, lui bourgeois, à les inspirer, à les diriger selon ses préjugés d’organisation, de centralisation et de direction presque absolue. Tout cela est le découlé de ses principes communistes. Sous prétexte d’une plus grande somme de bonheur, de nécessités économiques, il rapporte tout à l’idée étatiste, centralisatrice. Devant considérer les individus comme des êtres machines composant la société, il applique ces principes à l’époque de transformation et il exige la même discipline qu’il exigera dans la société constituée. Aussi plus de liberté, d’aspiration individuelle qui ne sauraient être que des hérésies. On a pu faire prévaloir que les communistes répudiaient les systèmes sortis du cerveau d’un individu, même génial, qu’ils n’admettaient que les faits scientifiques ou expérimentaux ; ils n’en conservent pas moins leur rigorisme étroit pour tout ce qui a été reconnu, par eux, vrai ou déclaré tel. De l’ensemble de ces vérités découvertes, ils font un système orthodoxe duquel il est détendu de s’écarter sous peine d’excommunication et d’injures.
L’Association internationale des Travailleurs devait être une œuvre d’émancipation, la réalisation de l’idée socialiste par la transformation de la Société, par l’avènement de la Révolution ; mais elle ne pouvait avoir qu’une existence limitée, elle portait en elle son élément de dissolution un homme l’inspirant, la dirigeant, Karl Marx ; personnifiant un système, le Communisme.
Julendré.