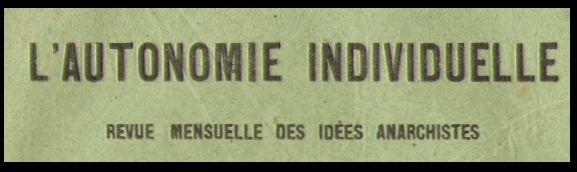Il est de toute évidence que, chacune à son heure, toutes les écoles révolutionnaires ont servi la cause socialiste. En soutenant les revendications prolétariennes, chacune, à des degrés divers, a accéléré l’évolution de l’humanité vers la liberté.
Le Communisme, par ses antécédents, a pu paraitre représenter le parti des opprimés ; mais nous tenons à établir qu’il ne peut continuer à incarner en lui la cause socialiste sans faire dévier le mouvement progressif des sociétés modernes, dont le principe virtuel tend à rendre à l’individu sa complète indépendance par la suppression de l’État, conséquence de l’Autorité ou despotisme.
Le Communisme n’a été que l’exagération d’un bon sentiment, le sentiment de la justice ; maintenant il ne peut être qu’une source d’arbitraire. Si l’on s’est mépris jusqu’à ce jour sur la portée de son principe c’est que, pour ses adhérent, il a répondu à des sentiments d’égalité et d’humanité dans des théories simplistes, utopiques et religiosâtres. Sa raison d’être a été de protester contre une société féodale ou bourgeoise basée sur l’inégalité et l’égoïsme omnipotent, au nom de la Justice et de l’Humanité. Son action a été réelle et nécessaire aux époques de la métaphysique, mais elle doit complètement cesser en présence des principes positifs et rigoureusement scientifiques des temps présents. Le Communisme est la formule simpliste de la lutte de l’homme contre la nature, par l’association communautaire fondée sur l’égalité absolue. L’idée communiste a pris naissance dans le sentiment du bonheur du genre humain et elle a eu pour but la protection du faible contre le fort, la répartition égale du bien et du mal inhérents à la nature des choses.
Cette idée, essentiellement philanthropique, a inspiré tous les systèmes ou théories communistes. Elle trouve dans Platon — le plus grand philosophe du spiritualisme hellénique — son premier développement. Platon se donne pour but la perfection de la société et des individus, et croit la trouver dans la communauté des biens et des plaisirs répartis par l’État, d’où sont exclus les esclaves : l’esclavage étant la base de tous les systèmes politiques et économiques anciens. L’État devient une vaste famille distribuant le bonheur à tous ses membres et dans laquelle l’ordre est établi par la suppression de tous les mobiles ou expressions de la personnalité humaine.
Les idées communistes reçoivent un nouveau développement du christianisme, que l’on peut considérer, avec la philosophie platonicienne, comme la source d’inspiration de toutes les utopies communistes.
Le christianisme prêche l’égalité. Il annonce que le règne de Dieu est proche, apportant le règne de la Justice sur la terre. Moralement, il émancipe les esclaves qui composent la plus grande partie des néophytes ; ceux-ci, d’accord avec leurs principes, s’établissent en communautés. À l’état primitif, ces communautés étaient fondées sur le renoncement à tous les plaisirs matériels ; elles étaient composées d’initiés se livrant aux seules pratiques religieuses et considérant le travail manuel comme inutile et servile ; plus tard, elles se transforment en monastères. Mais des christianisme qui semblait devoir être la religion des faibles et des opprimés devient oppressif, se fait l’instrument de domination des princes et des grands et consacre leurs privilèges ; sa puissance augment et sans cesse, il s’en sert comme moyens d’extorsion, et tout en prêchant aux hommes la vie idéale parfaite les livre à l’inquisition.
Après un long règne d’oppression et d’iniquité, après la Réforme, l’idée communiste trouve dans les Lettres quelques consciences révoltées qui, sans se soustraire au joug de la religion, rêvent le bonheur de l’humanité. L’Utopie de Thomas Morus, La Cité du Soleil de Campanella, L’Oceana d’Harrington, La République de J. Bodin sont l’expression de sentiments généreux, mais où la pensée religieuse domine elle est la résultante des conceptions sociales de leur époque.
Morelly, après avoir publié La Basiliade, condense dans le Code de la Nature toutes les idées communistes qui inspireront le système de Babœuf et des Égaux. Il pose en principe que l’homme étant né bon, s’il devient pervers cela provient des lois et des préjugés. De cela il déduit que toutes les passions sont légitimes et qu’il est nécessaire de les satisfaire par la mise en commun de tous les biens, source véritable du bonheur. Son système social est établi sur une longue suite d’obligations, comme le mariage dès l’âge nubile, comme les fonctions publiques remplies à tour de rôle. Ce système devait être considéré comme la dernière des perfections et défense était faite d’y rien changer sous les peines les plus sévères.
Puis les utopies sociales et humanitaires prennent une forme plus dogmatique, philosophique et même paradoxale dans Mably et Rousseau qui exerceront une certaine influence sur la Révolution.
Au milieu de l’effondrement de tout l’ordre politique et social, devant la curée de la Bourgeoisie captant la Révolution, Babœuf et les babouvistes élèvent une protestation indignée. Le Manifeste des Égaux, rédigé par S. Maréchal, réclame l’égalité non seulement dans les lois mais dans les foyers. Il n’existe, dit-il, aucune différence entre les hommes, tous ayant les mêmes facultés et les mêmes besoins, des intelligences égales réclamant une même éducation dans la communauté. La protestation est étouffée par la Révolution qui avait été faite au nom de la liberté. La Révolution n’avait fait que renverser une aristocratie pour la remplacer par une autre, elle avait supprimé d’anciens privilèges pour en établir de nouveaux. L’aristocratie bourgeoise, continuant à asservir et à exploiter les masses, décore son règne nouveau du nom de parlementarisme pour consacrer sa tyrannie ; elle élabore son évangile économique pour justifier ses spoliations. Contre son arbitraire et ses injustices, contre son cruel et étroit égoïsme se sont élevés des hommes qui ont ouvert les voies au socialisme moderne.
Owen reprend les théories babouvistes et les élargit en niant Dieu, morale, religion, source des préjugés qu’il veut détruire. Ni le vice ni la vertu n’existe, il ne doit y avoir ni blâme ni louange, l’homme est irresponsable n’étant pas libre ; de même, dans la concurrence et la spéculation commerciales réside tout le mal social. Saint-Simon se donne pour mission l’amélioration du sort de la classe pauvre et laborieuse ; par ses recherches et ses travaux s’il produit une palingénésie religieuse, il formule la philosophie de l’industrie et du travail. Fourier fait le procès de la société et il doit surtout être considéré par la force de sa critique. Dans une sorte de communauté qu’il appelle phalanstère, l’harmonie résulte de l’attraction passionnelle qui rend les individus sociables ; il établit, selon les facultés et les talents, hiérarchiquement, les fonctions rendues agréables par une loi sériaire appliquée au travail ; il décrit les avantages de l’association, sans toutefois admettre l’égalité. Puis viennent les communistes purs qui, par l’exagération de leurs théories fraternitaires ou égalitaires, les discréditent et les puérilisent pour tomber dans les rêveries icariennes. Tout en subissant l’influence de Fourier et d’Auguste Comte, Proudhon, le premier, détermine exactement le socialisme, en formule les idées philosophiques et scientifiques. Il définit le Communisme, en démontre l’inanité et constate que « les autorités et les exemples qu’on allègue en faveur de la communauté se tournent contre elle la République de Platon suppose l’esclavage, celle de Lycurgue se fait servir par des ilotes. Les communautés de l’Église primitive ne purent aller jusqu’au 1er siècle et dégénèrent bientôt en moineries ; dans celles des jésuites du Paraguay, la condition des noirs apparut aux voyageurs aussi misérable que celle des esclaves. On le voit, la communauté n’est qu’inégalité, oppression et servitude. »
Proudhon a établi puissamment que les individus n’avaient nul besoin d’être gouvernés pour être heureux et libres. Il est l’instigateur du parti des travailleurs auxquels il a donné conscience de leur force organisatrice et productrice.
La communauté a été le thème de conceptions sentimentalistes qui, en tant que fait, deviendraient la prédétermination de l’oppression et de la servitude. Le système communiste a pour base fondamentale la toute puissance de l’État, puissance confiée à des autorités décrétant et répartissent le travail et le bien-être — bien-être, chose aléatoire, qui ne saurait compenser la liberté individuelle complètement détruite.
La liberté étant sacrifiée à l’égalité celle-ci devient illusoire, car l’égalité ne peut découler que d’une liberté absolue. L’égalité présentée comme la panacée universelle ayant qualité de parfaire à toutes les défectuosités sociales et naturelles n’est que la théorie du nivelage et de l’abaissement de l’individu. En philosophie sociale, il est admis scientifiquement qu’il ne peut être fait abstraction de la liberté individuelle sans annihiler tout élément de progrès. Pour assurer l’évolution progressive, il est donc nécessaire d’accorder à l’individualité son complet développement. — Et comment l’obtenir, si ce n’est en répudiant toute autorité. toute action d’État et d’hommes providentiels, en supprimant toute entité consacrant une supériorité sociale. Si les théories du communisme utopique qui viennent d’être décrites à grands traits dans ses divers développements ont été reniés par le communisme scientifique, le collectivisme n’en est pas moins établi sur la communauté. — Ses principes essentiellement centralisateurs et autoritaires feront l’objet d’une prochaine étude.
Julendré.