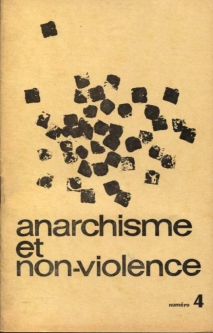Le colonisé, l’homme noir, celui qui est l’objet du racisme, est objet de la violence du raciste, et, pour assumer son être, il doit y répondre par la violence : voilà une thèse fondamentale de Frantz Fanon, le psychiatre antillais devenu algérien, dans une prise de conscience globale de la solidarité des colonisés, et mort au service de l’Algérie en guerre.
Cette réflexion est développée dans le premier chapitre : « De la violence », de son second livre : les Damnés de la terre.
Reprenons la démarche de Fanon.
Le colonisé vit dans un monde fondamentalement violent : il y a eu violence dans la conquête du territoire et de ses hommes, il y a violence dans la cohabitation, rapports violents entre le maître et la « chose » colonisée, il y aura violence inéluctable dans la libération, la conquête par le Noir d’un nouveau monde et simultanément d’une essence spécifique.
Car le colonisé n’a pas d’être, puisqu’il n’a pas d’histoire : le colon lui impose sa propre histoire en niant qu’il ait pu créer quoi que ce soit, une société, une œuvre d’art, une culture, une technique, avant son arrivée ; le maître plaque sur l’esclave son propre passé. La première justification par Fanon de la violence sera donc psychologique : c’est une dérivation de l’oppression subie et de l’agressivité refoulée, une « conduite d’évitement », dit le psychiatre ; renaissent les mythes terrifiants, les danses extatiques, les phantasmes nocturnes, en qui l’on projette haines, cruauté, humiliations ravalées, mépris inavouables.
C’est une prise de conscience dépassant l’individuel qui réorientera cette violence : le colonisé veut en effet reconquérir la terre qui lui donne le pain, sa dignité ; le seul moyen est d’expulser à tout jamais, par tout moyen, le colon. Alors éclate la guerre de libération, la guérilla dont la violence n’est pas comparable à celle qui lui est opposée : parce que d’une part elle met en péril l’affrontement même des intérêts économiques placés dans la colonie, que d’autre part, faute d’instruments supérieurs, elle invente une tactique supérieure et inattaquable par les forces de l’ordre, parce que, enfin, elle est affirmation d’un peuple, d’une solidarité, de la construction d’une nation, à travers la contestation globale de l’oppression.
D’individuelle, de pathologique, la violence devient donc atmosphérique, elle éclate lorsque se cristallise l’alarme des colons en des mesures répressives ; politique, elle tend à l’universalité. La violence, c’est « l’intuition qu’ont les masses colonisées que leur libération doit se faire, et ne peut se faire que par la force» ; l’intuition traduite en acte « représente la praxis absolue. […] Le groupe exige que chaque individu réalise un acte irréversible » (condamnation à mort des maquisards algériens, meurtres collectifs des Mau-Mau et aussi bien crimes des milices urbaines de Lacoste), et la violence, par ironie scandaleuse, devient le mot d’ordre d’un parti politique.
Ironie parce que les partis ont été inventés par la classe la plus ambiguë des sociétés africaines, les intellectuels, ces hommes qui selon Malraux vivent en fonction d’une idée.
Scandale parce que les intellectuels sont non seulement oublieux de cette évidence que le peuple est contraint de vivre en fonction de ses besoins, mais encore sont en accointance avec la bourgeoisie coloniale à laquelle ils rêvent de s’assimiler.
― O ―
Ici se place alors la réflexion de Fanon qui nous fait serrer les poings et pâlir du remords d’arriver trop tard pour nous justifier, nous expliquer avec lui : critique de ce qu’il nomme la non-violence de la bourgeoisie colonialiste.
« Dans sa forme brute, cette non-violence signifie aux élites intellectuelles et économiques colonisées que la bourgeoisie colonialiste a les mêmes intérêts qu’elles et qu’il devient donc indispensable, urgent, de parvenir à un accord pour le salut commun. La non-violence est une tentative de régler le problème colonial autour d’un tapis vert, avant tout geste irréversible, toute effusion de sang, tout acte regrettable. Mais si les masses, sans attendre que les chaises soient disposées autour du tapis vert, n’écoutent que leur propre voix et commencent les incendies et les attentats, on voit alors les « élites » et les dirigeants des partis bourgeois nationalistes se précipiter vers les colonialistes et leur dire : « C’est très grave ! On ne sait pas comment tout cela va finir, il faut trouver une solution, il faut trouver un compromis. »
Il est trop facile de dire que Fanon emploie un mot pour un autre, de défendre la pureté de la non-violence et celle des non-violents qui militaient à leur façon, instituteurs en Oranais, infirmiers en Kabylie : importe ici ce que Fanon a compris et ce qu’il a transmis.
Car l’attitude non violente authentique – anarchiste – n’est pas compromission, elle est au contraire révolutionnaire dans la mesure où elle oppose aux structures sclérosées du régime de l’Ordre la spontanéité créatrice, la solidarité effervescente du peuple en devenir.
L’erreur de Fanon a été de traduire par non-violence refus de la violence, effroi devant l’irrémédiable, horreur du sang inutile. Mais l’anarchisme non violent propose l’irrémédiable en proposant une réorganisation fondamentale de la société, tant sur le plan économique que sur celui des rapports humains recréés.
Je ne veux pas dire par-là que les peuples colonisés en soulèvement aient été sourds à nos mots ; c’est bien plutôt nous qui n’avons su nous faire entendre, nous qui avons rompu le pas devant une situation d’urgence. Car si l’anarchisme et la non-violence sont révolutionnaires, ils le sont par un long processus d’éducation et d’apprentissage – de soi, de la responsabilité, des méthodes – tandis que la solution violente surgit et s’impose sous une domination insupportable, et l’immédiateté de son emploi, son efficacité probante à court terme dissimule ses contrecoups néfastes et incontrôlables.
La parole est à Fanon :
« L’apparition du colon a signifié syncrétiquement la mort de la société autochtone, la léthargie culturelle. Pour le colonisé, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. […] [La] violence, parce qu’elle constitue son seul travail, revêt des caractères positifs, formateurs. Cette praxis violente est totalisante, puisque chacun se fait maillon violent de la grande chaîne , du grand organisme violent surgi comme réaction à la violence première du colonialiste. »
La violence seule peut donc vaincre l’aliénation, par la conquête du pouvoir – et de l’être – qui est l’acte libérateur par excellence. Au moment où l’homme se libère, il est absolument pur : car il incarne l’unité dialectique. Fanon ici est loin de Hegel, et du processus de « reconnaissance » réciproque qui abolirait la distance – le « malentendu fondamental » – entre le maître et l’esclave et résoudrait historiquement l’aliénation. Rétablit-il alors le rôle générateur de la violence en histoire, qu’Engels contestait à Dühring ? Non, la violence du colonisé est bien subordonnée à la situation économique, c’est Marx que suit Fanon : l’ascendance est évidente et avouée.
« Il demeure évident que pour nous la véritable désaliénation du Noir implique une prise de conscience abrupte de la réalité économique et sociale. Le complexe naît de l’intériorisation – mieux : de l’épidermisation – d’une infériorité économique. »
Qu’en est-il à l’aboutissement de cette première phase de libération ? Selon Fanon, la seconde phase – construction de la nation – par la colère commune, par la conscience de la cause commune qu’a fait naître la guerre dans le peuple, s’en trouve facilitée : la lutte simplement se transpose sur le plan de la misère, de l’analphabétisme, elle a « désintoxiqué » l’individu et « hisse le peuple à la hauteur du leader. D’où cette espèce de réticence agressive à l’égard de la machine protocolaire que de jeunes gouvernements se dépêchent de mettre en place. […] Illuminé par la violence, la conscience du peuple se rebelle contre toute pacification ».
― O ―
À Lénine qui lui demandait selon quelle mesure il appréciait, dans une bataille, le nombre des corps nécessaires et celui des corps superflus, Gorki ne savait répondre que sur le mode lyrique.
De même, nous qu’accuse Fanon, ne savons-nous nous défendre que sur le mode lyrique. Pourtant nous voudrions lui crier qu’il se trompe, lui prouver que la violence n’est pas la seule voie d’accès à la liberté, lui reprocher de n’avoir envisagé qu’elle. Nous oublions que, comme les préjugés, la violence – toute violence – a des fondements irrationnels, que nous avons beau jeu de lui opposer des solutions libertaires : elles ne sont pas sur le même plan.
La non-violence est une révolution dérivée, même usant de l’action directe : elle ne s’attaque pas de front à son objet – le renversement des structures – mais se place dans l’exemple et l’enseignement qui font naître la prise de conscience. Si la violence provoque l’adhésion des masses, la non-violence est acte de responsabilité personnelle ; autant on est nombreux sous l’uniforme, dans le sang, dans les hurlements, autant la solidarité des non-violents est-elle muette et difficile à assumer.
De même l’anarchisme face au socialisme autoritaire.
La solution violente n’est pas toujours facile, n’est pas toujours lâche, non ; tout au plus connaît-elle la piètre consolation de la vengeance. Mais voici justement où Fanon commet sa plus grave erreur : en soutenant le caractère unificateur, mobilisateur, totalisant de la violence. Car le goût de la violence donne le goût du pouvoir, tant subi qu’exercé, et ne provoque jamais « une réticence à l’égard de la machine protocolaire » des gouvernements : toute armée, même de maquisards, obéit à un chef, qu’idéalise la mémoire embellissante ; le Tiers-Monde n’est-il pas près de faire de Fanon un messie ? Messianisme de la nécessité de la révolution violente, de la conquête violente du pouvoir par la classe exploitée – prolétaires ou colonisés – messianisme de l’aboutissement de l’histoire ? Nous leur opposons le cycle interminable qui de la violence mène à la violence.
― O ―
Théoriquement, il n’est pas difficile de répondre à Fanon : à l’aliénation économique répond la libération économique, par le boycott des entreprises coloniales, par l’organisation autonome, l’autogestion, les fédérations de communes, un socialisme libertaire et non violent.
Mais de quel droit prétendons-nous, nous oppresseurs, montrer la voie de l’affranchissement à ceux qu’hier nous asservissions ? Au mot d’ordre de Fanon : « Quittons cette Europe qui n’en finit pas de parler de l’homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre ».
À son cri de colère nous ne savons que rester cois. « Ce n’est pas d’abord leur violence, c’est la nôtre, retournée, qui grandit et les déchire. » (Sartre, préface aux Damnés de la terre)
Je ne proposerai ni solution ni rachat. Il est évident qu’il ne sert à rien de battre sa coulpe ; je me demande même s’il est plus honnête d’offrir ses services aux pays qui furent colonisés. Ne faudrait-il pas d’abord apprendre la non-violence ? Tant que nous n’aurons pas eu faim, que nous n’aurons pas été atrophiés par l’exploitation abusive, nous ne pourrons reprocher à nos camarades de chasser le colon au bout de leurs fusils ; or il est aussi vain de se mettre artificiellement dans cette situation pour prétendre la connaître, ce n’est pas en devenant lépreux que l’on guérit la lèpre.
Car enfin cette nécessité de se donner, de se dévouer, elle procède avant tout d’un désir personnel de purification, de justification : en échange des privilèges, de la culture, de la vie facile, j’offre mes bras, ma jeunesse, mes années d’études acquises presque honteusement… Fanon n’en a que faire.
Devant la violence que nous avons provoquée, aucun jugement de valeur n’est permis ; néanmoins nous requérons la lucidité, à l’égard de Fanon comme à l’égard du mahatma Gandhi. Dans quelle mesure l’assertion du premier, que la décolonisation comporte une violence intrinsèque, est-elle réelle ? Dans quelle mesure le mode indien de libération est-il renouvelable ? Dans quelle mesure enfin peut-on éviter les séquelles autoritaires d’une guerre de libération et bâtir un socialisme libertaire en pays neuf ? Je crains que nous ne soyons encore en mesure de répondre.
Marie Martin