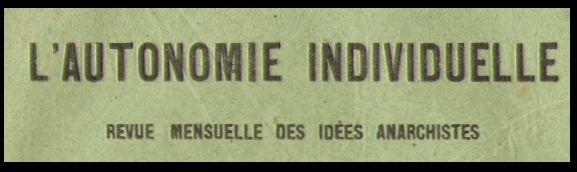Lorsque Malthus, après de profondes études, émit son terrifiant aphorisme : à savoir « Que lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle elle va doublant tous les vingt-cinq ans et croit en période selon une progression géométrique », il crut nécessaire de conclure comme on sait.
Aujourd’hui, malgré quelques clameurs, la loi de population a été adoptée par la grande majorité des philosophes, qui se sont contentés de transformer un peu la conclusion.
Après avoir démontre la réalité de l’existence de cette loi, nous aussi, nous nous permettrons d’en modifier la résultante. Cette théorie que l’on a si souvent jetée dans les jambes de l’Anarchie, nous voulons la faire nôtre et prouver encore une fois, avec son aide, que notre but n’est pas une utopie inaccessible, mais une doctrine indéfectible et qui aura son jour de réalisation.
Pour établir, et ceci pour nos amis, que la loi de population est une vérité indéniable, nous choisirons nos preuves dans les deux règnes de la matière qu’on est convenu d’appeler organique1D’après quelques continuateurs de Darwin, il n’y a pas de matière organique et inorganique. Il n’y a que la Matière. Toutes les différentes formes sous lesquelles elle se présente s’enchaînent et se tiennent l’une à l’autre, sans différences assez appréciables pour qu’il soit possible de la classifier. De mène, pour les espèces. Du reste, la génération spontanée qui est un fait, quoi qu’en puissent dire tous les Pasteur de la science officielle, ne prouve-t-elle pas que la matière, si inorganique qu’elle nous paraisse, est virtuellement organique..
Le naturaliste Linné a calculé que, si une plante produisait deux graines dans l’année, puis chacune des nouvelles plantes deux nouvelles graines l’année suivante, et ainsi de suite, le nombre des plantes s’élèverait à un million en vingt ans.
Linné est encore au-dessous de la vérité, puisqu’aux Indes Orientales les plantes, qui furent introduites lors de la découverte du Nouveau-Monde, couvrent déjà tout l’immense territoire qui s’étend du cap Cormorin à l’Himalaya !
La loi de population est encore plus curieuse à examiner dans la Faune.
M. Darwin prend comme exemple l’éléphant qui n’a qu’un petit à la fois ; il suppose ensuite que chaque femelle ne produit que trois couples en quatre-vingt-dix ans. Au bout de cinq siècles, quinze millions d’individus n’en seraient pas moins descendus de la paire primitive. Si l’on examine les espèces infiniment plus prolifiques, on est stupéfié de ne pas se voir débordé par elles.
Les taureaux et les chevaux sauvages, qui paissent en troupeaux innombrables — A. de Humbold estime le nombre des chevaux à trois millions, rien que dans les seules pampas de la Plata — dans les vastes plaines de l’Amérique du Sud, proviennent d’un petit nombre de couples amenés par les Européens à l’époque de la conquête espagnole.
Ceci n’est rien encore.
« Les harengs femelles de la Manche contiennent en moyenne de 29 à 30 mille œufs. Les grands harengs du Nord en renferment jusqu’à 68 mille »2De Quatrefages. ― Les animaux utiles..
« En admettant que chaque puceron donne naissance seulement à cinquante petits, ce qui est certainement au-dessous de la vérité, un seul de ces insectes commençant à produire au printemps se trouverait, au terme de la belle saison, avoir été la souche de plus de quatre millions de milliards de petits-fils, et cette lignée couvrirait un espace d’au moins quarante mille mètres. Si la surface entière du globe n’est pas envahie par les pucerons, c’est que de nombreux et voraces ennemis veillent sans cesse pour les détruire »3De Quatrefages. ― Les Métamorphoses.
Oui, de cette multiplication prodigieuse nait la concurrence vitale (struggle for life).
Doit-elle toujours exister ? N’y a‑t-il aucun moyen de l’éluder ?
Nier à priori ce phénomène naturel, comme certains socialistes ont cru devoir le foire, serait se couvrir de ridicule et éloigner de notre cause les esprits sérieux. L’étudier à fond est la seule perspective raisonnable. C’est ce que nous nous proposons de faire.
Il appert, d’après ce que nous venons de dire, que la concurrence vitale pour l’ordre végétal et animal existera toujours. Rien ne pourra la suspendre ni même l’atténuer ; au contraire, elle aura des tendances vers l’extension. Toujours les « moins aptes » des animaux seront détruits pour la sustente des animaux « plus aptes » et des hommes ; toujours le pin, par exemple, qui produit des millions de semences dans sa vie, ne pourra pourtant mener à bien que la croissance de la « plus apte » de ces semences ; toujours aussi la Flore aura à se défendre contre la Faune.
Jusqu’à présent, pas de contradiction possible. Nous sommes d’accord avec les darwinistes les plus darwinisant. Nous admettons que l’homme aura toujours à lutter contre la nature ; mais sera-t-il toujours contraint de lutter contre lui-même ?
Là est le point où nous nous séparons des transformistes. Les végétaux ne sont ni prévoyants ni industrieux. Ne vivant que de la sustente que la seule Nature leur octroie, ils augmentent en population sans augmenter en ressources. C’est ce qui les condamne à la concurrence vitale, dans tout ce qu’elle a de sauvage et de barbare, sans rémission possible.
L’homme, lui, apporte en naissant une intelligence et une force d’activité à ses semblables. S’il ne crée pas de la matière, par les ingénieuses combinaisons de son industrie, il produit ou développe de l’utilité. Là est sa sauvegarde contre le struggle for life de Darwin.
En effet, comme l’a très bien démontré Proudhon, qu’importe que la population augmente dans une proportion géométrique dont le premier principe est 2, si les produits du travail augmentent dans une proportion géométrique dont le premier principe est 3.
Ceci est irréfutable.
Supposons que le produit du travail d’un homme soit équivalent à la consommation de sa famille. Quand il meurt, il laisse deux garçons. À première vue, il semble qu’ils produiront à eux deux pour deux familles. C’est une erreur, ils produiront pour trois. Étant deux, ils pourront déjà commencer à diviser leur travail : il sera donc plus riche en résultat ; ensuite, l’expérience de leur père est augmentée de la leur : ils ont donc réformé leurs outils et trouvé d’autres combinaisons. Leurs quatre enfants, en continuant la progression, produiront pour six familles. Les huit enfants de ceux-ci produiront pour douze familles, et ainsi de suite. Plus la population sera nombreuse, plus elle sera riche4Ici, nous devons mettre en garde nos camarades contre l’utopisme. Qu’ils ne s’y méprennent pas, si l’on n’y remédie à temps, à une époque évidemment très éloignée de nous, la population deviendra tellement dense que la loi de production deviendra sans effet et que, de nouveau, le terrible combat pour la vie se livrera entre les hommes. Fort heureusement, nous n’en sommes pas là. Chaque génération a sa tâche, accomplissons la nôtre. Nos arrière-neveux sauront exécuter la leur..
La concurrence vitale ne doit donc pas exister entre les hommes ; mais il serait absurde de la nier. Oui, les hommes devront toujours, éternellement, lutter pour acquérir la satisfaction de leurs besoins ; mais pas entre eux, puisque, comme nous l’avons démontré, ce serait méconnaitre leurs intérêts.
Travailler, chercher, penser, c’est la loi de progrès développée par la concurrence vitale. S’entretuer, c’est la loi de barbarie, laquelle est l’incrément d’une Société ne répondant plus aux besoins de ses membres.
La concurrence vitale stimulant le Progrès, c’est la seule qui devrait exister. Quant à l’autre, celle qui prédomine aujourd’hui, elle n’est que la résultante de la Société que nous combattrons sans trêve, jusqu’à ce qu’elle disparaisse ; — elle cessera avec.
G. Deherme.
- 1D’après quelques continuateurs de Darwin, il n’y a pas de matière organique et inorganique. Il n’y a que la Matière. Toutes les différentes formes sous lesquelles elle se présente s’enchaînent et se tiennent l’une à l’autre, sans différences assez appréciables pour qu’il soit possible de la classifier. De mène, pour les espèces. Du reste, la génération spontanée qui est un fait, quoi qu’en puissent dire tous les Pasteur de la science officielle, ne prouve-t-elle pas que la matière, si inorganique qu’elle nous paraisse, est virtuellement organique.
- 2De Quatrefages. ― Les animaux utiles.
- 3De Quatrefages. ― Les Métamorphoses.
- 4Ici, nous devons mettre en garde nos camarades contre l’utopisme. Qu’ils ne s’y méprennent pas, si l’on n’y remédie à temps, à une époque évidemment très éloignée de nous, la population deviendra tellement dense que la loi de production deviendra sans effet et que, de nouveau, le terrible combat pour la vie se livrera entre les hommes. Fort heureusement, nous n’en sommes pas là. Chaque génération a sa tâche, accomplissons la nôtre. Nos arrière-neveux sauront exécuter la leur.