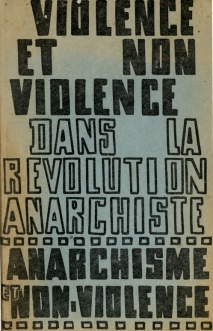Si tous les anarchistes se sont prononcés, dans le passé comme dans le présent, pour la suppression de l’État, nombre d’entre eux ont soit confondu les deux notions : État et droit, soit laissé le plus souvent le problème du droit en suspens. Essayons donc de mettre au clair, d’une part, la différence nécessaire entre ces deux notions et, d’autre part, de justifier la nécessité de la seconde. L’État est sous sa forme actuelle une notion toute moderne, pratiquement inconnue avant la Renaissance. Bien que découlant étymologiquement du latin status, le mot État remplace plutôt République, ou, mieux encore Respublica : chose publique, employé jusqu’au XVIe siècle. Il ne doit pas être confondu avec société ou collectivité humaine, notion aussi vieille que l’humanité, forme naturelle et spontanée de celle-ci.
Sous la forme présente que nous connaissons et subissons, l’État est né aux environs du XVIIIe siècle des suites de la révolution industrielle ; en effet, à cette époque, les hommes qui firent la révolution industrielle – la bourgeoisie – et qui en tirèrent les premiers bénéfices matériels et moraux se heurtèrent à des habitudes d’esprit, à des traditions, à toute une structure de la société qui leur opposa suffisamment d’obstacles pour que, dès qu’ils en possédèrent les moyens, dès que la réussite leur eut donné à la fois la puissance matérielle et le crédit politique – jusqu’alors détenus par la noblesse et le roi – leur premier soin ait été d’abolir les réglementations, de modifier cette structure et ces traditions dans tout ce qui pouvait gêner leur effort et contrarier leur ascension. L’État naquit, dont la forme put rester monarchique ou devenir républicaine, le régime autoritaire ou bien parlementaire, il n’en groupa pas moins, dorénavant, des individus autonomes, indépendants, dotés de moyens matériels, dont les conséquences allaient être de poids dans l’avenir.
On peut, dès cette époque, définir l’État comme un enchevêtrement de “ services ” politiques, juridiques et économiques, destinés à faire respecter le droit en vigueur – après l’avoir fabriqué d’ailleurs – et à l’imposer par la force lorsqu’il le juge opportun.
Dans notre société capitaliste, c’est donc une structure artificielle et passagère, créée pour les besoins d’une nouvelle classe, en l’occurrence la bourgeoisie capitaliste, et chargée de lui assurer le maximum d’efficacité et de rendement par tous les moyens légaux y compris la violence.
C’est bien contre cette notion que tous les anarchistes semblent s’être élevés, au nom de la liberté et du droit à l’égalité de tous les individus.
Le droit, au contraire de l’État, semble inhérent à toutes les sociétés humaines, des plus primitives : familles, clans, tribus, aux plus “ civilisées ”. On peut le considérer comme la règle indispensable, le contrat écrit ou oral faisant régner l’entente entre les individus vivant en commun, d’une manière temporaire ou permanente.
On le définit habituellement comme un ensemble de préceptes, quasi obligatoires, mais en principe consentis, établis sous la forme de règles destinées à faire régner, parmi les hommes réunis, l’ordre et la justice.
C’est en quelque sorte la garantie de la liberté individuelle maxima face aux exigences et contraintes indispensables de la vie commune.
C’est donc une discipline sociale, un ensemble de règles de conduite nécessaires, et, en ce sens, il semble bien qu’aucune société ne puisse s’en passer quelle que soit sa structure. Il est le complément naturel de la morale, de l’éthique, il règne sur les actions ayant une influence directe sur la marche et la vie de la société, à l’encontre de celle-ci, il émane du “ for intérieur ” et échappe à son empire.
Pour être acceptable et justifiable, il doit donc tendre vers la justice et y préparer.
Ce qui le rend suspect dans nos sociétés, c’est sa dépendance directe de l’État, son absorption toujours plus grande par celui-ci. Si les États, de par leur monopole quasi intégral des lois et des règlements imposent une certaine forme de droit, il n’en est pas moins vrai que les coutumes et traditions, par exemple, en forment le fonds commun et initial, et restent toujours une partie des plus importantes du droit – bien que de moins en moins d’ailleurs – échappant encore à l’État et étant souvent fort valable et adaptable à un nouvel ordre social.
Lucien Grelaud