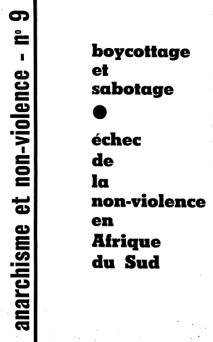Extraits de « liberté pour mon peuple » éditions Buchet-Chastel, 13,85 frs.
Programme d’action
« En 1949, alors que Moroka venait d’être élu à la présidence générale du Congrès, les membres du mouvement se rencontrèrent pour élaborer un programme d’action. Ce programme d’action est la pierre angulaire de toute l’histoire du Congrès. Il représente un changement fondamental de politique et de méthode. Sous-jacent était notre refus de nous satisfaire pour l’éternité des reliefs tombés de la table des Blancs, et ceci de façon intransigeante et définitive.
« Le défi lancé portait sur l’essentiel. Des améliorations ou d’insignifiants réajustements ne nous contentaient plus. Aucun doute ne demeurait dans notre esprit que faute du droit de vote, nous étions réduits à l’impuissance. Sans le droit de vote, en effet, il n’y a pas pour nous de moyen d’accomplir notre destin sur notre terre natale, ni même de possibilité d’être entendus. Sans le droit de vote, notre avenir serait, comme a été notre passé, ce que décréterait une minorité de Blancs. » […]
« Le programme d’action adopté en 1949 s’appuya sur des méthodes nouvelles. Nous en avions fini avec les représentations. Des démonstrations à l’échelle du pays tout entier, grèves et désobéissance civique, allaient remplacer les mots. Influencés par l’action combinée de la communauté indienne après le vote du Ghettho Act, nous résolûmes, d’un commun accord, de nous concentrer principalement sur la désobéissance en n’usant que de la non-violence. Cette désobéissance n’était pas dirigée contre la loi en elle-même, mais contre toutes ces lois particulières de discrimination, de la loi de l’Union aux autres, et qui n’étaient pas inspirées par la morale.
« Le 26 juin 1950 eut lieu une démonstration majeure, dont le but immédiat était de protester contre le Group Areas Bill et contre la suppression du Communism Bill, et qui prit la forme en manière de protestation, d’un jour passé sans sortir de chez soi. À Johannesburg, à Port Elizabeth et à Durban, le succès en fut éclatant. Dans l’esprit des organisateurs – Africains, Indiens et gens de couleur y participèrent – ceux qui restaient chez eux sans sortir pendant vingt-quatre heures pourraient à cette occasion prendre le deuil de ceux qui, des Africains principalement, avaient versé leur sang en combattant pour la libération. Pendant bien des années, les manifestants avaient régulièrement donné leur vie, exécutés par la police. Ce fut rarement assez sensationnel pour attirer l’attention, c’est tout simplement un trait de l’existence africaine. Il était grand temps que nous pleurions nos morts – ils se montaient à des milliers.
« En mai 1951, eut lieu une grève efficace de protestation des gens de couleur, soutenus par les Africains et les Indiens, à Port Elizabeth et au sud-ouest du Cap. Elle était dirigée contre l’intention manifestée par les nationalistes de rayer les gens de couleur des listes électorales.
« Ce furent les premiers pas, le premier résultat de notre programme d’action.
« En juillet 1951, l’Exécutif national du Congrès se réunit, et un conseil d’organisation fut nommé pour régler la coopération entre les différents groupes de non-Blancs, ce qui était un véritable saut en avant.
« La signification de ce conseil d’organisation ne doit pas échapper. Le fait même qu’il pût être formé et fonctionner était un signe évident qu’à l’exception des représentants de la race blanche toute l’Afrique du Sud commençait à penser et à agir à travers la barrière que les différences de races avaient dressée. Le désir de secouer l’apartheid pouvait maintenant enfin se traduire par des manifestations extérieures. L’action combinée de la Campagne de défi nous rapprocha d’un pas d’une Afrique du Sud où la question de race ne serait plus que d’une importance secondaire. » […]
« À la fin de l’année 1951, une conférence nationale de l’ANC devait siéger à Bloemfontein. Alors que j’étais prêt à partir, l’état-major du Natal m’envoya les documents se rapportant à cette conférence. À mon grand étonnement, j’y trouvai des suggestions et des résolutions au sujet d’une campagne de défi civique. L’Exécutif national ainsi que quelques provinces avaient déjà envisagé ces mesures, mais c’était la première fois que le Natal y faisait allusion !
« Il était trop tard pour songer à convoquer mon propre Exécutif, aussi fût-ce en voiture, en nous rendant à Bloemfontein, que nous pûmes en discuter à loisir. Nous décidâmes de donner notre adhésion de principe à la Campagne de défi. Nous aurions à intervenir pour demander l’ajournement de la date proposée, fixée au 6 avril 1952, car c’était un sujet qui n’était pas tellement familier au Natal à qui nous ne pouvions confier une action aussi capitale, alors que nous étions encore dans l’ignorance de l’ensemble du problème. Et nous ne pouvions pas davantage faire que le Natal soit prêt à temps. » […]
« En dehors de la salle de la conférence, quelques membres venus de diverses régions me confièrent qu’ils redoutaient que cette campagne ne souffre d’une préparation trop hâtive. C’était un cercle vicieux : d’une part, nous avions sans cesse besoin d’agir, et d’agir sur-le-champ ; d’autre part, une action insuffisamment élaborée pouvait se révéler pire que pas d’action du tout. Le mouvement congressiste ne pouvait compter sur une éventuelle démonstration spontanée ; trop souvent, ce genre de manifestation, qui éclate quand la patience vous échappe, engendre la violence. Les gens devaient être renseignés clairement et avec soin : de plus, il convenait de leur donner l’occasion de prouver leur bonne volonté et de témoigner de leur empressement à participer à un mouvement.
« Le Congrès aurait été un organisme qui eût placé sa confiance dans le carnage et dans la violence, les choses auraient été plus simples. Ce que nous visions, en Afrique du Sud, c’était de ramener les Blancs à la raison, non de les massacrer. Notre désir était une coopération mutuelle. Nous soutînmes d’abord qu’un changement survenu dans leur cœur aurait permis cette entente. Puis, à l’aide du programme d’action, nous avons essayé dans les années qui suivirent de démontrer les réalités selon une voie moins académique ; nous nous sommes efforcés de faire apparaître ces réalités sous leur vrai jour, dans l’espoir que les Blancs ressentiraient le besoin impératif de s’y conformer. Et un petit nombre d’entre eux l’ont effectivement ressenti, certains congrès de démocrates, de libéraux et peut-être de progressistes. Quelques-uns le savaient depuis le début, et avaient agi dans ce sens. Mais la grande majorité, comme le Pharaon, avait laissé leur cœur s’endurcir.
« Naturellement, il nous vint à l’esprit de nous demander si autre chose que la violence et le carnage aveugle feraient quelque impression. Si inaccessibles qu’ils le semblent. À nous, cela ne nous ferait aucun bien, et si de tels incidents survenaient, ils n’émaneraient pas du Congrès, mais seraient le résultat d’une provocation intolérable, exerçant depuis trop longtemps une patience qui a ses limites. Si les Blancs continuent comme à présent, personne ne donnera le signal de la violence. Personne n’en aura besoin. » […]
Nous lançons notre défi
« Les préparatifs pour la Campagne de défi se poursuivaient. Le 26 juin fut choisi pour lancer une action de désobéissance ouverte, car la date du 6 avril ne fut pas retenue. » […]
« À Capetown, à Port Elizabeth, à East London, à Pretoria et à Durban, des dizaines de milliers de personnes assistèrent aux réunions, et manifestèrent leur appui à la campagne qui allait s’ouvrir. » […]
« L’objectif de la campagne était justement de lutter contre ces lois injustes et tyranniques. Notre intention était de désobéir à ces lois, de supporter arrestations, voies de fait et sanctions pénales s’il le fallait sans recourir à la violence. La méthode adoptée consistait à se répandre par groupes de « volontaires », soigneusement entraînés à désobéir publiquement. » […]
« EUROPÉENS SEULEMENT. Gares, salles d’attente, bureaux de poste, bancs publics, trains omnibus, tous portent cette inscription. Nos volontaires devaient cesser de faire usage des facilités « distinctes mais injustes » qui nous étaient réservées pour jouir, par manière de défi, des privilèges destinés aux Blancs. Notre détermination fut encore accrue par cette dérision représentée par les règlements de couvre-feu et des laissez-passer.
« Le Natal et Capetown ajournèrent leur action jusqu’à ce qu’ils fussent prêts, mais le reste du pays entra en action le 26 juin, ainsi qu’il avait été prévu. Chaque fois que ce fut possible, nous avertîmes en détail les autorités intéressées des desseins de chaque fournée de volontaires et, dans certains cas, des listes entières portant les noms des volontaires engagés leur furent courtoisement remises. En juillet, les deux Congrès du Natal se joignirent à nous. Au cours des trois mois suivants, la Campagne de défi acquit une force vive. Octobre, avec nos deux mille trois cent cinquante-quatre résistants, fut le mois qui marqua l’apogée de cette période de la campagne. Il est hors de doute qu’un succès considérable était en chemin et, à mesure qu’il progressait, le mouvement acquérait de plus nombreux soutiens. Cette campagne de défi apparaîtra comme la première brèche d’importance pratiquée dans les défenses de la suprématie occidentale. » […]
« Leur discipline était irréprochable. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’ils furent jamais domptés, car on pouvait clairement discerner en eux le nouvel esprit militant, mais ils étaient freinés, se conduisaient bien et nul détachement de volontaires ne s’émancipa jamais. À aucun moment ne furent suggérés le désordre ou la violence. Le Eastern Cape (Port Elizabeth et East London) s’organisa brillamment, et le Reef maintint sa pression. Le Natal se laissa distancer en ce qui concernait l’exécution. Les meetings en masse remportaient un certain succès, mais le nombre des enrôlements ne fut pas aussi élevé que l’enthousiasme des manifestants nous l’avait laissé prévoir. Ce fut une salutaire leçon.
« À Durban, nous prîmes pour principe de n’envoyer nos groupes de volontaires, indiens et africains, qu’après leur avoir donné des instructions sur ce qu’ils avaient à faire et comment se comporter. Invariablement, nous informâmes la police avant le départ de chaque fournée. La police locale de la circulation fut certainement mise à l’épreuve, et ils en vinrent à compter sur notre aide. Une fois, ils furent pris de court, et nous eûmes à régler nous-mêmes la circulation. Cependant, pas une occasion ne se produisit sans que la discipline fût impressionnante. Notre plus grand problème, ce n’était pas les volontaires, mais bien la foule des spectateurs.
« Bientôt, la Durban Corporation introduisit et fit voter une loi additionnelle leur donnant des pouvoirs supplémentaires pour contrôler les meetings et les défilés. Aussitôt que nous en eûmes vent, nous leur lançâmes un défi, et nous écrivîmes à la municipalité pour annoncer que notre prochain meeting serait tenu dans Red Square. Comme de juste, la branche spéciale arrêta Naicker, moi-même et plusieurs autres, mais leur difficulté consista à disperser l’énorme foule qui s’était rassemblée à cet endroit. Bien que sous mandat d’arrêt, nous fîmes le travail à leur place, après quoi nous nous rendîmes au bureau central où nous eûmes la surprise de nous trouver au milieu d’une nuée de policiers armés jusqu’aux dents. (Nous fûmes accusés. Nous comparûmes devant le tribunal. Le cas fut ajourné. À ce que je crois savoir, c’est ainsi que cela se passe.)» […]
« Je me suis engagé à servir la politique de l’ANC. La direction que nous avons choisie est la seule voie qui nous soit ouverte pour montrer notre opposition à des lois qui ne reposent pas sur des bases morales. Je n’ai pas demandé au peuple de devenir criminel ou d’agir de façon criminelle. Notre motif est un motif politique. C’est l’unique moyen que nous ayons à notre disposition pour mettre en lumière notre condition, et appuyer notre refus d’être gouvernés selon des lois criminelles. Notre espoir est que le peuple blanc prendra nos doléances en considération, nous prendra nous-mêmes au sérieux, et se rendra compte que tout cela, pour nous, est en effet très sérieux. La Campagne de défi est une démonstration « politique » contre des lois de discrimination. »
Quand la chaîne casse
« Un autre genre de provocation encore marqua les émeutes de 1952. L’ordre, la méthode, le succès de notre Campagne de défi, son renforcement n’étaient pas du goût du gouvernement. Si les partisans de la suprématie des Blancs réagissaient d’une manière civilisée au défi que nous leur lancions, leur dessein était que les arrestations continuent indéfiniment. En dehors des milliers d’arrestations, il y en eut davantage, bien davantage. Ce défi qui s’accompagnait de non-violence était plus qu’ils ne pouvaient supporter, car cela les privait de prendre eux-mêmes l’initiative. D’un autre côté, si les Africains commettaient des violences, cela leur permettrait de sortir leurs fusils, d’user des autres techniques d’intimidation et de se présenter comme des restaurateurs de l’ordre public.
« Ce fut exactement ce qui arriva, et au moment le plus favorable pour le gouvernement. L’infiltration d’« agents provocateurs » aussi bien à Port Elizabeth qu’à Kimberley a été établie, ce qui est nettement apparu aux yeux des volontaires et des membres du Congrès. Ces agents provocateurs accomplirent leur besogne parmi des jeunes gens irresponsables – plus de la moitié de ceux qui furent chargés plus tard à Port Elizabeth étaient des mineurs.
« C’était tout ce qu’il fallait au gouvernement. Émeute et Campagne de défi furent immédiatement identifiées l’une avec l’autre dans l’imagination des Sud-Africains blancs. L’initiative revenait au gouvernement. » […]
« Chacun sait que le gouvernement usa de son initiative recouvrée de la façon la plus dure et la plus totale. D’abord par proclamation, puis dès que le Parlement se fut rassemblé, au moyen de la loi d’amendement à la loi criminelle et de l’acte de sécurité publique, par lesquels ils prirent de rigoureuses sanctions contre tous ceux qui avaient pris part à quelque acte de défi ou à la résistance passive. Les activités des émeutiers fournirent un bon prétexte pour écraser les manifestants non violents, et il fut déclaré illégal de défier quelque loi que ce soit par manière de protestation.
« La campagne continua encore un certain temps. L’organisation qui était derrière elle ne fut pas ébranlée. À Port Elizabeth, le 10 novembre, un jour passé sans sortir de chez soi fut décrété en protestation du couvre-feu nouvellement imposé, et remporta un succès inhabituel ; en effet, quatre-vingt-seize pour cent de la population l’observa.
« Néanmoins, la fin était en vue. La dureté de l’action gouvernementale avait effrayé quelques-uns. Ce qui était plus important, c’est que notre peuple savait pertinemment que les Blancs essayaient d’attribuer les émeutes à notre campagne. Voilà comment nous, Africains, nous sommes disposés à user de violence : plutôt que d’être identifiés – même faussement – aux troubles qui avaient éclaté, bon nombre d’entre nous préférèrent abandonner toute action. » […]
« Bientôt, nous mîmes officiellement un terme à la campagne, plutôt un peu trop tard. Son échine avait été bel et bien rompue avant cela, grâce à l’habileté avec laquelle les troubles avaient été pris en main et utilisés par les autorités.
« C’est ainsi que se termina une année qui changea le caractère politique de l’Afrique du Sud. Les Blancs enregistrèrent plusieurs progrès vers la pratique de l’autorité. Parmi les Africains et les Indiens et, quoique en nombre plus restreint, parmi les gens de couleur, l’esprit d’opposition restait vivant ; on ne consentait plus à être gouverné uniquement par les Blancs et pour les Blancs. Les buts étaient devenus clairs. » […]
Après le défi
« Au cours de la Campagne de défi, nous apprîmes aussi que les acclamations qui saluent la résistance lors de meetings en masse ne conduisent pas nécessairement à la mettre en pratique. Il est plus facile de mêler sa voix à celle de cinq mille spectateurs que d’aller au-devant de la détention en compagnie de vingt autres. Notre mouvement fut bien appuyé, il réussit, aussi les pusillanimes n’y mirent-ils pas obstacle. Il convenait pourtant de ne pas négliger un certain manque de courage, et reconnaître que quelques-uns de nos compatriotes pouvaient être effrayés par la sévérité des mesures prises, et céder à l’intimidation. »
Quelle est la route qui conduit à la liberté
« Il n’est pas possible de prévoir quand viendra la fin. Si nous n’avons à compter que sur l’effort que nous sommes capables de fournir chez nous, la fin viendra, mais elle risque de se faire attendre. La suprématie blanche s’équipe pour lutter jusqu’au bout. Plus longtemps elle persistera, plus elle aura recours aux sévices et à la violence. Je ne me fais pas d’illusions en imaginant que les camps de concentration, le terrorisme et le meurtre légal par les forces de l’armée et de la police cesseront brusquement.
« Mais au moins l’Afrique du Sud blanche s’est aperçue, avec surprise et embarras, qu’elle n’a pas en main toutes les clefs de son propre avenir. Elle a essayé d’être isolationniste, mais elle s’est trouvée sur un continent qui s’éveillait rapidement, et dans un monde qui la surveillait de près. Ce qui survient ailleurs nous affecte ici. L’indignation des autres nations peut avoir une portée pratique sur le cours des événements d’Afrique du Sud. C’est pourquoi nous, Africains, avons observé la montée de cette indignation avec un espoir croissant. » […]
« Je ne prétendrai pas que l’ostracisme économique de l’Afrique du Sud soit désirable à tous points de vue, mais j’ai tendance à croire qu’il représente notre seule chance d’une transition relativement « pacifique » entre l’inacceptable mode de gouvernement actuel et un système de gouvernement qui nous reconnaisse à tous nos droits de vote légitimes. Il n’y a qu’à laisser les choses suivre leur cours, tandis que l’Afrique du Sud blanche gagne son pain sur les marchés internationaux grâce à la sueur qui coule des fronts africains. Chez nous, nous ne serons plus maîtres de la situation, et quand tous les chefs africains auront été écartés, la violence, l’émeute et la contre-émeute seront à l’ordre du jour. Cela ne peut dégénérer qu’en désordre et finir par un désastre définitif.
« Le boycottage économique de l’Afrique du Sud entraînera sans aucun doute une période d’épreuves pour les Africains. Nous le savons. Mais si cette méthode doit abréger le temps du massacre, notre souffrance est un prix que nous sommes disposés à payer. Déjà nous souffrons, nos enfants sont souvent sous-alimentés, et à certain degré (jusqu’ici) nous mourons si tel est le caprice d’un policeman.
« À l’extérieur, le monde libre n’a pas besoin d’intervenir physiquement ni à veiller en vain. Si un naufrage se produit, il y a beaucoup à sauver. Et je ne peux pas penser que si ce pays se trouve annihilé pour un temps comme le gouvernement nationaliste nous en menace, ce sera dans l’intérêt des démocraties. Le mode de gouvernement qui peut surgir à la fin d’une longue période de désordre civil allant en s’aggravant, ne peut être prédit, mais il n’est pas trop tard pour apporter une véritable démocratie en Afrique du Sud. Je ne crois pas qu’elle viendra jamais « spontanément » des Blancs. Quand même, cela pourrait se faire « pacifiquement ».
« La tragédie, c’est que la grande majorité des Blancs sud-africains sont résolus à ne permettre aucune évolution pacifique. Ils ont si longtemps refusé de s’adapter, ils ont si longtemps proclamé que c’est par eux que viendra tout équilibre qu’ils semblent n’être plus capables maintenant que de manifester leur intransigeance. C’est vraisemblablement cette attitude qui rend difficile sinon impossible toute négociation ou tout compromis. Chaque nouveau défi amène un nouvel endurcissement de leur cœur. » […]
« Dans notre empressement à hâter dans notre pays l’évolution pacifique de la politique de non-violence, nous observons de près le monde extérieur en particulier ceux qui sont mêlés aux fruits du travail africain grâce au commerce qu’ils font avec notre pays.
« Notre mouvement de libération a reçu une vive impulsion par suite de la réussite d’autres pays tels que l’Inde et le Ghana qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont obtenu leur indépendance.
« La façon dont l’Inde, à l’ONU, a pris la défense de la majorité opprimée sud-africaine et exhibé au grand jour le scandale de l’apartheid a infiniment ranimé notre courage et, en Afrique, le petit Ghana étincela tout à coup. » […]
« Il ne fait pas de doute que l’Afrique du Sud blanche, prise d’un malaise qui va s’accroissant, tergiverse et essaie de crâner.
« Mais c’est le boycottage mondial grandissant et le repli – le très sage repli – des capitaux étrangers fuyant l’Union, qui les secoua le plus. »
Albert Luthuli