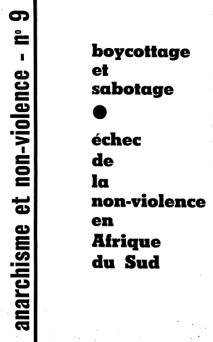Jetons maintenant un regard en arrière. Au départ, nous nous trouvions devant la première expérience consciente de non-violence, la première campagne de Gandhi. À la suite de cela une longue période de quelque quarante ans que les détracteurs de la non-violence veulent considérer comme réellement non violente parce que le souci du respect de la légalité a été le caractère dominant. Il est important de dénoncer cette erreur d’appréciation du phénomène. Nous avons été habitués de notre côté à cette opposition restreinte pendant la guerre d’Algérie lorsqu’on se contentait de signer des pétitions, lorsqu’on se limitait à des oppositions et à des condamnations verbales et écrites. La troisième période, que nous pouvons considérer comme non violente classique, débute avec la Campagne de défi accompagnée du boycottage. Nous déterminons maintenant une quatrième période qui est le sabotage que Mandela se garde bien de confondre avec le terrorisme. En fonction de nos conceptions de la non-violence, qui distinguent différents degrés dans la destruction, nous pouvons estimer que le souci du respect de la vie démontré dans la pratique du sabotage selon Mandela peut faire accepter cette forme de sabotage par un certain nombre d’entre nous. Il semble évident que le stade suivant, autrement dit la guérilla, sera la limite que nous nous donnerons. Encore que, dans une situation où aucune possibilité non violente ne se présenterait, il est possible, de Ligt l’avait déjà exprimé avant nous, de collaborer avec les révolutionnaires partisans de l’action violente traditionnelle sous des formes qu’il reste à chacun de déterminer.
Nous avons cru utile d’examiner ce que représente le sabotage afin d’éclairer notre position à ce sujet, puis d’essayer de le définir soucieux que nous sommes de ne pas rester des puristes sans prise sur la réalité. Nous sommes conscients qu’il n’existe pas deux catégories hermétiques l’une à l’autre, d’un côté les violents de l’autre les non-violents. La réalité ne présente jamais de tels absolus. Il est facile de donner une image caricaturale du violent et du non-violent, la réalité est tout autre, et si à priori on se classe dans l’une ou l’autre tendance, en fait les situations nous amènent à des positions plus nuancées que nous voudrions dépourvues de tout sectarisme.
Le sabotage n’était encore au siècle dernier qu’un terme argotique, signifiant non l’acte de fabriquer des sabots, mais celui, imagé et expressif, de travail exécuté « comme à coups de sabots », de travail grossièrement bâclé.
C’est au congrès de la CGT, tenu à Toulouse en 1897, qu’il reçut le baptême du feu comme procédé méthodique de lutte ouvrière. La résolution présentée par Delessalle au sujet du boycottage et du sabotage fut adoptée à l’unanimité. Elle stipulait : « Chaque fois que s’élèvera un conflit, que celui-ci soit dû aux exigences patronales ou à l’initiative ouvrière et, au cas où la grève semblerait ne pouvoir donner les résultats escomptés, que les travailleurs appliquent le boycottage ou le sabotage ou les deux simultanément. »
Dès lors, anarchistes et syndicalistes révolutionnaires le préconisèrent sans relâche tandis que les socialistes dans leur majorité, non seulement ne le recommandèrent jamais, mais le réprouvèrent hautement dans la lutte ouvrière, le jugeant préjudiciable à la valeur technique et à la qualité de l’ouvrier, qu’il était censé diminuer vis-à-vis de lui-même ; le considérant au plus haut point destructeur, puisque réduisant le patrimoine dont le monde du travail devait un jour devenir héritier.
Cette thèse fut à l’époque durement combattue par les partisans du sabotage, qui considéraient en effet et, semble-t-il, à juste raison, que si effectivement le sabotage pouvait parfois amener des destructions sérieuses, dans sa forme la plus épurée, il n’était par contre qu’un ralentissement de production, une « grève en travaillant », « une grève sur le tas» ; et que si, en d’autres cas, il consistait en travail bâclé ou mal fait, il pouvait aussi prendre une forme positive : la « grève du zèle » ou la « grève perlée », celle-ci consistant à fignoler le travail, à le « perler », au point que le patron y perde des bénéfices certains. Ce procédé, négligé par les détracteurs du sabotage, permettait pourtant dans tous les cas de sauvegarder les qualités morales et techniques de l’ouvrier, mises en cause par les socialistes. On aurait cependant tort de croire que la classe ouvrière aurait attendu la consécration par un congrès corporatif pour pratiquer le sabotage. Il en est de lui comme de toutes les formes de révolte, il est vieux comme l’exploitation humaine.
À propos des émeutes de Lyon, en 1831, Balzac écrivait dans « la Maison Nucingen » : « Le canut, probe jusque-là, rendant en étoffe la soie qu’on lui pesait en bottes, a mis la probité à la porte en songeant que les négociations le victimaient, et il a mis de l’huile à ses doigts : il a rendu poids pour poids, mais il a rendu la soie représentée par l’huile et le commerce des soies a été infesté d’étoffes graissées. »
Le sabotage est également pratiqué depuis longtemps outre-Manche, sous le nom de Ca’ Canny ou Go’ Canny, mot de patois écossais signifiant à peu près : ne vous foulez pas.
À Glasgow, en 1889, une grève de dockers éclata pour une augmentation de salaires refusée. Les employeurs embauchèrent des ouvriers agricoles pour remplacer les grévistes et ceux-ci durent s’avouer vaincus. Au moment de reprendre le travail, leur secrétaire syndical les rassembla et leur dit : « Les employeurs ont dit et répété qu’ils étaient enchantés des services des ouvriers agricoles qui nous ont remplacés pendant la grève. Nous les avons vus ; nous avons vu qu’ils ne savaient même pas marcher sur un navire, qu’ils laissaient choir la moitié de la marchandise, bref que deux d’entre eux ne faisaient pas la besogne d’un de nous. Cependant les employeurs se déclarent enchantés de leurs services ; il n’y a donc qu’à leur en fournir du pareil et à pratiquer le ca’canny. »
La consigne fut appliquée pendant quelques jours, puis les employeurs convoquèrent le secrétaire syndical et lui firent demander aux dockers de travailler comme avant, moyennant quoi ils accordaient les dix centimes d’augmentation réclamés.
Le go’canny consiste en quelque sorte à mettre en pratique la vieille formule ouvrière : « À mauvaise paie, mauvais travail. »
En 1881, déjà, le sabotage fut pratiqué méthodiquement par les télégraphistes du bureau central de Paris. Ceux-ci réclamaient une augmentation du taux de leurs heures supplémentaires, aucune suite n’étant donnée à leur revendication, ils décidèrent d’agir et un beau matin Paris tout entier se réveilla privé de télégraphe et isolé (le téléphone n’était pas encore installé). Pendant quatre ou cinq jours, techniciens et ingénieurs s’évertuèrent à déceler la « panne » provoquant l’arrêt des appareils, mais vainement. Le cinquième jour, les revendications étaient satisfaites et le télégraphe remis, discrètement mais immédiatement, en ordre de marche. Le motif et les auteurs de la « panne » ne furent jamais connus ni même soupçonnés.
Au congrès des cuisiniers, en 1898, un délégué se tailla un beau succès en narrant avec humour le drolatique cas de sabotage suivant : Les cuisiniers d’un grand établissement parisien ayant à se plaindre de leur patron restèrent à leurs postes toute une matinée fourneaux allumés, mais au moment où les clients affluèrent il n’y avait dans les marmites que des briques cuisant à grande eau… en compagnie de la pendule du restaurant :
En 1910, Émile Pouget, un des promoteurs du sabotage ouvrier, écrivait : « L’exploiteur choisit habituellement, pour augmenter la servitude ouvrière, le moment où il est le plus difficile de résister par la grève, seul moyen employé jusqu’alors ; avec le sabotage, il en est tout autrement, les travailleurs peuvent désormais résister sans perte de salaire et sans crainte, ils ont en main un moyen infaillible d’affirmer leur virilité. » Et il ajoute : « Le sabotage est dans la guerre sociale ce que sont les guérillas dans les guerres nationales. Il découle des mêmes sentiments, répond aux mêmes nécessités et a sur la mentalité ouvrière d’identiques conséquences. On sait combien les guérillas développent le courage individuel et l’esprit de décision ; autant peut s’en dire du sabotage : il tient en haleine celui qui le pratique et a l’heureux résultat de développer l’esprit d’initiative, d’habituer à agir soi-même, de surexciter la combativité. »
Le ralentissement instinctif du travail est la forme primaire du sabotage, ainsi à Beaford aux États-Unis, en 1908, une centaine d’ouvriers furent avisés qu’une réduction de salaire leur serait imposée. Sans mot dire, ils se rendirent à une usine voisine et firent rogner leurs pelles d’une certaine longueur. Après quoi ils revinrent au chantier et répondirent au patron qui s’étonnait : « À petite paie, petite pelle. »
Cette forme de sabotage n’est bien sûr praticable que par des ouvriers travaillant à l’heure ou à la journée, mais le sabotage peut aussi être pratiqué avec succès par les travailleurs aux pièces.
Ici la ligne de conduite diffère : restreindre la production serait restreindre le salaire, il faut appliquer le sabotage à la qualité au lieu de la quantité. Le travailleur atteindra alors le patron dans sa clientèle et par là même dans ses bénéfices.
En 1900, le bulletin de la Bourse du travail de Montpellier proposait à ses lecteurs : « Si vous êtes mécanicien, il vous est très facile avec une poudre quelconque, ou même avec du sable, d’enrayer votre machine, d’occasionner une perte de temps et une réparation coûteuse à votre exploiteur. Si vous êtes ébéniste, quoi de plus facile que de détériorer un meuble, sans que le patron s’en aperçoive et de lui faire perdre ainsi des clients ? Un tailleur peut aisément abîmer un habit ou une pièce d’étoffe ; un marchand de nouveautés avec quelques taches adroitement posées sur un tissu le fait vendre à vil prix ; un garçon épicier, avec un mauvais emballage, fait casser la marchandise ; c’est la faute à n’importe qui et le patron perd le client. »
Ainsi donc, les procédés de sabotage sont variables à l’infini, il est une qualité qui est par contre exigée des militants qui l’emploient : c’est que leur mise en pratique n’ait pas de répercussions fâcheuses et directes sur le client, sur le consommateur. Le sabotage doit s’attaquer au patron, soit par le ralentissement du travail, soit en rendant les produits visés invendables, soit encore en immobilisant les instruments de production. Le consommateur ne doit en aucun cas souffrir de cette guerre faite à l’exploiteur.
La pratique du sabotage peut encore dans d’autres circonstances prendre des allures différentes : le procédé dit « de bouche ouverte » entre autres. C’est à lui que recourent les ouvriers du bâtiment qui dévoilent à l’architecte, ou au propriétaire qui fait bâtir, les malfaçons de l’immeuble qu’ils viennent de terminer, malfaçons ou malversations ordonnées par les entrepreneurs et à leur profit : murs manquant d’épaisseur, emploi de matériaux de mauvaise qualité, couches de peintures escamotées, etc.
Le sabotage envisagé sous ces différentes formes permet la protestation ouvrière sans abandon du travail, donc sans perte de salaire. Il peut aussi s’étendre beaucoup plus loin, et Bousquet, secrétaire du syndicat des boulangers, déclarait en 1905 : « Nous pouvons constater que le simple arrêt de travail n’est pas suffisant. Il serait nécessaire et même indispensable que l’outillage, c’est-à-dire le moyen de production, soit réduit à la grève, autrement dit, rendu improductif par non-fonctionnement, car quand les renégats vont travailler, ils trouvent les machines, les outils en bon état, et ce par la suprême faute des grévistes qui, ayant laissé en bonne santé ces moyens de production, ont laissé derrière eux la cause de leur échec revendicatif. Le premier devoir avant la grève est donc de réduire à l’impuissance les instruments de travail. C’est l’abc de la lutte ouvrière. À ce moment, la partie devient enfin égale entre le patron et l’ouvrier, car alors la cessation du travail est réelle. Elle produit le but recherché : l’arrêt de la vie dans le clan bourgeois. »
Peu de temps après, Renaud, employé des chemins de fer de l’Ouest-État, ajoutait : « Pour être certain du succès, au cas où la majorité des employés ne cesseraient pas tout de suite le travail, il est indispensable qu’une besogne dont il est inutile de donner ici une définition soit faite au même instant dans tous les centres importants, au moment de la déclaration de grève. Pour cela, il faudrait que des camarades résolus, décidés et connaissant au mieux les rouages des services, sachent trouver les points sensibles et frappent à coups sûrs sans faire de destructions imbéciles. »
Après ces déclarations, nous pouvons conclure qu’il en est du sabotage sous ses diverses formes, comme de tous les autres procédés ou tactiques de lutte : la justification de leur emploi découle des buts poursuivis. C’est à cette préoccupation qu’il y a quelques dizaines d’années les employés de la compagnie des tramways de Lyon obéissaient, qui, pour rendre la circulation impossible aux tramways conduits par des renégats, coulaient du ciment dans les aiguillages des rails. C’est aux mêmes besoins que répondirent les employés des chemins de fer du Médoc, en 1908, qui, avant de suspendre le travail, eurent soin de couper les lignes téléphoniques reliant les gares, dévissèrent les organes de prise d’eau des locomotives et les cachèrent pendant toute la durée de la grève.
À chaque cas précis s’adapte une manière originale de lutte.
À Philadelphie, dans une grande maison de fourrure, avant de quitter le travail, chaque coupeur modifie ses patrons de coupe. Les renégats embauchés se mirent au travail avec les patrons « sabotés » et au moment de l’assemblage ce fut le plus grandiose des gâchis. Le patron, après une perte énorme de dollars, fut dans l’obligation de réembaucher les grévistes. Chacun reprit alors son poste après avoir reçu satisfaction et, réajustant ses patrons de coupe, se remit à l’ouvrage.
Outre les procédés indiqués ci-dessus, il en est un qui se développa énormément vers 1910, après les grandes grèves des postiers : le sabotage répressif. À la suite de la deuxième grève des postiers, des groupes révolutionnaires décidèrent de saboter les lignes téléphoniques pour protester contre les licenciements de plusieurs centaines de grévistes, annonçant leur intention de ne cesser leur guérilla qu’après réintégration des révoqués. Pour ce faire, un comité clandestin expédia à des camarades sûrs, et dans tous les secteurs, une circulaire anonyme leur donnant toutes indications techniques. L’hécatombe fut considérable sur tous les points du territoire, et le groupe de Joinville à lui seul ne coupa pas moins de 795 lignes entre le 8 et le 28 juillet 1910. Aucun des auteurs de ces actes ne fut découvert par les autorités et un accord intervint bientôt avec les compagnies de téléphone.
Une autre forme de sabotage peut aussi être utilisée ; elle est surtout usitée dans les pays germaniques et en Italie. C’est l’obstructionnisme ou grève du zèle. Employée dans les chemins de fer de ces pays, elle donna à maintes reprises satisfaction à ses utilisateurs. Quelques autres corporations l’employèrent également avec succès en Autriche : les employés des postes et les typographes notamment.
Ces dernières années, de nombreuses grèves du zèle ont également perturbé les postes douaniers français et chaque fois satisfaction, au moins partielle, a été accordée.
Il paraît, à la lecture de ces lignes, que le sabotage s’est avéré fort rentable dans le passé sur le plan ouvrier et syndical. Peut-il en être de même dans d’autres domaines, est-il possible d’en tenter l’expérimentation ?
Barthélemy de Ligt, anarchiste et pacifiste hollandais, auteur dans les années 30 d’un « Plan de mobilisation contre la guerre », l’envisageait dans celui-ci comme une des formes essentielles du combat contre la guerre. « Tant sur le plan individuel que collectif, il suffit d’une poignée de militants convaincus pour réaliser un énorme travail. Il faut rendre inutilisables, en cas de mobilisation et de guerre, les ponts, les routes, les rails, etc., et détruire, partout où cela est possible de le faire sans attenter à la vie humaine, les armes, les munitions et tout matériel de guerre entreposés. Pratiquer partout l’opposition technique (autre appellation du sabotage proposée par B. de Ligt) en préférant toutefois, dans les cas où cela se peut, la reconversion en moyens de paix des moyens de guerre visés. »
Pendant la dernière guerre mondiale, les appels quotidiens de la radio gaulliste poussaient au sabotage et tous les organismes de résistance l’employèrent alors, plus ou moins heureusement. Les résultats furent néanmoins souvent probants et avancèrent singulièrement la fin des hostilités.
Ce sera désormais à nous, dans les études qui suivront, de découvrir les possibilités que peuvent, sur le plan de notre combat anarchiste et non violent, nous fournir ce moyen adéquat pour des minorités décidées, actives et conscientes.
Lucien Grelaud
Bibliographie concernant le boycottage et le sabotage
Livres et brochures :
- CGT : « Boycottage et sabotage », Paris, 1897.
- E. Pouget : « Le Sabotage », Paris, 1910.
- M. Leroy : « La Coutume ouvrière », Paris, 1913.
- Compère-Morel : « Grand dictionnaire socialiste », Paris, 1924.
- B. de Ligt : « la Paix créatrice », Paris, 1934. « Plan de mobilisation », Bruxelles, 1934. « Pour vaincre sans violence », Paris, 1935.
- et l’article de Claude Bourdet:«Boycotterons-nous les produits américains ? (« Alerte atomique », n° 11, déc. 1966).