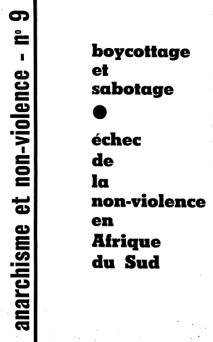Dans le numéro 6 de notre revue, traitant plus précisément de la violence et de la non-violence chez les anarchistes au travers de leurs écrits et de leurs actes, il nous a paru, à tort ou à raison, qu’une sorte de progression chronologique se faisait vers une prise de conscience du phénomène de non-violence, et que, comme à partir de 1890 les anarchistes entrèrent dans les syndicats, actuellement, une tendance s’esquisse vers l’utilisation de la non-violence comme moyen. Nous ne nions en aucune façon la persistance de mouvements anarchistes violents et ne prétendons pas qu’ils sont périmés. Si maintenant nous nous tournons vers une réalité précise, l’Afrique du Sud, et si nous analysons rapidement son évolution depuis un peu moins d’un siècle, nous sommes amenés à déclarer avec tout le monde : « L’Afrique du Sud est l’exemple précis de l’échec flagrant des techniques non violentes. »
Si nous partons de la première expérience non violente de Gandhi, prolongée par l’African National Congress avec un caractère différent, plus modéré, qui se termine avec l’emploi du sabotage restreint puis la préparation à la guérilla, nous dirons que la réalité de ce processus historique contredit notre conclusion quant au mouvement anarchiste. Dans quelle mesure cependant pouvons-nous tracer ce parallélisme ? Qu’en est-il exactement ? Il n’est sans doute pas possible de répondre totalement. Cependant nous tentons aujourd’hui une approche en ouvrant ce dossier et nous esquissons quelques réflexions vers ce qui serait notre solution.
Quelques textes d’Albert Luthuli et de Nelson Mandela, une double étude sur le boycottage et le sabotage, une analyse un peu plus précise d’une expérience de boycottage, d’autre part un document sur l’échec de la non-violence en Afrique du Sud sont les éléments qui composent ce numéro. Nous voudrions que ce travail préliminaire devienne le début d’une réflexion plus étendue et plus profonde avec la collaboration de nos lecteurs. L’expérience sud-africaine doit servir de leçon pour toute action future en France ou ailleurs. Toute conclusion, si peu formulée soit-elle, implique un engagement dans un sens ou un autre. On pourra nous dire qu’un problème plus important devrait nous occuper, le Vietnam, mais nous verrons que toute conclusion sur le boycottage à propos de l’Afrique du Sud ouvre des possibilités d’application au problème vietnamien.
Quelques dates
La non-violence de Gandhi :
- 1893. Gandhi a 24 ans, il part pour l’Afrique du Sud.
- 1896. Fondation de la communauté de Phœnix d’où il se prépare à l’action future.
- 1898. Naissance de Luthuli, 30 ans de différence d’âge avec Gandhi.
- 1906 – 1913. Premier satyagraha indien dirigé par Gandhi pour lutter contre la restriction des droits et des libertés des colons indiens (plusieurs milliers de combattants).
La non-violence modérée dans la légalité :
- 1912 Création du Congrès national indigène de l’Afrique du Sud qui décide d’utiliser les voies légales en faveur du peuple africain opprimé, il réclame la disparition de la barrière de couleur au parlement, à l’école, dans l’industrie et dans l’administration. En 1925, le CNIAS prend le nom d’ANC : African National Congress. Pendant trente-sept ans, l’ANC s’en tient strictement à une lutte dans le respect de la Constitution.
- 1918. Naissance de Nelson Mandela, 20 ans de différence d’âge avec Luthuli.
La non-violence par l’action directe :
- 1949. Les membres de l’ANC se rencontrent pour élaborer un programme d’action qui représente un changement fondamental des méthodes de l’ANC. Tout en restant pacifiques, ils choisissent l’illégalité.
- 1952. La Campagne de défi.
- 1960. Fusillade de Sharpeville : l’ANC, hors la loi, entre dans la clandestinité.
Le sabotage :
- 1962. Procès de Mandela.