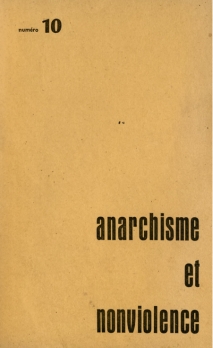« Peace News » est un hebdomadaire de langue anglaise qui est ouvert à tous les mouvements et à tous les individus travaillant directement ou indirectement pour la paix. On y trouve des articles, entre autres, du Comité des 100 et de la CND (équivalent du MCAA), dénonçant la bombe, le racisme (en particulier aux États-Unis et en Afrique du Sud), le fascisme qui se maintient en Espagne et s’installe en Grèce. Des numéros à thème étudient le régime pénitentiaire, l’objection de conscience, les hôpitaux psychiatriques. L’esprit général est non violent et pour l’action directe non violente. L’article ci-dessous, traduit par Michel Bouquet, est extrait du numéro 1600, du 28 avril 1967 de « Peace News » (5, Caledonian Street, London N 1).
Face à la guerre au Vietnam, « protester est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre… il y a trop à faire ». Les membres de la Ligue de résistance à la guerre de Californie du Nord, convaincus de la nécessité de faire quelque chose de tangible, se sont attaqués à un point précis : discuter avec les firmes qui travaillent pour la guerre et essayer de les persuader de ne plus le faire.
Nous avons appris qu’une petite usine fabriquait des dispositifs vaporisateurs qui servent à déverser défoliants et insecticides sur le Vietnam. L’usine avait moins de cinquante employés, et au moins 50 % de son travail n’avait rien à voir avec la guerre ; elle n’était pas si grande ni si complètement engagée dans la guerre que nos efforts soient futiles, et nous pensions que c’était un endroit convenable pour un début.
Nous avons écrit à l’usine pour expliquer notre position, nous n’attendions pas une réponse et nous n’en avons pas eu. Nous avons été voir le patron pour lui demander d’arrêter la production pour la guerre. Il n’a pas voulu discuter, et au fond nous ne souhaitions pas discuter avec lui. Nous aurions été très surpris et déçus si nous l’avions persuadé. Nous n’avons fait cela qu’afin qu’il ne puisse pas dire après les manifestations (picketings) que nous n’avions jamais exposé notre cas. Nous voulions le forcer à changer par des piquets, en nous asseyant sur les lieux, en le poursuivant par une présence continuelle. Nous voulions que se développe une splendide campagne susceptible d’attirer la presse.
Nous avons appelé à un meeting pour organiser la campagne et nous nous sommes trouvés en face de questions embarrassantes :
- Quelle est la différence entre persuasion et force ?
- Est-il possible de contrôler la manifestation convenablement une fois qu’une attitude de conflit s’est développée ?
- Qu’est-ce que la non-violence ?
- En quoi cette campagne allait-elle être différente des précédentes ?
Nous avions créé une campagne réalisable immédiatement, mais était-ce ce que nous voulions ?
Ces questions nous ont amenés à quelque chose d’étrange : nous avons tout arrêté, « décommandé » la campagne et commencé une série de discussions pour considérer les implications de nos actions et pour définir davantage ce que nous entendions par non-violence.
Un mois plus tard, nous avons écrit : « On doit se présenter non en donnant l’impression que nous tranchons entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais en voulant discuter ce que nous croyons être bon et ce que nous croyons être mauvais. On ne peut dialoguer quand on commence par prétendre avoir raison. »
Nous avons choisi de tenter d’infléchir une petite entreprise qui était directement engagée dans l’effort de guerre dans un sens qui s’éloigne sans équivoque de la guerre.
Expériences – Vérité
Nous avons spécifié un « petit » changement car un petit changement, c’est une occasion de démarrer qui soit à la fois possible et pleine de signification.
Nous n’avons pas cru qu’un dialogue puisse s’engager sérieusement avec le gouvernement ou une entreprise vraiment importante. Nous ne serions pas pris au sérieux. Et si nos actions ne sont pas prises au sérieux, ce ne sont pas des actions sérieuses. Et si nous ne pouvons pas être sérieux, pourquoi envisager quoi que ce soit ? En quel sens une tentative de mener à bien un petit changement serait signifiante ? Cela pourrait servir de test pour la non-violence et le problème de la guerre, une expérience de contact, un test-vérité. Le mouvement pacifiste n’a pas d’exemples à donner, il y a des anecdotes et des descriptions comme Polaris et Everyman, mais aucune expérience authentique structurée et organisée de telle sorte que le succès ou l’échec puissent être mesurés et que les raisons de cet échec ou de ce succès puissent apparaître clairement. Les mêmes types d’actions qui ne peuvent pas échouer parce qu’ils ne peuvent pas réussir ont été renouvelés maintes et maintes fois.
Si nous sommes prêts à mettre au point un type d’action qui produise une transformation plutôt qu’une catharsis (purification de l’âme) ou une frustration, nous devons être capables de savoir où et pourquoi nous avons échoué et où et pourquoi nous avons réussi, nous devons construire une technique qui puisse vraiment être appelée une expérience, qui puisse vraiment aborder le problème des changements institutionnels.
Avec ces questions et ces idées en tête, nous avons commencé le « projet pour bâtir la paix » afin de « développer une méthodologie non violente pour s’opposer efficacement à l’organisation de la guerre ». Tentant de structurer une expérience utile nous avons mis au point une série de lignes de conduite pour travailler avec les fabricants de matériel de guerre. Nous avons choisi de petites entreprises locales dont l’essentiel du travail n’était pas lié à la guerre, des entreprises que nous pouvions espérer modifier avec un minimum de réalisme.
Nous avons recherché des firmes qui répondaient à ce que nous voulions, puis nous sommes allés leur parler de la guerre. Et quand nous avons essayé de voir comment nous allions parler aux industriels nous nous sommes aperçus que nous ne savions pas quoi dire, qu’après toutes ces années passées à manifester, nous n’aurions pas su quoi dire si quelqu’un nous avait interrogés.
Nous avons commencé par jouer la scène avec différents participants jouant le rôle de l’employeur tandis que d’autres tentaient de le persuader d’arrêter de travailler pour la guerre. Lentement nous avons développé notre dialogue et notre méthode d’approche. Après avoir gagné de la confiance en nous, nous sommes allés chez les industriels. Nous allions deux par deux, « un pour parler l’autre comme observateur ».
Chaque semaine nous passions en revue ce qui s’était passé la semaine précédente et nous faisions de notre mieux pour aider chacun à clarifier sa position. Car il s’est révélé que les seuls arguments que nous pouvions utiliser étaient ceux auxquels chacun de nous croyait vraiment, ceux qui motivaient notre action.
Nous avons finalement commencé à comprendre ce que Gandhi entendait par « expérience dans la vérité ». C’était ce que nous faisions, nous expérimentions l’usage de la vérité. Pas la vérité absolue avec un grand V, mais nos propres vérités expérimentales. C’était et c’est encore le travail le plus dur que nous ayons jamais accompli. Nous avons démoli nos positions et les avons remontées maintes et maintes fois jusqu’à ce que nous développions une confiance et une compréhension de ce que nous croyions que nous n’aurions jamais pensé possible.
Nous avons fait des recherches dans plusieurs centaines de firmes et en avons repéré soixante-quinze. Même les opérations de repérage étaient difficiles. Les toutes premières enquêtes ont été faites par téléphone car les enquêteurs ne se sentaient pas assez de sang-froid pour poser les questions en personne. À notre grande surprise, il y eut très peu de firmes qui refusèrent de répondre à nos questions d’enquête.
Nous avons sélectionné vingt firmes et avons parlé à fond avec les patrons. Il semble qu’il ne reste plus de chauvins. Aucun des industriels auxquels nous avons parlé ne pensait du bien de la guerre et tous convenaient qu’il fallait trouver une autre solution. Le problème, c’est que la plupart n’en voyaient aucune. Quelques-uns étaient favorables à la guerre et s’en sentaient solidaires, mais c’était la minorité. La position la plus commune, c’était « la guerre n’est pas une bonne chose, mais nous ne pouvons faire marche arrière maintenant, nous devons soutenir nos hommes ». Les libéraux étaient fréquemment plus durs que les conservateurs (si on exclut les conservateurs qui voyaient des communistes jusque sous leur lit). Le seul patron à ce jour qui ait accepté de ne plus travailler pour la défense nationale était un conservateur dans la tradition des Whigs. Cette firme emploie cent personnes et fabrique du matériel de télécommunications.
Pour la valeur de l’action
Nous avons choisi deux firmes pour le développement d’une campagne intense que nous venons de commencer. Nous n’avons pas achevé une phase du projet, des enquêtes et des interviews ont toujours lieu pour trouver de nouvelles firmes et pour entraîner de nouveaux militants. Le résultat de nos dialogues c’est une meilleure compréhension de ce que nous essayons de faire et de la façon de le faire.
Quelque action que nous entreprenions, nous devons savoir ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, nous devons savoir à qui nous nous adressons et pourquoi. Nous devons savoir :
- Que ce que nous demandons est raisonnable,
- Comment cela affectera ce que nous essayons d’accomplir,
- Comment cela affectera la personne à qui nous nous adressons,
- Quelles actions nous pouvons mener en accord avec ce que nous voulons.
Nous sommes arrivés à considérer l’action directe comme une simple partie d’une campagne dans laquelle le dialogue est la plus grande partie. Les techniques « des corps allongés » ne peuvent être utilisées que lorsqu’elles augmentent ou préservent les possibilités de dialogue.
Nous avons canalisé notre frustration et notre colère en une activité que nous espérons pleine de sens. Ce n’est pas facile. Nous comprenons qu’afin de soutenir l’activité ce que nous faisons doit être valable en soi et faire partie de ce que nous voulons bâtir. La paix pour laquelle nous travaillons n’est pas la même que celle qui signifie absence de conflits. Le seul monde dans lequel il n’y aurait pas de conflit serait un monde inhabité ! Nous espérons trouver un moyen pour régler les conflits qui apparaisse comme capable de remplacer la guerre. Il n’est pas raisonnable de penser que la guerre disparaîtra avant qu’on ait trouvé ce moyen.
o o o o o o o o o o
Ce projet présente l’intérêt de démontrer le mécanisme d’une action et d’en pouvoir mesurer les processus successifs selon une méthode scientifique ; il montre la nécessité d’étudier minutieusement nos motivations et de leur adapter les actions que nous voulons entreprendre. En particulier, les répétitions avant le dialogue avec les patrons et l’observation pendant la discussion par un deuxième militant de façon à saisir le mécanisme de la pensée et des réactions de l’«autre » et à voir quel est le terrain le plus favorable à sa prise de conscience, visant par-là davantage à le comprendre qu’à le combattre.
De plus, il pose le problème d’une révolution non violente par le dialogue, alternative à la violence révolutionnaire à laquelle aboutit la lutte de classe. Il est significatif, par exemple, qu’ils aient réussi à convaincre un patron de cesser de travailler pour la guerre. Si minime que paraisse ce résultat, il représente un pas accompli, et ce pas n’aurait pu être franchi par la violence :
– D’abord parce qu’une manifestation violente aurait été réprimée par les forces armées et aurait durci ce patron dans des positions militaristes.
– Puis, en admettant que dans une situation révolutionnaire violente on eût pu le contraindre à changer l’orientation de sa production, ce serait malgré lui et en ennemi qu’il aurait cédé, ce qui pose un problème de fraternité dans la révolution difficile à résoudre.
Les amis qui ont réalisé ce résultat n’ont pas vaincu un ennemi, ils ont gagné un homme à la paix. De toute façon, même s’ils n’arrivent pas dans l’immédiat à en convaincre beaucoup d’autres, il reste qu’ils auront accumulé une masse de renseignements matériels et d’ordre psychologique qui permettront d’avancer et de continuer sur des données solides.
Michel Bouquet
o o o o o o o o o o
« Le Cachot », Denis Langlois, Ed. Maspero, 8,90 F
Denis Langlois, emprisonné à Fresnes (cf. ANV, n° 5, juillet 1966) pour refus d’effectuer son service militaire, y rapporte sous la forme d’un récit les quarante-cinq jours qu’il a passés au mitard à la suite d’une pétition dont il était le promoteur.
Les notes suivant ce récit attirent, à mon avis, l’attention, car c’est là qu’il définit sa position d’antimilitariste et soulève le problème du nombre important de jeunes du contingent qui sont emprisonnés chaque année. On y trouve d’ailleurs une position assez ambiguë mettant sur le même pied le coopérant et l’objecteur demandant le statut. Un paragraphe particulier est consacré à la prison de Fresnes proprement dite.
Jacky Turquin