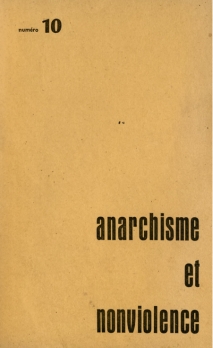1René Furth, Éditions Publico, Paris, 1967, prix : 4,50 F
On a voulu, on veut encore, bien qu’avec moins de certitude dans le ton, considérer l’anarchisme comme un rameau éteint du socialisme romantique, voire utopique, né au XIXe siècle. Dans cette plaquette, éditée par nos camarades de la Fédération anarchiste, René Furth réfute avec brio cette thèse surannée. Il affirme la permanence du socialisme libertaire tant décrié et tente une approche positive, nous semble-t-il, d’un renouvellement de méthode et d’analyse de l’anarchisme social, du rôle indispensable et irremplaçable que devrait tenir ce courant révolutionnaire face aux sociétés modernes de type étatique.
Dans le contexte social, écrit-il, « l’attitude anarchique apparaît comme refus, perturbation, désordre : rejet des valeurs consacrées, mépris des règles, lutte ouverte contre les pouvoirs. Négative dans son expression, elle n’en est pas moins positive dans son mouvement premier. Elle est affirmation d’une vie qui veut s’épanouir, mais qu’étouffe et mutile un ordre figé, oppressant ».
Citant Camus, il ajoute, justifiant la révolte comme affirmation primaire de l’anarchiste : « Le révolté agit au nom d’une valeur encore confuse, mais dont il a le sentiment au moins qu’elle lui est commune avec tous les hommes (…), l’affirmation impliquée dans tout acte de révolte s’étend à quelque chose qui déborde l’individu dans la mesure où elle le tire de sa solitude et le fournit d’une raison d’agir. »
« La révolte éclaire la solidarité des opprimés… éveillant à la conscience de soi et d’autrui… Éveillant, par l’action de rupture où elle s’exprime, les autres à la conscience de leur liberté, appelant à une solidarité agissante, la révolte fait surgir une communauté nouvelle… Elle conduit ainsi à la volonté d’une justice pour tous, c’est-à-dire d’un ordre véritable qui réalise les conditions de la liberté. La révolte débouche dans la révolution, l’anarchie dans l’anarchisme. »
« L’anarchisme, reprise raisonnée, réfléchie de la volonté anarchique d’existence intégrale et de développement indéfini se constitue par la réflexion sur les valeurs posées dans la révolte, sur les conditions et les moyens de leur réalisation… Entre le jaillissement de la source et l’horizon qui ne cesse de reculer s’étend le champ de l’anarchisme. »
Réfutant, par omission il est vrai, la thèse autoritaire du socialisme d’État ou de ses corollaires marxistes et marxisants de la fin comme seule justification des moyens, il écrit : « L’anarchisme se définit par la fidélité à la logique de la révolte. Il se refuse à employer des moyens contredisant, niant les valeurs posées par celle-ci… parce qu’il juge, expérience à l’appui, qu’on ne peut pas parvenir à la liberté par la négation de la liberté. La révolution doit prolonger la révolte, mais sans la trahir. »
Tentant ensuite une définition sommaire du socialisme, il déclare : « C’est au cours de l’action, à travers les échecs et les réussites, à travers les prises de conscience successives que s’est formé le socialisme. Son projet fondamental est de rendre libre cours au social… en éliminant les structures parasitaires et oppressives qui l’exploitent et le stérilisent. Le socialisme, c’est la volonté de remodeler l’activité sociale en fonction des besoins collectifs, à travers une gestion collective. »
Il cite Elie Halévy – « Histoire du socialisme moderne » –: « Le socialisme analyse la structure du capitalisme et les conditions économiques de son développement, il propose des réformes qui empêcheront que le genre humain ne soit la victime d’un progrès qui aurait dû, au contraire, le combler de bienfaits. C’est là tout le problème du socialisme moderne, problème économique et non politique. »
Analysant le phénomène État pour le réfuter au nom de l’anarchisme et du socialisme libertaire, il poursuit : « La nature de l’État n’est pas seulement d’ordre économique et politique, mais aussi d’ordre moral. L’État, d’après Gustav Landauer, « est une relation, un mode de comportement des hommes les uns envers les autres ». Il imprime aux mœurs, aux rapports individuels et collectifs, ses propres modes d’être qui sont l’autorité, la violence, le mensonge systématisé, l’arrivisme et la servilité. Il rend les individus irresponsables, incapables d’assumer leur destinée particulière et plus incapables encore d’assumer leur destinée collective. Il exerce ainsi une tâche incessante de déshumanisation. »
René Furth affirme alors : « C’est uniquement en dehors de l’État, et contre lui, que la société peut se reconstruire et reprendre en charge, à travers une structure souple et fédéraliste, la gestion économique et ces fonctions d’utilité publique qui donnent au pouvoir un faux-semblant de justification. »
« La seule façon de détruire radicalement un type d’organisation et de relations, c’est de le remplacer immédiatement par des structures différentes. »
« Pour être supprimé, l’État doit être remplacé. Il faut pour cela deux conditions élémentaires : des hommes préparés à l’initiative, à la responsabilité, à la gestion collective ; des organisations sociales actives et efficaces, bien reliées les unes aux autres, susceptibles de prendre la relève pour répondre aux besoins de l’heure et pour jeter la base solide d’une société socialiste et libertaire. »
Abordant enfin la question cruciale pour nous de la transformation sociale, il déclare : « La rupture violente paraît être un trait constant de l’anarchisme. La révolte en général s’exprime à travers des actes de violence. La lutte révolutionnaire, dans l’histoire, est inséparable de guerres civiles, ou du moins d’affrontements violents avec les forces de répression. »
« Les grandes expériences historiques de l’anarchisme se sont déroulées au milieu des combats. Pour le sens commun, l’anarchiste est resté l’homme à la bombe, le négateur systématique. »
Désireux qu’il est de ne pas affirmer péremptoirement l’inévitabilité de la violence, l’auteur émet alors certaines réserves quant à l’efficacité même de celle-ci. « L’assimilation de l’anarchisme à la violence ne va pourtant pas de soi. Il y a eu, il y a encore, un courant libertaire non violent, dont les raisons concernent aussi ceux qui préconisent, par la force des choses, des moyens violents. »
« Toute violence est un signe d’échec : échec de la raison qui ne parvient pas par ses propres moyens à instaurer des relations justes entre les hommes. Échec de la liberté qui pour se réaliser doit se plier au principe qu’elle condamne : la contrainte. »
« L’originalité du socialisme libertaire ne consiste-t-elle pas justement dans l’affirmation que les moyens employés déterminent la nature de la société qu’ils instaurent ? Comment la contrainte viendrait-elle à bout de la contrainte, comment une société équilibrée et prospère pourrait-elle sortir des massacres et des misères d’une guerre civile ? »
Tentant plus loin un essai de définition de la violence, « il y a violence, dit-il, dès que, par contrainte brutale ou diffuse, l’existence individuelle et collective est utilisée à des fins extérieures à elle, comprimée dans des limites arbitraires. Toute résistance à cette oppression se heurte à la violence. Une grève comme une manifestation de rue sont destinées à faire violence à l’adversaire, à lui arracher une partie de son pouvoir, à lui imposer des limites qu’il ne peut pas reconnaître. C’est pourquoi il met en action ses organisations spécialisées dans l’exercice de la violence (armée, police, tribunaux) sans lesquelles il ne pourrait pas subsister ».
Il y aurait, bien sûr, beaucoup à dire sur cette définition trop péremptoire à notre sens et faussée dans les termes. Y a‑t-il vraiment violence ou simplement affirmation d’une force vive, effective, et réelle, consciente de son droit, lors d’une grève ou d’une manifestation ? Il nous semble qu’une mauvaise interprétation des mots nous mène ici à une certaine confusion. Affirmer sa force, son droit, ne nous conduit nullement à faire violence à l’adversaire, mais peut par contre, devrait même dans le meilleur des cas, l’amener au dialogue, au compromis recherché. Il n’est nullement question pour nous de nous laver les mains, de tourner le dos aux conflits latents ou ouverts qui nous cernent constamment. Non seulement nous acceptons la lutte ouverte, l’affrontement, mais nous le recherchons, le sollicitons même. Seuls les moyens que nous proposons se détournent, parfois dans la forme, mais surtout et presque toujours dans l’esprit, des moyens traditionnels préconisés par les anarchistes.
Déclencher une grève par exemple, ou l’animer, n’est pas pour nous et avant tout explosion finale de colères refoulées, épilogue heureux d’un conflit larvé, mais occasion d’affirmer notre existence et nos exigences, d’ouvrir les hostilités avec nos exploiteurs que l’inconscience aveugle, et ceci sans violence et sans haine mais seulement avec conscience et fermeté. C’est l’occasion encore d’affirmer notre droit de copropriété sur la marchandise produite, droit de regard, droit de décision, conscience de notre participation active au grand tout représenté par la société où nous vivons.
Partisans de l’action directe dans tous les domaines, nous affirmons là, comme tous les anarchistes, notre solution ou l’amorce de celle-ci par cet intéressement constant et ininterrompu au social. De nombreuses actions de ce genre, habituellement pratiquées, bien que je le répète dans un autre état d’esprit, nous situent donc fort près des autres courants de l’anarchisme et de l’auteur de cet ouvrage notamment.
Essayant dans les pages qui suivent de justifier la violence-riposte des opprimés, face à la violence de principe des tenants de l’organisation étatique et de l’organisation économique régnante, il estime « qu’il faut distinguer deux formes de la violence : l’instrument de domination et de conservation utilisé par les classes qui exploitent la vie sociale à leur profit, et la réaction de défense des masses exploitées et spoliées. Sous cette seconde forme, poursuit-il, la violence n’est-elle qu’une convulsion aveugle, à remplacer au plus vite par une tactique plus rationnelle et mieux appropriée, ou, au contraire, un des ressorts de toute lutte socialiste ? » Pour lui, comme pour nous d’ailleurs, qui la considérons comme la première réaction à l’injustice, « en tant qu’élan de révolte, même réduit à une explosion en apparence sans but, la violence exprime une prise de conscience ». Mais où nous ne pouvons le suivre dans son raisonnement, c’est lorsqu’il considère que « l’action violente retrempe les énergies, réveille les colères passées. Elle crée en même temps un climat d’effervescence où germent les idées neuves ».
Il nous paraît en effet que, mieux que d’applaudir au réveil des colères passées, il serait plus bénéfique de les dévier, de sublimer cette réaction violente, de la replacer dans des actions créatrices, telles celles que l’auteur lui-même préconise plus loin, l’autogestion notamment.
Conscient qu’il est des dangers, d’ailleurs possibles, pour ne pas dire certains, de la violence, il ajoute : « Riposte naturelle et ferment de conscience, la violence est bien un élément de l’action révolutionnaire. II ne faut jamais oublier cependant les risques qu’elle fait courir à la liberté lorsque, sous la pression des circonstances, elle finit par être institutionnalisée, militarisée. »
Il précise encore sa pensée sur les formes mêmes des violences diverses : « Il ne faut pas oublier non plus que l’action violente ne se confond pas avec la lutte armée et que le recours, en temps opportun, et selon des méthodes efficaces, à la première peut parfois éviter les risques de la seconde. » Réfutant le mythe d’une révolution anarchiste prévue et organisée par avance, il affirme enfin : « Les anarchistes, et plus généralement les groupes révolutionnaires, n’ont pas à déclencher à tel moment un mouvement général d’insurrection violente, et le plus souvent ils n’en ont d’ailleurs pas les moyens. Un tel mouvement n’est possible, efficace, que comme riposte collective conditionnée par la situation globale. »
Militant actif et désireux d’efficacité, il préconise alors, comme action positive des anarchistes et socialistes libertaires sur le plan social et dans leur lutte quotidienne, une participation active dans les mouvements allant vers une prise de conscience nouvelle et ce sous peine de disparition en cas d’abstention et de repli dans un purisme byzantin. « La tâche des libertaires, dit-il, sera de renforcer autant que possible les secteurs autogérés, de poursuivre intensément leur travail de formation et d’éclaircissement. Chaque victoire remportée par les exploités, où que ce soit, est une étape vers la révolution intégrale. Nous abstenir de participer à un mouvement collectif chaque fois que les objectifs et les moyens ne sont pas spécifiquement anarchistes, c’est nous condamner à l’impuissance. »
Au tiers de cette plaquette il conclut, appelant encore à l’action incessante de tous : « Quels que soient les risques et les chances dans l’avenir, quels que soient les reflux et les incertitudes du présent, il n’y a pas de répit possible. »
Ce modeste ouvrage, une centaine de pages, mériterait dans l’avenir un long développement et de nombreuses adjonctions et précisions, mais il nous semble tel quel un des plus importants pour la compréhension de l’anarchisme contemporain, de ses tâches, de ses buts, de ses expériences, aussi en recommanderons-nous la lecture attentive à tous nos lecteurs et amis, en espérant qu’il leur apportera les éléments d’un dialogue et d’un approfondissement souhaitables et plus que jamais nécessaires.
Lucien Grelaud
- 1René Furth, Éditions Publico, Paris, 1967, prix : 4,50 F