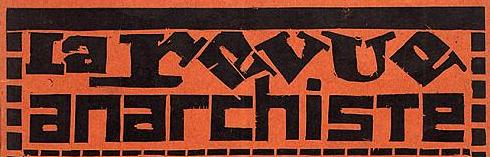Je voudrais aujourd’hui présenter aux lecteurs de la Revue Anarchiste un écrivain anglo-saxon dont l’œuvre puissante et nombreuse, encore trop peu connue en France, apparaît toute imprégnée de fortes tendances socialistes sous lesquelles s’accuse un tempérament de libertaire. Il est certain que l’idéal communiste tel que le conçoivent les anarchistes, n’effraya jamais Jack London ; c’est, en effet, du grand romancier californien qu’il s’agit.
Nomade et vagabond moi-même, depuis bien longtemps révolté contre ma classe et boycotté par elle, j’avais été séduit non seulement par son œuvre, mais aussi par sa vie qui est, en même temps qu’un type parfait de nomadisme, l’exemple le plus frappant de l’effort colossal presque surhumain nécessaire à l’écrivain indépendant et ennemi des lois pour s’imposer à l’attention de notre société capitaliste et bourgeoise.
Devant les documents réunis pour cette étude bio-bibliographique, j’ai admiré et je voudrais faire admirer par mes lecteurs la ténacité de cet homme qui, mort à 40 ans, et bien qu’ayant dépensé dans la lutte la plus grande part de ses forces vives, a trouvé le moyen de laisser une œuvre dont l’ampleur, je dirai même le génie, évoque celle de notre grand Balzac, terrassé lui aussi par le mal, à 52 ans.
Dans une Notice que son éditeur de Londres a placée à la fin du livre intitulé La Maison d’orgueil (The House of Pride), Jack London a résumé lui-même avec une éloquente précision, son existence à la fois laborieuse, aventureuse et tourmentée.
Il naquit le 12 janvier 1876, à Oakland, dans l’État de Californie. Son père, John London, était un pauvre fermier de ranch, et il connut l’enfance la plus douloureuse, la plus solitaire qu’il soit possible d’imaginer.
Il nous l’a racontée cette enfance, occupée à surveiller les abeilles, à capter les essaims perdus, à travers la plate, triste et monotone vallée de Livermore, dans la ferme où son père travaillait.
À ces lignes émues, on devine qu’il les aima passionnément, ces abeilles, l’unique distraction et les seules compagnes de ses jeunes et solitaires années. Et son émotion, je l’ai partagée en lisant ce passage, car dans mon enfance vagabonde, les abeilles ont joué aussi un rôle ami. Mais, plus heureux que lui, j’avais un maître, un pauvre vieux prêtre agriculteur que ses idées révolutionnaires avaient chassé de l’Église et fait de lui un déclassé et un révolté. Il les chérissait passionnément, ces filles jalouses du soleil, ces buveuses insatiables de nectar, dont le miel, qu’il colportait sur son âne dans les villages voisins, assurait la tranquillité de ses vieux ans. Et il me fit partager cette passion. Oh ! comme je me suis souvenu d’elles en lisant l’enfance de Jack London ; oui, je me suis souvenu que si mon vieux maître, comme le père de Jack London, aimait les abeilles, les abeilles aussi l’aimaient. Je le vois, marchant librement entre ses ruches, versant à celle-ci des gouttelettes de sirop, rétrécissant, de ses mains osseuses, l’orifice de celle-là pour la préserver du rayonnement nocturne, jetant autour de cette autre des poignées de cendres mouillées pour éloigner la fourmi pillarde, et faisant une chasse sans trêve aux guêpes rôdeuses et aux frelons.
Et les abeilles, reconnaissantes, lui caressaient, en bourdonnant, ses cheveux blancs ; elles venaient, au moindre appel, butiner jusque sur ses lèvres, dans sa belle barbe blanche, comme autour d’un lis éclatant. Et jamais la plus coléreuse ne frôla sa peau de son dard…
Et, en écrivant cela, je ne puis ne pas évoquer également la Ruche aujourd’hui dispersée de Sébastien Faure, où tant d’enfants solitaires somme le jeune Jack London, plus heureux que lui, trouvèrent jadis des petits compagnons avec la tiédeur d’un nid.
Déjà, à ce moment, pour le gamin pasteur d’abeilles, avait commencé l’existence errante qu’il devait mener jusqu’à sa mort. Depuis sa naissance, en effet, la ferme de la vallée de Livermore était la troisième où le chef de famille s’était échoué pour gagner sa pénible vie. Et, déjà aussi, Jack sentait bouillonner en ses jeunes veines cet instinct nomade, l’unique héritage qui devait lui revenir.
* * * *
Il commençait à peine sa onzième année que, passionné de lecture — il avait appris à lire tout seul — il quitta les siens et partit pour Oakland. attiré par la Bibliothèque publique comme les abeilles qu’il abandonnait, par les fleurs de la vallée. De cette butinée gloutonne à travers la flore livresque, son système nerveux d’enfant fut très éprouvé, et il subit les premiers symptômes de la danse de Saint-Guy.
Surmenage cérébral, certes, mais aussi, sans doute, souffrances, privations, misère physiologique, car le « gosse », pour gagner sa vie, était obligé de vendre des journaux dans la rue. De onze à seize ans, il fit ainsi, pour pouvoir s’instruire, les plus infimes et les plus pénibles métiers…
« Travail manuel et école… École et travail manuel… Telle fut ma vie d’enfant. Et cela allait ainsi », résume-t-il avec une mélancolique fierté.
Saturé de lecture et de vie sédentaire, subitement repris par ses instincts héréditaires de nomadisme, il revient à ses vagabondages, s’affilie à une bande de maraudeurs dont la spécialité consistait à piller les parcs-à-huîtres. Ce fut ce que j’appellerai sa période de « reprise individuelle », ou plutôt l’aurore de la haine contre le capital que ses misères enfantines avaient gravée dans son âme d’adolescent.
Bien que courte, cette période de son existence fut bien remplie ; car, avoue-t-il lui-même avec une touchante ingénuité : « Si la férocité du Code bourgeois avait pu m’atteindre dans tous mes actes de piraterie, j’eusse récolté cinq cents ans de prison…»
Las d’affronter le revolver des policemen et des gardiens et séduit par le grand mystère de la mer, Jack London s’embarque comme matelot sur un shooner et s’en va du Japon à la mer de Bering chasser le phoque et pêcher le saumon.
Après sept mois de vagabondage travers les mers glaciaires, il s’en revient en Californie où il reprend sa vie de trimardeur, adoptant les métiers les plus rudes, tour à tour portefaix, soutier et ouvrier dans une fabrique de jute, où il travaillait de six heures du matin à sept heures du soir.
À ce moment, il ressent la nostalgie du pays natal, part pour Oakland où se rédigeait le School, un magazine hebdomadaire.
Il écrivit pour lui des récits qui n’étaient pas seulement d’imagination, mais dont le fond se rattachait à son expérience de la mer et à ses courses vagabondes.
Mal rétribué, il dut, pour ne pas mourir de faim, ajouter à ses fonctions de rédacteur celle de portier de la maison.
« Mais, écrit-il, ma santé délabrée m’obligeait à prendre de nombreux congés, l’effort étant plus grand que je ne pouvais le supporter. »
C’est à ce moment que la révolte contre le capitalisme oppresseur, qui déjà, depuis longtemps grondait dans son âme de victime, éclata et qu’il risqua son premier geste révolutionnaire. Dans un pays où, plus qu’ailleurs, l’Or est Dieu et le Mercanti son Prophète, il osa lancer ses premières déclarations socialistes.
Arrêté, incarcéré pour un discours prononcé dans la rue, il connut, à compter de ce jour, toutes les persécutions par lesquelles les société capitalistes, qu’elles appartiennent au Nouveau monde ou à l’Ancien, essaient d’étouffer les révoltes de l’esprit et de la conscience.
Chassé de la revue School, Jack London ne se décourage pas et fait bravement tête à l’orage.
Il suit les cours de l’Université de Californie, travaillant seul et par lui-même, en trois mois autant qu’un autre eût pu le faire en trois ans : « Il me déplaisait, dit-il, d’abandonner l’espoir d’une éducation universitaire et je repassais des chemises dans une blanchisserie pour subvenir à mes besoins intellectuels…»
À l’effort accompli par cet étonnant autodidacte, dont la misère avait déjà compromis la santé, qui donc aurait pu résister ?
« J’avais beau me raidir, ajoute-t-il tristement, pour mener de front le travail de mon cerveau et celui le mes mains, le plus souvent je tombais de sommeil la plume à la main…»
Alors, il quitta la blanchisserie et essaya de vivre de son métier d’écrivain. Mais sa réputation précoce de révolutionnaire pesant plus que jamais sur lui, il continua de mourir de faim. Notez qu’à ce moment, il ne s’était pas contenté de militer Oakland, sa ville natale, et en Californie ; mais, toujours poussé par ses instincts nomades, il s’en était allé à travers les États-Unis et le Canada, semant le bon grain révolutionnaire et récoltant des semaines et des mois de prison. Il ne comptait plus les geôles américaines dont il avait subi les horreurs.
Étonnez-vous, après cela, que, malgré l’originalité de son talent qui déjà s’annonçait puissant, les éditeurs, dame profondément bourgeoise, le tinssent en quarantaine et refusassent systématiquement sa copie ? L’un d’entre eux, sorte de brute, ancien boxeur, ne se contenta pas de lui rendre son manuscrit, mais encore le roua de coups.
Ce fut alors que, le corps déprimé par cette vie de souffrances, l’âme révoltée par la férocité de l’ostracisme qui le frappait, il cessa d’écrire et partit pour le Klondike à la recherche de l’or.
Ce fut pour lui le salut.
« C’est dans le Klondike, écrit-il, que je me suis retrouvé moi-même. Là, personne ne parle, tout le monde pense ; c’est le grand Silence blanc et l’on peut prendre une vraie connaissance de soi-même. C’est ce que je fis… »
Il y resta un an, vivant de la vie dure, âpre, mais saine des mineurs, étudiant les mœurs des chercheurs d’or, de leurs chiens d’Alaska, leurs auxiliaires les plus précieux, et accumulant, par une observation intelligente, inlassable et minutieuse, les éléments de ses livres les plus beaux.
Mais voici que le terrible scorbut endémique, dans ces solitudes glacées, où l’alimentation végétale est difficile, l’assaillit, ulcérant ses gencives, déchaussant ses dents, le tourmentant d’une fièvre continue, à laquelle il eût succombé, s’il n’eût abandonné ce terrible et mystérieux pays, pourtant le seul où il eût connu un peu de bonheur.
Ce fut avec un profond regret qu’il le quitta et, comme son père venait de mourir, il n’attendit pas le paquebot pour revenir en Californie ; avec deux amis, il se risqua sur un bateau non ponté qui, nous dit-il, parcourut dix-neuf cent milles en dix-neuf jours.
Revenu au pays natal, il reprit sa plume, bien décidé cette fois à vaincre le mauvais vouloir des éditeurs.
Il écrivit d’abord Down the River (Au bas de la rivière), dont personne ne voulut.
Ces refus multiples ne le découragèrent pas. « Je les attendais, dit-il, et en les attendant, j’écrivis une série de vingt mille mots, sans pouvoir en faire accepter un seul… »
Il continua quand même d’écrire, luttant contre ce boycottage implacable avec l’énergie du désespoir. Enfin, il parvint à faire accepter un conte par un magazine californien qui lui donna cinq dollars. Bientôt après, la revue The black Cat (Le Chat Noir) lui paya un autre conte quarante dollars.
Son talent de révolté avait vaincu l’ostracisme bourgeois. Et c’est avec un mélange de tristesse et de joie qu’il écrit : « Enfin, je n’étais plus obligé, pour vivre, de ramasser du charbon », et il ajoute avec une intrépide sérénité : « Oh ! j’eusse été capable de le faire encore s’il l’avait fallu!…»
Surpris eux-mêmes plus que lui encore par l’énorme succès de ses premières œuvres, consistant surtout en récits, contes et nouvelles, les éditeurs qui, hier encore, lui furent le plus hostiles s’empressèrent de lui demander de la copie. C’est alors que Jack London fit ses véritables débuts littéraires.
« J’aurais pu dès ce moment, nous dit-il, faire beaucoup de copie pour les journaux : mais j’avais assez de bon sens et de douloureuse expérience pour ne pas devenir un esclave dans cette machine à tuer les hommes qu’est le journalisme. Car c’est ainsi que je jugeais un journal pour un jeune débutant… »
Et il fait en, quelques lignes son portrait intellectuel et moral : « Je crois au travail régulier et je n’attends rien de l’inspiration. Par tempérament, je suis non seulement négligent et irrégulier, mais mélancolique. Et cependant, grâce à mon effort continu, j’ai vaincu ces fâcheuses tendances. Mes longues années de misère et de lutte contre le capitalisme féroce, la discipline sévère que j’ai subie comme matelot avaient eu un plein effet sur moi. Peut-être ma rude vie de marin est-elle la cause véritable de mon faible besoin de sommeil. Cinq heures et demie sont la moyenne que je m’accorde et aucune circonstance n’est encore survenue dans ma vie qui put me tenir éveillé lorsque l’heure du repos avait sonné… Quoiqu’élevé d’abord dans la ville, j’aime mieux être près d’elle que dans elle. La vie à la campagne est la meilleure et la plus naturelle… Dans mes années de formation, les auteurs qui ont eu le plus d’influence sur moi sont Karl Marx et Spencer…» Mais de son œuvre, il résulte que la pensée philosophique de Jack London avait, au cours de sa vie errante et douloureuse, évolué bien au-delà du cadre un peu étroit que l’auteur du Capital a tracé à la doctrine révolutionnaire.
À partir de son premier grand succès jusqu’à sa mort, Jack London ne cessa de produire régulièrement et avec une étonnante fécondité. Il a laissé 52 volumes. Aussi son œuvre apparaît-elle inégale, et à côté de véritables chefs‑d’œuvre, elle contient des livres médiocres de fond qui en déparent l’ensemble et qui seraient indignes de porter la signature du Maître, si son style inimitable ne les relevait quelque peu.
Pour donner à mes lecteurs une idée suffisante de ce labeur colossal accompli dans une vie très courte, je n’analyserai ici prochainement que les ouvrages où Jack London a mis le meilleur de lui-même et de son génie et qui se trouvent être précisément ceux où il s’est apitoyé sur l’humanité souffrante, où il s’est penché, comme Sébastien Faure, sur l’Universelle Douleur. Comme Sébastien Faure aussi, il a voulu, désiré, cherché, le Bonheur universel.
Et c’est pourquoi, dans cet article prochain, je comparerai l’œuvre de ces deux révoltés.
Il est, on le verra, des pages de Jack London qui pourraient être signées par Kropotkine, d’autres qui évoquent l’âme généreuse, ardente et clairvoyante à la fois des Reclus, des Bakounine, des Proudhon, de tous ceux qui, écœurés et indignés par les cruautés de la société capitaliste et bourgeoise, engagèrent la lutte implacable contre les Maîtres et les Dieux qui en sont l’incarnation.
P. Vigné d’Octon.
À L’ÉTALAGE DU BOUQUINISTE
Derniers livres parus
Propos d’Anatole France, recueillis par Paul Gsell. — Il y a beaucoup à glaner dans ce livre, mélange de rosserie, de malice et d’agréable philosophie.
Les semaines sanglantes, par Luc Dutemple. — Encore un livre sur la guerre et qui ne ménage pas les guerriers. Donc, à signaler aux lecteurs de cette Revue.
La Question sociale, par le Dr Toulouse. — Comme tous ceux qu’édite le Progrès Civique, ce livre, écrit par un bourgeois intelligent doublé d’un savant libéral, contient certaines vérités auxquelles peut souscrire tout esprit vraiment révolutionnaire.
Saint-Magloire, roman, par Roland Dorgelès. — Un peu timide, cette dernière œuvre, je lui préfère et de beaucoup Les Croix de Bois.
Mars ou la Guerre jugée, par Alain. — Un des meilleurs bouquins qu’il m’ait été donné de lire sur la guerre et les guerriers considérés au point de vue philosophique. Alain n’est pas le vrai nom de l’auteur. C’est le pseudonyme sous lequel se cache un honnête homme pour lequel la guerre a été, est et sera toujours, la honte de l’humanité.
La Route de la Victoire : Histoire de la Grande Guerre, par A. Lumont ; préface de Paul Painlevé. — Si je reproduis ici le titre de ce livre, c’est uniquement pour mettre l’œuvre qu’il recouvre en opposition avec le livre précédent. Vous l’aurez lu quand vous saurez qu’il contient tous les lieux communs, toutes les banalités cocardières qui traînent depuis la guerre dans tous les bouquins patriotards.
Pages choisies, de Rémy de Gourmont ; préface de Marcel Coulon. — Rémy de Gourmont a beaucoup écrit. Il a été un des polygraphes les plus féconds de notre temps. Grand travailleur, lecteur infatigable, il n’a pas toujours très bien digéré ses lectures. On pourrait dire de lui que son métabolisme intellectuel ne fut pas toujours parfait. Art, science, religion, philosophie, il a, pendant son assez courte vie, tout abordé.
Aussi n’est-il pas d’œuvre plus inégale que la sienne, et le choix des meilleures pages n’a pas dû être commode. M’est avis qu’il n’a pas toujours été heureux dans ce livre édité par le Mercure de France, dont il fut un des fondateurs.
Pour mention : Reliques, par Isabelle Rimbaud. — Le tragique destin de Nicolas II, par Gilliard. — La crise du socialisme mondial, par Paul Louis. — Les hommes accusent, par Andreas Latzko, beau livre sur lequel je reviendrai. — L’instinct combatif, par Pierre Bovet.
P.V d’O.
— O —
Quelques livres à lire. —Un livre qui fait beaucoup plus honneur à la firme Albin Michel que Batouala, c’est Le Massacre de notre Infanterie, par le général Percin. À ceux de nos camarades, qui voudront se faire une juste idée de ce que fut de 1914 à 1918, le gâtisme criminel de nos grands chefs, je conseille vivement la lecture de ces 300 pages bourrées de faits et de documents. Ils assisteront, sans bouger, a plus de deux cents combats au cours desquels l’infanterie française a été massacrée par sa propre artillerie. Le général évalue à 75.000 le nombre des victimes de ce qu’il appelle « ces déplorables méprises », et que nous appelons, nous, des assassinats.
C’est en vain, que parmi les nombreux livres du mois, j’ai cherché quelque autre qui mérite d’être lu : hormis Line de Séverine, je ne trouve rien. Même néant dans les innombrables revues littéraires, inféodées au capital depuis le Mercure de France et la Revue des Deux Mondes, jusqu’aux feuilles éphémères des gamins bourgeois.
Contentons-nous de lire Les Humbles, de Maurice Wullens, et nous ne perdrons pas notre temps.
P.V.