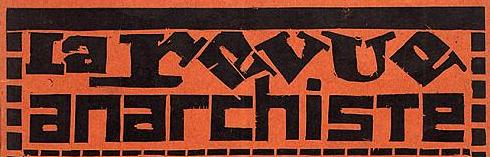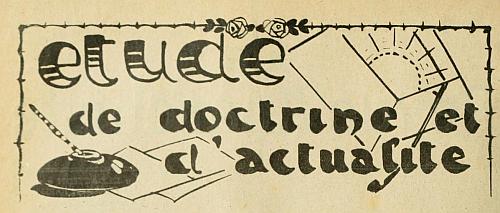
M. Bergson fut le maître à penser des « jeunes gens d’aujourd’hui 1 Jeunes Gens d’aujourd’hui, par Agathon, parut en 1913. Ce livre, comme fait sur commande, eut une grosse influence dans la jeunesse des Universités, pour la préparer à l’idée de la guerre.». Son nom figurera dans l’histoire de M. Poincaré, comme celui de Descartes dans l’histoire de Louis XIV. M. Bergson a été le Descartes du Nationalisme bourgeois. Comme l’auteur du « Discours sur la Méthode », il a vendu sa pensée à la force sociale de son temps ; il a renoncé aux pures joies du philosophe pour goûter aux jouissances de l’homme célèbre. Il s’est prostitué à la gloire de son siècle.
Henri Bergson avait un trésor unique, un surhumain trésor. Il l’a monnayé en pièces courantes à l’effigie d’un Président de République. M. Bergson a perdu son âme. Il lui reste la popularité et les honneurs, c’est bien peu de chose pour le penseur des « Données immédiates de la Conscience ».
Loin du grand fleuve de collective raison où s’en viennent boire et se laver et naviguer et faire leur commerce de vie sociale les hommes à la pratique activité, loin de ses plaines industrieuses qu’il arrose de ses canaux en scientifiques irrigations, loin des cités qu’il fait naître sur ses bords pour y organiser toutes choses en fonction de commune mesure, le jeune philosophe Henri Bergson était parti vers les solitaires hauteurs où la montagne crée des sources. Longtemps il avait cherché aux replis des roches la source miraculeuse : celle que n’appelait pas dans sa course la servitude du grand fleuve de raison. Souvent, la croyant trouver, ses pas bondissants suivirent, frénétique course, quelque torrent où semblaient danser plus librement les reflets du monde. Ses pieds saignants et les halètements de sa poitrine ne conduisaient de causes en causes, le long de la pente de matérielle nécessité, que vers les eaux aux mornes flots où tout s’enchaîne vers la mort.
Mais un matin, alors qu’il ne cherchait pas et que, vagabondant dans le vent des cimes, son âme par tous ses sens flottait harmonieusement sur les clartés et les parfums et les caresses de la montagne en une rêverie d’enfance pour la seule joie de sentir, une musique s’éveilla, en ce moment — une musique d’il ne savait où — une musique qui le chantait dans les choses et qui semblait chanter en lui les choses — une musique sans lien — une musique sans fin, une musique indécomposable et toute une et si prestigieusement multiforme qu’il lui était impossible de la fixer en nulle forme — une musique de liberté. Et le philosophe errait de monts en monts, de vallées en vallées et du matin jusqu’au soir — et durant la nuit encore et la musique chantait toujours. Elle narguait temps et espace. Alors il comprit qu’il la portait en lui et comme il ne raisonnait pas en ce moment, et que sa pensée, depuis le matin ne s’était dressée aucun plan et n’avait suivi aucun enchaînement d’idées finies, le philosophe comprit que ce n’était pas son intelligence qui chantait ainsi dans son être. Alors il s’endormit. Et la musique chanta encore jusqu’à matin en des songes qu’il n’oublia pas. Et quand Henri Bergson s’éveilla à la lumière ses yeux virent enfin la source dont la musique l’avait enchanté. Il découvrit, sourdant de ses sens en frémissantes ondes symphoniques, le libre cours de l’intuition. Celui-là n’allait pas vers les plaines. Il ne se perdait pas dans les mornes et communes eaux de la raison humaine. Il ne coulait pas ; il jaillissait. Il ne suivait les accidents d’aucun lit. Il s’élançait vers les cimes sans avoir besoin, pour se mouvoir, d’obéir aux lois causales. Rien ne poussait son courant. Il s’attirait lui-même vers ses propres fins. En se désirant il se créait, et l’harmonie était la seule loi de son activité. Ses vagues de clartés musiciennes libéraient la sensation du joug du rationalisme. Elles la délivraient des desséchantes étreintes de la collective intelligence pour la rendre à son éclosion, au rythme de la personnalité. En se replongeant aux intuitives ondes, la sensation cessait d’être le pondérable élément d’universelle servitude pour devenir l’infini générateur d’individuelle liberté !
Henri Bergson montrait ainsi qu’une sensation n’est pas cet identique atome avec lequel les psycho-physiciens prétendent reconstruire par de précises formules multiplicatives la composition des différentes âmes. En une simple sensation se manifeste le subjectivisme avec autant de confuse richesse synthétique que dans le plus complexe des sentiments. En une fugitive sensation s’irradie la vie psychique d’un être dans toute sa force de créative personnalisation, tout comme en l’imagination la plus féconde. L’individu spirituel n’est pas un composé, il est un composant infini. En lui toute l’activité n’a qu’une fin : l’harmonie de son tout, et en le moindre instant de sa vie il ne cesse de passer lui-même tout entier. On pourrait appliquer justement à l’individu psychique la formule que les théologues accordent à Dieu : il est fout entier lui-même partout et nulle part, en tous instants et en tous lieux de sa création. À chaque point de sa vie il se crée.
Mais c’est à la sensation qu’il se crée avec le moins de restrictives luttes, dans toute sa pureté éclosive, en sa fleur unique. À la sensation, l’individu se déploie avec toute sa liberté et en pleine vie.
Déjà un sentiment s’embarrasse d’abstractives formes. Il peut se raisonner. Il contient en lui une idée. Or les idées s’associent. Elles se tiennent entre elles comme les successifs maillons d’une chaîne qui lie l’individu à la collectivité humaine. Elles viennent du dehors toutes faites et entrent dans une conscience afin d’en violer l’intimité. Car elles ne se contentent pas de se grouper entre elles afin d’enchaîner la vie intellectuelle de l’individu suivant les lois de l’humaine raison. Elles ont aussi l’objective tendance de s’emparer de sa vie affective afin d’en fixer les manifestations suivant les formes préconçues d’un collectif idéal. Ce qu’on appelle le cœur humain n’est pas autre chose que le produit de cet asservissement des individuelles sensibilités aux préjugés de l’idéalisme d’une époque sociale. La vie sentimentale de la plupart des êtres constitue la négation de leur libre arbitre parce qu’au lieu de surgir toute nue et vibrante des ondes intimes de leur sensibilité, elle se pare de traditionnels concepts afin de suivre les courants de l’imagination collective. Ainsi déformés, les sentiments ne méritent plus que d’être traités comme ils le sont par les psychologues de la Nouvelle-Sorbonne. Ils ne manifestent plus rien de l’âme individuelle. Ils ne sont plus que d’épidémiques maladies de la conscience sociale.
Alors Bergson nous chanta la vie sentimentale se libérant des chaînes de l’intelligence pratique, oubliant tout ce qu’elle avait appris — et retrouvant aux sources d’intuition la sève ascendante de sa liberté. Et le philosophe fut un poète qui nous révéla par quel rythme de poussée musicale l’intuitive conscience allait de la sensation au sentiment comme en « une symphonie où un nombre croissant d’instruments se feraient entendre ».
Tandis que les psychologies antérieures, avec leur rationalisme, ne donnaient à la vie affective qu’un rôle d’auxiliaire devant se plier aux besoins de la connaissance afin de lui fournir les instruments de son perfectionnement — la psychologie de Bergson montrait que la vraie création psychique est l’œuvre du subjectivisme affectif. La sensibilité intuitive n’est plus l’esclave de l’intelligence rationnelle. Celle-ci n’est considérée que comme la somme des moyens dont se sert l’individualité afin d’agir pratiquement parmi le milieu objectif. Les idées ne sont plus que des traductions artificielles, afin de fixer momentanément en symboles extérieurs un instant de la subjective infinité. Elles ne sont que des instruments de communication entre les diverses personnalités. Chaque conscience ne leur doit rien. Les idées sont extérieures à la vie de l’âme. Elles ne composent pas plus la réalité psychique que les signes du télégraphe ne constituent la parole d’un homme. Loin que les individualités sentantes doivent s’asservir aux idées — ce sont les idées qui ne peuvent être que les instruments modifiables et réformables d’une personnalité qui se veut librement éclore en son intuitive vie.
Il est assez curieux de remarquer que le règne des idées qui imposait à l’âme individuelle une soumission aux formes pratiques de l’être collectif pouvait en même temps conduire l’être au renoncement à toute vie active. En faisant de la vie spirituelle un enchaînement d’idées en Dieu ou en la raison humaine ou en l’universelle harmonie ou en tout autre lieu de commune pensée, on ne refusait pas seulement à l’individu l’irréductible originalité de son âme, mais encore pouvait-on lui nier l’importance de son action. Il ne restait que la toute puissance du verbe : « Veritas in dicto, non in re consistit » 2La vérité consiste dans le mot et non dans la chose. tel pouvait être le précepte de toutes les philosophies édifiées sur les ruines de la pure affectivité. Toutes parlaient comme s’il n’y avait que le « verbe » et la « chose » : « Dictum et res ». — Bergson leur pouvait répondre : « Veritas non in dicto, neque in re, sed in senso consistit » 3La vérité ne consiste ni dans le mot, ni dans la chose, mais dans la sensation..
Mais, dédaignant, torturant ou bafouant la sensation, les philosophes de l’idéalisme ont tous placé la suprême noblesse en 1’«ataraxie ». Que ce soit par l’abstinence stoïcienne, par la résignation chrétienne, par la « discrétion » rynérienne ou par l’ironie délective de Rémy de Gourmont, c’est toujours la même contemplation du cours des idées universelles, en son passage au travers de l’âme d’un penseur. C’est toujours aussi le renoncement à vivre sa vie selon soi-même, sous le même prétexte que les « pensées sont faites pour être pensées et non pour être agies ».
Au règne divin de la pensée, l’idéal du sage est de souffrir et de supporter indifféremment les individuelles affections de la vie sensible comme des accidents qui ne doivent prêter qu’au dédain ou à la risée, afin de s’accorder tout entier à la contemplation passionnée ou sereine ou dilettante de l’universel cours des idées. Et ce sage, qu’il soit Jésus ou Épictète ou Rémy de Gourmont ou Ryner, pourra comme Jésus se laisser souffleter par la soldatesque et porter charitablement la croix de son martyre jusqu’au calvaire, il pourra comme Épictète être esclave et se faire tordre la jambe par un maître jusqu’à ce qu’elle en casse, il pourra comme un Han Ryner subir durant toute une vie de pauvre labeur quotidien le supplice de parler parmi le silence, ou comme Rémy de Gourmont se soumettre aux exigences rapetissantes de la condition d’écrivain pour qui prétend en vivre à la fin du XIXe siècle, tout cela n’importera pas plus à Jésus qu’à Gourmont, à Épictète qu’à Ryner, l’essentiel pour eux tous est, quelque nom qu’ils lui veuillent donner, l’identique royaume du Père, 1’«éternel et universel » pays des idées. Ils sacrifient leur vie particulière à la pensée générale. Chacun à leur mode, tragiquement, quiètement ou ironiquement ils sont les martyrs de l’esprit. Ils affirment l’existence de l’être sur la mort de la sensation, sur la négation de toute joie de vivre affectivement. Avec tous ces grands penseurs se développe en idéologies sereines ou tragiques, harmonieuses ou subtiles, le « je pense, donc je suis », que Descartes n’exprima que pour le travestir aussitôt à la mode de son temps. Mais les sincères amants comme l’astucieux marlou sont également les esclaves de la même divine prostituée : l’humaine spiritualité. Que ce soit Descartes formulant l’honnête homme pour les intérêts de la France du XVIIe siècle, ou le Christ se faisant « homme » pour l’amour de l’Humanité, ou Épictète proclamant « la parenté qui unit les hommes entre eux et avec les Dieux », et enseignant « les vérités générales » qui font « l’homme de bonne volonté» ; ou Han Ryner contant au « cœur des hommes » l’Idée d’Amour avec la voix de leur raison ; ou Rémy de Gourmont apprenant à l’homme l’art d’éprouver l’ivresse spirituelle, tous, par un identique jugement mental, « communient à plusieurs tables, sous toutes les espèces humaines », et, « ayant écouté les murmures, ils y répondent par toutes les paroles ». Ils perdent l’individu dans l’homme. Ils se noient dans le collectif. Ils se soumettent à un ordre. Pour Descartes, c’est l’ordre de l’État ; pour Jésus, c’est l’ordre du Père ; pour Épictète, c’est « l’ordre du Monde des nécessités pour quiconque ne ferme pas sa raison ». Pour Han Ryner, comme pour Gourmont, c’est l’ordre du Tout, où tout vit éternellement pour quiconque ne ferme pas son cœur, selon Psychodore, et pour quiconque sait ouvrir son intelligence, selon Dyomède. Tous, aussi bien que Descartes. ne s’affirment par leur pensée que pour dire au Souverain : « Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Ils se reconnaissent l’existence en se niant la liberté. Ils s’accordent la raison d’être particulièrement en une soumission aux lois de l’être général. Pour eux tous, la vie se fonde sur les principes d’égalité et d’identité, et « aucun geste n’est supérieur ni différent, et toutes les manifestations de l’activité vitale, ou spécialement humaine, semblent bien équipollentes ». Au règne universel de l’intelligence, l’être humain vit selon l’idéale boue du stoïcien qui disait : « Si la boue avait le sentiment et la pensée, elle se réjouirait d’être foulée aux pieds des passants, car elle saurait que cela est dans sa destinée, et elle s’y soumettrait avec empressement. »
Au règne individuel de l’intuitive sensation, l’être affirme son existence en même temps qu’il se reconnaît vivant en ses jouissances actives : il trouve sa liberté en réalisant la beauté de ses actes. En un même geste d’harmonie, il se crée sentant, vivant et libre.
Avec le « je pense, donc, je suis », Descartes, par une opération mentale, n’affirmait d’autre existence que celle de l’homme abstrait. Ce n’était pas Descartes se saisissant dans sa vie personnelle, mais le philosophe trouvant la preuve de l’existence humaine dans l’humaine fonction de penser. Descartes donnait la vie à l’être général en le plaçant parmi l’enchaînement des idées.
Avec l’intuition, Bergson eût pu dire : « Je sens, donc je suis libre. » Car la sensation, libérée de ses déformations pratiques dans l’espace et saisie intuitivement, est, comme dit le philosophe, « un commencement de liberté, ou elle ne l’est pas. » Tandis que la pensée peut « être comprise par plusieurs, et, par conséquent, être susceptible de créer des liens de collectivité, la sensation est vraiment l’unique. C’est en elle que l’individu fonde sa liberté et son unité. Son entière autonomie. La sensation ne se répète pas, elle ne se donne pas, elle ne s’étale pas. Elle n’est susceptible d’aucune mesure. Elle n’a de lien avec rien en dehors de l’individu qui la sent. Elle est irréductiblement un phénomène subjectif. Par elle seule se manifeste la différenciation d’un être. Elle est la seule génératrice d’un individualisme intégral. En disant : « Je sens, donc je suis », ce n’est pas un savant qui établit sur la sensation humaine les conditions de la conscience humaine. mais c’est moi-même qui, me sentant sentir comme je suis seul à sentir, par cela même, me sens vivre dans mon individuelle vie. Je me sens vivant en me vivant sentir. Ce n’est pas une démonstration écrite de mon existence d’homme, c’est l’expérience que je suis seul à pouvoir sentir et en laquelle je me trouve dans ma réalité et dans ma liberté.
En fondant sur l’intuitive sensation la vie psychologique, Henri Bergson donnait à l’âme individuelle la possibilité d’éclore en se refusant à la science psychologique aussi bien qu’à la religion, sous toutes ses formes. Par l’intuition, la vie spirituelle pouvait échapper aux lois du type collectif. Elle s’individualisait. Dès lors, chaque personnalité se créera sa libre psychologie, car seul l’individu peut sentir en lui-même, parmi l’intuitive symphonie, les rythmes indéfinissables de son unique et incessante autocréation.
L’intuitionnisme bergsonien était l’unique source de l’individualisme intégral. En une précédente élude 4 Aux sources de l’Héroïsme Individualiste. « De Bergson au Banditisme » (L’Action d’Art, 1913)., j’ai conté par quelle pente de naturelle expansion on va de la psychologie intuitive de Bergson à l’héroïsme anarchiste de Bonnot. Et, cependant, les « jeunes gens d’aujourd’hui » ont trouvé moyen de partir de la même source d’intuition pour aller vers un tout autre héroïsme : celui de M. Poincaré. Et, non seulement M. Bergson les a laissés faire, mais encore il s’est joint à eux, afin de diriger d’une main de cher maître les manœuvres de ces mauvais disciples, qui forçaient le libre cours de l’individuelle intuition pour alimenter de ses eaux canalisées toutes les nationales Wallaces de France.
Agathon et ses amis n’avaient attaqué les méthodes expérimentales de la Nouvelle Sorbonne que dans le but politique de heurter l’influence allemande. Ils se firent admirateurs de la philosophie bergsonienne pour des raisons analoguement pratiques. Les jeunes partisans de M. Poincaré n’allaient vers l’intuition que pour repêcher en ses eaux troublées tous les vieux fantômes du spiritualisme autoritaire. Avec la conscience intuitive, ils voulaient faire ressusciter l’âme obscure de la théologie.
Henri Bergson, en outre d’un original philosophe, est un parleur séduisant. Il a la voix qui plaît aux femmes. Aussi, malgré qu’elles ne saisissent grand’chose de l’intérieure symphonie du maître, les dames du Tout-Paris ne manquèrent-elles pas de se montrer ses assidues auditrices. Ces belles « parfumées » allaient se bercer aux onctueuses prononciations du psychologue, afin de s’accorder hebdomadairement leur petite illusion d’Idéal. M. Bergson leur accordait cet encens de mysticité, qui convient à la composition de leur « chic ». Il remplaçait le Père Olivier. Grâce à lui, le Collège de France devint à la mode. Pour entendre son cours, on y faisait retenir ses places par des larbins, comme à Notre-Dame, le jour d’un grand prêche, et à Saint-Augustin, pour la soirée musicale et vocale d’une nuit de Noël ou doit chanter Lucienne Bréval.
En Bergson le philosophe se doublait d’un « m’as-tu-vu ». Afin de faire chanter celui-là, les commis-voyageurs en grande guerre surent à merveille toucher les cordes de celui-ci. Tout marcha selon les désirs de M. Poincaré. M. Bergson fut assez cabotin pour faire monter son pur génie sur les planches du petit théâtre où se devait répéter, entre premiers rôles, les premières scènes de la « Cochonnerie sanglante ».
Voilà comment se joua la farce de la « Conversion de Bergson ».
Quelque temps, M. Bergson laissa faire d’elle seule la malicieuse ignorance de ses intéressés disciples. Les collaborateurs de l’Opinion en même temps que ceux de la catholique Revue hebdomadaire, se mirent soudain à entonner un cantique d’enthousiasme à la gloire de l’auteur de « Matière et Mémoire ». Tous n’eurent qu’une voix pour proclamer la mort de l’analytique intelligence et le salut de l’âme par l’intuition. Dès lors ce fut comme une vague d’admiration qui se propagea en tous les périodiques du cléricalisme et du nationalisme. Dans tous les cercles pieux de la jeunesse studieuse, les directeurs de conscience laissèrent de recommander à leurs fidèles la dangereuse méditation toujours prête à s’empoisonner de critique, afin de laisser leurs âmes de brebis vaguer au flot qui les emporte confusément en l’intuition divine. Ces Messieurs, dans leur prosélytisme bergsonien, feignaient d’ignorer l’essentiel de l’enseignement du maître et leurs commentaires mensongers de son chant assassinaient l’intuition libre. Henri Bergson, loin de les démentir pour défendre l’âme de son âme, vint à leur aide et dirigea leurs coups. Il accepta sur sa face le baiser des multiples Judas et le leur rendit en plusieurs reprises sur chacune de leurs fesses généreusement.
Avec son état-major d’Iscariotes, le général Bergson faisait de l’intuition la neuve stratégie de l’obscurantisme social. Ainsi la direction de la vie psychologique n’était niée à l’intelligence raisonneuse qu’afin de supprimer dans la conscience de l’individu toute possibilité de libre examen. Tandis que les œuvres capitales de Bergson repoussaient en l’analytique pensée la force de totalisation dominatrice, les nouveaux articles de Bergson dans l’Opinion et dans les Études, niaient surtout en elle l’instrument de l’individuelle libération.
Bergson chez les patriotes et chez les Jésuites voulait oublier les Données immédiates de la Conscience et les fines précisions de l’analyse qui lui servit à dégager la sensation de l’artificielle enveloppe d’objectivité physique en laquelle elle s’atrophiait au service de l’action collectivement pratique. Aussi feignit-il d’ignorer, comme ses nouveaux admirateurs, qu’afin de retrouver l’âme intuitive dans l’âme d’un homme, il fallait auparavant, pour la faire éclore dans toute sa pureté subjective, user de la même analyse avec l’individualité entière afin de la libérer de la vieille gangue d’objectivité sociale qui l’opprime jusqu’à l’étouffement.
Car le philosophe de l’intuition savait ce qu’il devait à l’intelligence. Si les méthodes de la connaissance ne valent pas plus en leur logique qu’en leur expérimentation pour fouiller aux vierges profondeurs de subjectivité psychique, elles sont au contraire d’une incontestable utilité pour s’appliquer aux faits de l’objectivité pratique. Si la science ne peut rien pour créer dans l’impalpable infini de la personnelle spiritualité, elle peut tout pour détruire dans le domaine collectif de la Matière. Si l’on ne peut jamais atteindre l’âme que par l’âme même — et si les arguments de force extérieure ne peuvent ni contraindre ni anéantir l’individualité qui se sent parfaitement libre en son harmonie intérieure, de la même façon on ne peut jamais se défendre des attaques de la Matière qu’avec des objets de Matière. On ne détruit les faits qu’en leur opposant les faits. On ne se sauve de la Brute qu’en lui opposant ses propres instruments. Pour échapper à l’étreinte du collectif il faut user des armes qui ont prise sur lui. Le réfractaire qui à déserté les armées pour ne pas accomplir par ordre la fonction de meurtrier, ne craint pas, quand il est traqué par les gendarmes qui menacent de leurs fusils la liberté de son être, de répondre à leurs injonctions de se rendre ou de mourir, par le seul argument que puissent comprendre des représentants de la force : le revolver. Ainsi l’âme qui se veut vivre harmonieusement en dehors des nécessités qui lui sont étrangères, fuit les collectives classifications de la Raison humaine pour se retrouver en la liberté de son intuition, mais quand les concepts généraux, vieux gendarmes de la Raison, dressent encore leurs menaces d’autorité autour de sa jeune éclosion, pour sa défense personnelle elle aussi sait user de l’arme qui convient, l’arme destructive : un peu de raison chargée d’analyse braqué contre les monstres du rationalisme analytique.
L’intelligence ne doit pas être ma fin, mais elle reste un instrument dont il me faut apprendre l’usage individuel, afin de ne m’en servir que dans les circonstances qui le réclament, afin de savoir en user quand il est utile à mon bien et de pouvoir le repousser quand il risque de passer les limites de mon service pour continuer son œuvre de destruction analytique au-delà de son domaine d’objectivité, jusqu’en l’harmonie de subjective synthèse qui vit en moi par l’intuition.
Le raisonnement intellectuel pour l’individu qui cherche son âme de libre beauté aux profondeurs de sa vie telle que la lui ont conditionnée les brutales lois de l’hérédité et de la société, est comme le pic entre les mains du fouilleur d’archéologie. Aux profondeurs du sol, il sait que vit l’œuvre d’art.
Il faut dégager des étreintes sales de la terre les lignes qui chantent en la statue le rêve d’une âme. Le pic est là. L’ouvrier sait que ce morceau de fer est façonné pour la destruction et qu’un seul coup de son poids peut aussi bien briser le roc brutal que le marbre animé. Mais le chercheur sait aussi ce qu’il veut. Il entend les plaintes vers la lumière des courbes où survit l’amour de l’artiste, et il sait que de la création lutte là-dessous tout au fond avec la destructive matière. Alors il n’hésite pas. Il prend le pic et violemment il oppose à la force brutale qui pèse de son poids de mort sur de la vie, l’élan contraire d’une identique brutalité. Il frappe la terre avec une méthodique force, il creuse, il fouille ; le roc jaillit en éclats, la blessure s’élargit en coups précipités dans le sol hostile, tant qu’il entend encore, lointains, les appels de l’harmonieuse ensevelie. Mais voici que la voix s’éclaircit et qu’elle se fait déjà musique d’enchantement aux approches de la clarté… La terre n’est plus sur l’œuvre d’art qu’une mince couche de pourriture… Alors le chercheur sait abandonner le pic dont les coups trop précis risqueraient de blesser l’ensevelie, et, accroupi contre le sol où ses genoux tremblent d’émoi, de ses mains d’hésitante délicatesse, en des mouvements rythmés comme des caresses, il achève de délivrer la beauté de son cilice de boue.
C’est à cette libre recherche que M. Bergson s’est refusé du jour où il devint le maître des jeunes politiciens de l’Opinion. Il n’a pas eu le courage de prendre la pioche afin de libérer l’ensevelie. Il a nié l’intelligence à la libre-critique de l’individu voulant dégager de tout le poids étouffeur de l’éducation sociale l’harmonieuse vie de son âme. Il a laissé l’intuition enfouie sous la terre, avec son cilice de vieille boue. Il l’a condamnée au supplice de la profonde obscurité.
Et quand il en fit entendre la voix aux jeunes gens bien pensants de France, ce n’en pouvait être que l’horrible lamentation aux accents déformés par les millénaires prisons, une voix semblable à celle de ces torturés que l’Inquisition faisait parler en l’épouvante de la roue de feu ou du tenaillement des chairs, une voix de servitude dans les ténèbres.
En prêchant l’abandon de toute analytique fonction intellectuelle, il privait l’individu de son unique instrument de défense, il lui rendait impossible cette critique anarchiste qui seule pouvait lui permettre de se dégager de la collective raison pour éclore à l’intuitive création. L’être social que l’on prive d’intelligence est comme le forçat à qui son gardien arrache les cisailles avec lesquelles il espérait rompre sa chaîne. Il ne retrouvera jamais la liberté.
Aux jeunes gens de la patrie française et à l’Église catholique, M. Bergson traduisit ainsi sa philosophie :
« En moi est l’intuition — vague et fluide mouvement de ma vie intérieure. C’est elle qui me donne le sens de la vie. Je pense, donc je suis. Mais cette intuition à l’état premier n’est qu’un sens informe qui ne suffit pas à créer l’harmonie intérieure. Écoutons donc la voix humaine qui chante en nous. Suivons les conseils de cette ancienne. Elle s’exerce depuis les commencements, comme un écho de la création. Écoutons la voix humaine, la générale intuition qui symphonise en elle seule toutes les particulières symphonies intuitives. Elle nous indique quel est le sens, le grand sens — c’est le Bon Sens. Et dites : Je sens bien, donc je suis esclave. » Et il ajoutait : « Cependant, s’il est en vous quelque élan qui veut dépasser le sens commun des hommes, s’il chante encore en vos profondeurs une voix qui ne s’accorde pas avec celle du Bon sens, ne soyez pas orgueilleux, mes fils, et ne vous croyez pas pour cela en dehors de l’universel. Cette voix d’au-delà vous appartient moins encore que votre chant d’en deçà. Ce sens qui vous fait dépasser le Bon sens n’est pas votre individuelle clarté. Il ne signifie pas votre pouvoir de création. Il est, tout au contraire, en vous une clarté d’universel, un éblouissement de Dieu, c’est le sens divin. Avec l’intuition chacun de vous porte en soi un fragment de Dieu. Mais ce ne sont là en vous que d’infinitésimales petites ondes qui ne peuvent avoir aucune puissance sur l’harmonie du Grand Créateur. Car Dieu qui est un peu dans toutes les intuitions n’est tout voulant et tout puissant que dans sa parfaite totalité. Il est la grande intuition, la seule libre. Chacun de nous n’est libre qu’en participant à sa liberté. Pour connaître Dieu en chacun de vous, cherchez en votre âme la voix du Don Dieu. Car vous êtes une créature de Dieu. Et dites : « Je crois en Dieu, donc je suis libre ».
Ainsi Bergson faisait son Descartes. Le rationaliste du « Discours sur la Méthode » avait prononcé « Je pense, donc je suis », puis, sans plus de discours, il avait noyé l’esprit dans le Saint-Esprit. Le père de l’intuition ne fut pas plus tendre pour sa jeune progéniture. D’un air inspiré, il chanta : « Je sens, donc je suis » puis en quelques cantiques d’agenouillement au pied du drapeau et de l’autel, il prostitua le « sens » au « Bon Sens » et fit se noyer l’âme libre aux fonts baptismaux du Bon Dieu.
Une fois de plus la France était sauvée. Elle redevenait la fille chère de l’Église. Bergson n’avait trouvé l’individuelle clef du monde intérieur que pour la vendre au Saint-Pierre-Bon-Sens afin d’enrichir de sa dorure le traditionnel trousseau de ses innombrables clefs de vieux Paradis. Grâce à M. Bergson, la France possédait une âme, une seule âme soumise et fidèle. Elle était mûre pour le maître : M Poincaré pouvait venir.
Cela se passait eu 1912…
Dix ans ont passé. La Guerre a fauché le Monde. M. Bergson continue à philosopher…
« Primun vivere…» lui clament les millions de morts. Oui, d’abord vivre, et ne philosopher que pour mieux vivre.
André Colomer.
- 1Jeunes Gens d’aujourd’hui, par Agathon, parut en 1913. Ce livre, comme fait sur commande, eut une grosse influence dans la jeunesse des Universités, pour la préparer à l’idée de la guerre.
- 2La vérité consiste dans le mot et non dans la chose.
- 3La vérité ne consiste ni dans le mot, ni dans la chose, mais dans la sensation.
- 4Aux sources de l’Héroïsme Individualiste. « De Bergson au Banditisme » (L’Action d’Art, 1913).