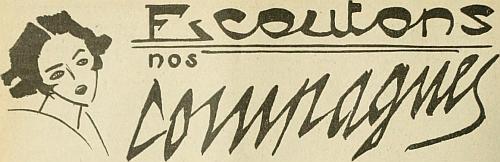
Un des reproches les plus fréquemment adressés aux femmes, c’est qu’elles manquent d’originalité, qu’elles se ressemblent un peu toutes. On s’accorde à leur reconnaître plus de sensibilité qu’à l’homme, mais c’est pour mieux leur retirer les aptitudes proprement intellectuelles — esprit critique, idée de la différenciation des idées et des choses — qui restent ainsi l’apanage incontesté du sexe fort. Elles sont rares, en littérature comme en art, les femmes qui ont inscrit leur nom, et la proportion de celles-là, si faible à côté des hommes, est un effet, sans doute, de leur médiocrité intellectuelle. Du moins, beaucoup d’hommes le pensent ainsi.
En art, prétendent-ils, comme partout où elle essaie de se mesurer avec l’homme, la femme n’a jamais réussi à créer vraiment. Là où elle a fait quelque chose, elle a simplement copié, imité un modèle en l’adaptant, en le transposant aux conditions nouvelles, aux temps nouveaux.
Mais, peut-on répondre, les artistes eux-mêmes (les artistes hommes, bien entendu) sont-ils donc si originaux, si créateurs ? Il y a toujours, dans l’œuvre d’art, une grande part d’imitation, et celle qui revient à l’invention purement personnelle est, le plus souvent, très réduite. Dans toute œuvre artistique, il y a beaucoup plus de notions acquises que de spontanéité. L’originalité suppose une grande force individuelle, qui s’attache, avant tout, à briser les liens du passé pour marcher librement vers l’avenir. Peu d’hommes sont capables d’un tel effort, ou portent en eux un tel don. Peu de femmes aussi : car le respect des traditions, l’enchantement du passé, le besoin de sécurité que la femme, le plus souvent, porte en elle-même, et que l’éducation développe encore, toutes ces habitudes de penser et d’agir ne sont guère propres à développer l’originalité de l’esprit féminin.
Son rôle naturel, qui est de créer un foyer et de le conserver, oblige la femme à rechercher la sécurité sous tous ses aspects, physiques et moraux. Et la sécurité, au point de vue matériel, c’est la régularité dans le travail, c’est une « position sûre », c’est le logement stable, les meubles à soi ; au point de vue moral, ce sont les idées susceptibles de faire obtenir ou de protéger cette sécurité matérielle, les opinions en cours, peu discutées, nullement dangereuses. Ennemie des bouleversements, la femme, le plus souvent, préfère une vie médiocre, mais sûre, à une existence meilleure, achetée au prix de trop grands efforts, d’une perte de sa tranquillité. Ses enfants ont besoin de calme, pour grandir ; la mère doit le leur procurer. C’est peut-être pour cela que la nature a fuit ainsi la femme.
On ne peut, certes, se faire autre qu’on est ; mais on pourrait sans doute se modifier, si on en prenait la peine et si on s’y appliquait assez tôt. Si l’éducation, au lieu de confiner l’esprit des femmes dans le domaine familial, avait essayé de réagir contre leur paresse intellectuelle, elle aurait contribué fortement à faire un monde beaucoup plus beau que le monde actuel. Mais l’éducation féminine, orientée généralement dans le sens ménager et matrimonial, ne se préoccupe guère de faire penser la femme. Dressée en vue de l’homme, du mariage et de la famille, pourquoi se soucierait-elle de penser ? Qu’elle soit tranquille à ce sujet, d’ailleurs, car d’autres penseront fort bien pour elle. Ce sera peut-être contre elle, plutôt que pour elle, qu’ils penseront ; mais la femme, reléguée dans sa cuisine ou son ménage, ne s’en apercevra pas, ou ne pourra rien faire pour y remédier.
Et, pourtant, la femme parait être, avec l’enfant, particulièrement sensible à l’influence de l’éducation, beaucoup plus suggestionnable, et aussi plus portée à s’assimiler facilement les idées reçues. On lui reproche d’imiter toujours, comme les enfants. Mais le propre de l’éducation, c’est de proposer aux élèves un certain modèle, ou, si l’on veut, un certain idéal, dont ils devront s’inspirer plus ou moins, en le modifiant selon leur tempérament particulier.
Mais, parce que l’exemple du mal est plus contagieux que celui du bien, parce que les choses absurdes ou mauvaises sont, davantage que les autres, au niveau mental de la majorité des humains, on suit, naturellement, la pente facile, qui ne demande nul effort.
Les entraînements collectifs ont beaucoup de prise sur l’esprit des femmes ; mais, à cet égard, combien d’hommes leur ressemblent!… On a raillé maintes fois leur aveugle soumission aux exigences de la mode, cette reine d’un jour. Cette contagion, si absurde soit-elle, souvent, est du moins plus inoffensive que d’autres, comme le patriotisme, le sentiment de l’honneur, dont les exigences réclament les plus basses cruautés. Ce besoin d’être « comme tout le monde », si les femmes l’éprouvent, est d’ailleurs combattu en elles par la vanité, qui lui dispute souvent la prépondérance. Malheureusement, l’éducation exagère, là aussi, les travers de la nature. On leur a enseigné à plaire, et là se bornent trop souvent leurs désirs. Les femmes, sensibles à l’apparence, recherchent la supériorité en se distinguant par leur parure, leurs relations, le souci d’éclipser par leur luxe, vrai ou faux, leurs amies moins fortunées.
Cette émulation, qu’elles manifestent en elles pour des buts insignifiants ou nuisibles, l’éducation pourrait la diriger dans le sens de la raison. Ce ne sont pas, chez elles, les qualités naturelles qui font défaut, mais l’éducation ou l’habitude qui les ont perverties, et qui sont, en grande partie, responsables des méfaits qu’on attribue à la nature ou à la fatalité.
La femme ne possède-t-elle pas, comme l’homme (je veux dire l’homme intelligent) cet esprit de recherche, de curiosité, d’insatisfaction, qui est la condition première de toute transformation, de tout progrès ? Dans la marche de l’humanité, l’homme seul devrait-il, par son désir de nouveauté, de création, frayer hardiment le chemin, tandis que sa compagne, gardienne éternelle, se bornerait à conserver les conquêtes anciennes ? Elle aussi, cependant, elle éprouve, comme lui, un désir d’émancipation, d’idéal, de rêve. Elle aussi a besoin de sortir de la monotonie banale où la renferme sa vie. Mais ce n’est pas dans le domaine intellectuel qu’elle donne libre cours à ce désir, car son domaine à elle, c’est l’amour. Semblable à l’héroïne de Flaubert, c’est sa vie sentimentale qu’elle tend à modifier dans le sens de ses rêves ; c’est par elle qu’elle voudrait modeler son existence sur un idéal qui reste toujours d’autant plus irréalisable qu’il paraît plus beau.
Idéaliste dans l’amour, pourquoi la femme ne le serait-elle pas dans les autres conceptions de la vie ? Il suffirait, peut-être, de diriger son activité, ses désirs et ses forces dans un sens plus intellectuel ; de donner à son esprit, sensible aux suggestions de l’exemple, un idéal de vie à la fois grand et simple, et surtout de lui montrer cette supériorité, réalisée, autant qu’il se peut, dans une vie humaine.
Une Révoltée.
