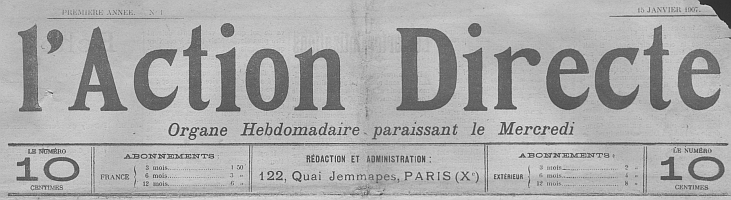Décidément la discorde est dans notre camp anarchiste et, de la plume ou de la « gueule » on s’y dispute carrément. Peut-être me dira-t-on qu’entre anarchistes la chose n’a pas autrement d’importance, les compagnons s’étant de tout temps signalés comme d’incorrigibles disputeurs. Hélas ! je ne le sais que trop ; et je me rappelle même un enragé ratiocineur qui, s’asseyant le soir auprès de son ami, lui disait doucement : « Fais-moi de la contradiction ! ». Car c’est par la contradiction, n’est-ce pas, que s’affirme l’individu.
Le brandon de nos discordes actuelles, est-il besoin de le dire, c’est le syndicalisme. Lui encore, lui toujours, lui partout ! Sous le beau prétexte qu’il se suffit à lui-même, le syndicalisme révolutionnaire, ayant signifié leur congé aux politiciens et aux idéologues également avides de diriger la conscience ouvrière, politiciens socialistes et idéologues anarchistes ne lui ont pas encore pardonné.
La rancune des premiers se conçoit sans peine : ils sont les premières victimes du mouvement nouveau. Mais l’attitude des seconds dépasse l’entendement des hommes simples. Comment ! voilà des gens qui, pendant 20 ans, ont exhorté le « peuple » à faire ses affaires lui-même, et lorsque le « peuple » semble vouloir enfin profiter du conseil, ils n’ont rien de plus urgent que de lui démontrer sa radicale impuissance ! C’est le comble de la contradiction.
Cette contradiction est-elle inexplicable ? Je ne le pense pas. Malgré les excellents conseils qu’ils ont toujours donnés à la classe ouvrière, les théoriciens anarchistes n’ont jamais eu pleine confiance en elle. Ils ressemblaient sur ce point à leurs frères ennemis du guesdisme. Ces derniers suspectaient si bien la capacité révolutionnaire du prolétariat qu’ils ne demandaient à celui-ci autre chose que de bien voter, eux se chargeaient du reste. Les anarchistes, eux, n’attendaient rien que d’une classe ouvrière préalablement déterminée par leur propagande, éclairée et guidée par la lumière intérieure de leur doctrine. Pour les uns comme pour les autres, le prolétariat ne fut jamais qu’un instrument. Les uns voulaient s’en servir pour s’emparer du pouvoir, les autres pour réaliser leur idéal de société future. Les uns et les autres se considéraient comme les cervelles pensantes de la révolution sociale : quant à la classe ouvrière. C’était des bras, d’innombrables bras, la main-d’œuvre révolutionnaire et rien de plus.
Et ceci nous explique la colère des uns et le désappointement des autres au cours des derniers évènements, quand la classe ouvrière militante, mûrie par des années d’expérience, fortifiée par toutes les luttes qu’elle avait soutenues, déclara, en son Congrès d’Amiens, qu’elle n’avait que faire des partis, des écoles et des sectes qui se disputaient ses faveurs et qu’elle entendait travailler seule à sa propre émancipation. Idéologues et politiciens n’en sont pas encore revenus.
* * * *
Cependant je me hâte de le dire : tous les anarchistes n’ont pas accueilli avec mauvaise grâce les affirmations syndicales. Il en est qui y ont applaudi. Tous les anarchistes en effet ne sont pas des idéologues âprement intéressés au maintien des vieux dogmes, et quels qu’aient été les ravages qu’a exercés sur nous la folie intellectualiste des vingt dernières années, il restait parmi nous des camarades plus attentifs au mouvement qu’à la doctrine et plus soucieux des faits changeants que des formules immobiles.
Ainsi que j’ai dit ailleurs, c’était mal connaître l’anarchisme que de le juger tout entier contenu dans les dissertations philosophiques, sur l’individu, la société, l’influence du milieu, les réformes et la révolution, l’initiative individuelle, la liberté, l’autorité, etc., etc., dissertations excellentes peut-être, mais sans rapport sensible avec l’action révolutionnaire.
« La vérité, disais-je, est que, parallèlement à certain anarchisme théorique, curieux de généralisation abstraite, s’en développait un autre, que nous appellerons l’anarchisme ouvrier, et qui, sans abandonner jamais la terre ferme des réalités concrètes, se dévouait avec continuité à l’organisation du prolétariat en vue de la révolte économique, autrement dit de la lutte de classe. »
Oui, il y a toujours eu, évoluant en des sphères distinctes et s’ignorant à peu près l’un l’autre, deux anarchismes de physionomie et de direction essentiellement différentes.
L’anarchisme doctrinaire, parce qu’il était ignorant des faits économiques et, plus généralement, de l’histoire, est resté étranger à la notion de classe (qu’un de ses derniers tenants appelait hier encore une superstition). Il n’a vu, au sein d’une société abstraite, que des individus abstraits, se débattant contre des institutions abstraites (autorité, propriété, etc.): des fantômes aux prises avec d’autres fantômes ! À la lutte de classe, il a substitué la lutte des idées ; à l’action qui désorganise ou qui crée, la propagande qui tâche de convaincre ; il fait de la révolution une question d’éducation et de morale. Il allait déclamant que l’organisation est dangereuse ou inutile, la seule organisation acceptable ne pouvant être que celle qui, sans cadres et sans règles, découle du fait qu’un certain nombre d’individus communient dans un même idéal. On ne voulait pas de parti, mais on formait une secte, condamnée à n’avoir jamais qu’une activité de secte.
Les Temps Nouveaux (dans leur article-programme de 1895) ont jadis défini les anarchistes de la manière suivante : « Des hommes qui ayant recueilli les plaintes de ceux qui souffrent de l’ordre social actuel, s’étant pénétrés des aspirations humaines, ont entrepris la critique des institutions qui nous régissent… et, de l’ensemble de leurs observations, détruisent des lois logiques et naturelles pour l’organisation d’une société meilleure.»
Des lois logiques et naturelles, entendez-vous ? Toute la philosophie du XVIIIe siècle, acharnée à poursuivre le meilleur gouvernement possible, à déduire des « lois logiques et naturelles » formulées par les fortes têtes du temps une bonne petite utopie, toute cette sottise se retrouve dans la phrase précitée.
Des lois logiques et naturelles ! Parbleu, c’est bien cela et nous n’avons plus qu’à nous taire, à présent que tout est dit. Elles sont naturelles parce que logiques et logiques parce que naturelles. Dépassé Lycurgue!! Enfoncé Solon ! Ce Spartiate et cet Athénien ne travaillaient que pour un temps et pour un pays. Le législateur anarchiste formule des constitutions pour toute l’humanité à venir. La Science, la Raison, la Nature parlent par sa bouche : l’humanité n’a plus qu’à se constituer conformément. Elle ne saurait manquer de le faire quelque jour, lorsque nous l’aurons convertie. Alors la logique abstraite disciplinera révolutionnairement la vie et la toute puissante idée mécanisera une fois de plus la réalité !
Cette sociologie fantaisiste, qui s’ajustait si bien à l’incompétence totale des littérateurs, a fait jadis quelque fortune. L’anarchisme « philosophique », parce qu’il était idéologie (ou phraséologie) toute pure devait naturellement séduire les intellectuels de tout acabit, qui sont une des créations les plus réussies de la civilisation bourgeoise. C’était au temps où l’idéalisme venait de « renaître ». De jeunes messieurs, de vieilles madames miaulaient à l’idéal. Il fallait de l’idéal, et bien moderne, à ces âmes défaillantes. L’anarchie en était un tout battant neuf : on lui fit fête… À qui la faute, sinon à ceux qui n’avaient pas su conserver à l’anarchisme sa figure originelle, son caractère de philosophie ouvrière, de mouvement prolétarien ?
* * * *
L’autre anarchisme, lui, gardait jalousement ce caractère de classe. Il conservait ce sens des réalités temporelles qui manquait à l’autre. Il pensait volontiers que la propagande n’est pas toute l’action et que l’expérience doit à tout instant renouveler la théorie. Encore qu’il parlât peu de la lutte de classe, déconsidérée par l’imbécillité guesdiste, il la pratiquait d’une manière large et vivante et mettait tous ces soins à séparer sur toute la ligne le prolétariat de la bourgeoisie. L’anarchisme ouvrier n’était pas très différent, à ses origines, de l’allemanisme ; et même il est curieux de remarquer que le premier écrit sur la grève générale fut l’œuvre commune d’un anarchiste et d’un allemansite ? Il fut « syndicaliste » dès la première heure, avec Pelloutier, avec Pouget, avec Delesalle, avec tant d’autres dont les noms restent ignorés.
Entre l’anarchisme idéologique et l’anarchisme ouvrier, les divergences étaient telles que le conflit ne pouvait manquer de se produire. Il se fut produit beaucoup plus tôt sans doute si les anarchistes syndicalistes eussent été plus soucieux de polémiques écrites.
C’est au Congrès d’Amsterdam, au cours du débat incomplet et rapide qui eut lieu sur le syndicalisme et la grève générale, que l’anarchisme ouvrier fit ses premières affirmations théoriques ; mais là, il n’avait pas en face de lui son véritable adversaire : l’anarchisme idéologique et ses affirmations y perdirent en force et en netteté.
Le débat s’est poursuivi depuis dans les principaux journaux anarchistes de France, de Belgique et de Suisse. Il s’est à la fois élargi et élevé. La question n’est plus tant de savoir si le Syndicat a ou n’a pas de valeur révolutionnaire. Le débat est actuellement entre ceux qui veulent renouveler l’anarchisme au contact de la réalité prolétarienne, et ceux qui, insensibles aux réalités de la vie, s’entête dans l’immobilité du dogme et l’impuissance de la formule.
Amédée Dunois