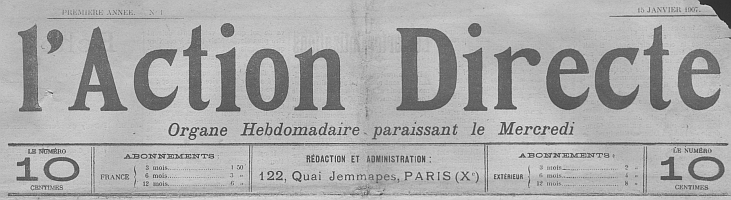L’«Almanach de la Révolution, pour 1908 » (p.60), pose la question suivante : « Qui s’est le premier servi, dans la lutte ouvrière, de la formule si expressive et si bien appropriée : “Action Directe”?»
Elle cite le passage suivant d’un article de Fernand Pelloutier, dans l’«Ouvrier des Deux-Mondes » du 1er février 1897 : « Le Syndicat des Employés du département de la Seine, convaincus que le moyen d’opérer des modifications dans les conditions du travail dépend beaucoup plus de l’“action directe” exercée par les Syndicats contre les patrons, que des inutiles appels à l’intervention législative ou administrative, vient de décider une campagne de propagande. »
L’«Almanach » après avoir reproduit cette phrase, conclut ainsi : « Pelloutier, jusqu’à preuve du contraire, semble bien être le premier qui ait employé si à propos, dans la lutte ouvrière, le vocable “Action Directe”. En est-il le père ? »
À mon tour, j’apporte deux citations, extraites du « Bulletin de la Fédération Jurassienne de l’Internationale » numéros du 1er novembre 1874 et du 28 février 1875.
Dans l’article du 1er février 1874, il s’agit d’une campagne entreprise en Suisse pour la diminution de la journée de travail. À ceux qui voulaient avoir recours à l’intervention législative, le « Bulletin » répondait ceci :
« Notre opinion est que c’est aux ouvriers eux-mêmes à limiter la durée de la journée de travail. Si les ouvriers le veulent sérieusement, ils peuvent par la seule puissance de leur organisation en société de résistance, forcer la main aux patrons sur ce point, sans avoir besoin de l’appui d’aucune loi de l’État. Et, au contraire, si les ouvriers ne sont pas organisés de manière à pouvoir imposer leurs volontés au patrons, ils auront beau invoquer le texte d’une loi que leur aurait octroyé le pouvoir législatif : cette loi sera constamment éludée et restera à l’état de lettre morte parce que les ouvriers ne seraient pas assez forts pour contraindre la bourgeoisie à l’exécuter. »
Et la méthode à suivre pour « forcer la main » à la classe capitaliste était décrite en ces termes :
« Les ouvriers se sont organisés partout en sociétés de métiers. Ces sociétés se sont groupées en Fédérations corporatives, et ces Fédérations, à leur tour, se sont fédérées entre elles couvrant tout le pays d’un vaste réseau. C’est l’armée du travail, une armée qui, une fois aguerrie et disciplinée, est en état de tenir tête à la bourgeoisie et de lui dicter ses volontés.
« Lorsque cette organisation est réalisée, quelle est la marche à suivre pour obtenir des réformes sociales ? Les ouvriers ont-ils besoin de s’adresser en humbles pétitionnaires à l’autorité législative pour la prier de les prendre sous sa protection ? Nullement. S’ils veulent raccourcir la journée de travail, ils signifient à leurs patrons leur volonté, et, la résistance à l’armée du travail étant impossible, les patrons sont forcés de céder. S’agit-il d’augmenter les salaires, de prendre des mesures concernant le travail des femmes et des enfants, etc.? On emploie le même moyen : au lieu d’avoir recours à l’État, « qui n’a de force que celle que les ouvriers lui donnent », les ouvriers « règlent directement l’affaire avec la bourgeoisie, lui posent les conditions, et, par la force de leur organisation, la contraignent de les accepter. »
La même question est traitée dans l’article du 28 février 1875 :
« Pour la réduction de la journée de travail, lorsque les ouvriers jugeront le moment opportun pour introduire cette réforme dans tel métier, ils sont parfaitement en état de le faire par l’«action » des sociétés de résistance. Au lieu d’implorer de l’État une loi astreignant les patrons à ne faire travailler que tant d’heures, la société de métier « impose directement » aux patrons cette réforme ; de la sorte, au lieu d’un texte de loi restant à l’état de lettre morte, il s’est opéré, « par l’initiative directe des ouvriers », une transformation dans un fait économique.
Ce que la société de résistance peut faire pour la réduction des heures de travail, elle peut également le réaliser au point de vue du travail des femmes et des enfants, des conditions hygiéniques, des garanties en cas de blessure ou de mort au service d’un patron, et dans bien d’autres questions encore.
«– Très bien, nous dira-t-on : mais ces réformes « opérées directement par les ouvriers » dans leurs métiers respectifs, ne serait-il pas utile de leur donner une sanction légale ?
« Nous répondons : cette sanction ne peut avoir aucune valeur ; car, si la situation économique, si la puissance d’organisation ouvrière font de ces réformes un fait qui pénètre dans les mœurs publiques, elles resteront acquises, et leur vraie garantie se trouvera dans la pression exercée par l’organisation ouvrière ; tandis qu’au contraire si une situation économique défavorable, un relâchement dans l’organisation ouvrière, devaient amener une réaction contre ces réformes, aucune sanction légale ne serait capable d’arrêter cette réaction.
« La tendance de certains groupes ouvriers d’attendre et de réclamer toutes les réformes de l’initiative de l’État, nous paraît un immense danger. En attendant tout de l’État, les ouvriers n’acquièrent point cette confiance en leurs propres forces qui est indispensable à la marche en avant de leur mouvement ; le grimoire des lois s’accroît de quelques nouveaux textes et la position ne change en rien.
« Au lieu de dire cela, si les ouvriers consacraient toute leur activité et toute leur énergie à l’organisation de leurs métiers en sociétés de résistance, en fédérations de métiers, locales et régionales ; si, par les meetings, les conférences, les cercles d’études, les journaux, les brochures, ils maintenaient une agitation socialiste et révolutionnaire permanente ; si, joignant la pratique à la théorie, ils ‘réalisaient directement’, sans aucune intervention bourgeoise et gouvernementale, toutes les réformes immédiatement possibles, la cause du travail serait mieux servie que par le recours à l’intervention législative.
« C’est là notre programme : nous rejetons toutes les fictions légales, et nous nous consacrons à une action permanente de propagande, d’organisation, de résistance, jusqu’au jour de la Révolution sociale. »
Voilà comment, il y a plus de trente ans, dans un journal de l’Internationale, on préconisait l’‘Action Directe’. Si les ‘mots’ n’y sont qu’approximativement : ‘les ouvriers ‘règlent directement’ l’affaire avec la bourgeoisie’, – ‘action’ des sociétés de résistance… imposant ‘directement’ aux patrons une réforme’, ‘transformation dans un fait économique opérée par l’‘initiative directe’ des ouvriers’, – ‘réformes’ opérées directement” par les ouvriers », etc., la « chose » y est de la façon la plus explicite.
L’article du 1er novembre 1874 a été écrit par le soussigné, celui du 28 février 1875, par Adhémar Schwitzguébel.
Une autre citation encore me semble avoir également son intérêt. Le 6 avril 1870, à la Chaux-de-Fonds, le Congrès de la « majorité » de la Fédération romande de l’Internationale (après la scission provoquée par la « minorité » politicienne que menaient Coullery et Outine) vota à l’unanimité, sur le rapport de Schwitzguébel, la résolution suivante :
« Le Congrès Romand recommande à toutes les Sections de l’Association Internationale des travailleurs de renoncer à toute action ayant pour but d’opérer la transformation sociale au moyen de réformes politiques nationales, et de porter toute leur activité sur la constitution fédérative des corps de métier, seul moyen d’assurer le succès de la révolution sociale. Cette Fédération est la véritable représentation du travail, qui doit avoir lieu absolument en dehors des gouvernements politiques ».
Voilà bien la conception que plus d’un quart de siècle après, au lendemain du Congrès d’Amiens, on a résumé dans cette formule qui a fait fortune : « Le syndicalisme se suffit à lui-même ».
Ces citations ne montrent-elles pas qu’il y a identité complète entre les idées et la tactique des militants de l’Internationale et celles du syndicalisme révolutionnaire actuel ?
James Guillaume