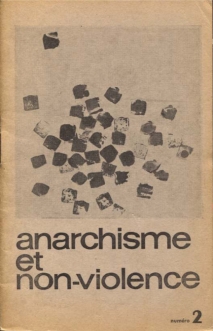Les anarchistes se sont, depuis toujours, faits les champions de l’action directe. Pour nous, il n’existe pas de méthode qui réponde mieux à nos désirs, à notre militantisme.
Or les non-violents se disent également partisans de l’action directe. Elle est à notre avis la seule qui nous permette d’agir de manière non violente. Il est alors permis de se demander si nous parlons de la même action directe, car celle qu’employèrent les anarchistes fut très souvent violente. Doit-on changer de terminologie ou bien les deux aspects sont-ils compatibles ?
Un individu peut agir par l’action directe sur un tiers, sur un groupe de personnes, ou bien sur lui-même (connaissance de soi). Nous ne nous préoccuperons pas ici de ce dernier aspect de la question, pour nous consacrer plus particulièrement au premier. Écoutons ce que dit sur ce point Pierre Besnard dans l’Encyclopédie anarchiste :
« L’action directe est une action individuelle ou collective exercée contre l’adversaire social par les seuls moyens de l’individu ou du groupement. »
Dans un tout récent ouvrage édité chez Julliard, Clemenceau, briseur de grèves (p. 20 – 21), nous trouvons la définition suivante :
« L’action directe signifie que, quelle que soit l’institution en cause, patronat, gouvernement ou parlement, aucun système représentatif, aucune délégation de pouvoir ne pourra jamais dispenser les travailleurs de s’occuper de leurs propres affaires, et de peser de leur poids propre ; outre son efficacité, l’action directe a une valeur de formation morale, de prise de conscience par l’exploité de sa responsabilité et de sa force : en ce sens, un syndicalisme qui renierait l’action directe se renierait lui-même. »
Ces deux définitions, bien que trop brèves, permettent de situer l’action directe qui est avant tout une action d’homme à homme, où les tiers non directement concernés sont éliminés.
Certains préférèrent les procédés violents, et cela pour de multiples raisons, aux procédés non violents. Examinons la forme prise par l’action directe suivant la méthode employée.
Les non-violents vont rechercher le dialogue. Il ne faut surtout pas qu’à la fin il y ait gagnants et perdants, mais au contraire des hommes qui se sont mis pleinement d’accord sur certains points. Par exemple, Vinoba ne prend pas la terre aux propriétaires, mais la leur fait donner librement. À aucun moment le non-violent ne fait preuve d’autorité, ne se place au-dessus de son adversaire (le terme d’adversaire ne devant pas être pris dans un sens péjoratif quelconque, mais signifiant seulement qu’une divergence d’opinions existe).
Le non-violent se considérera même responsable de l’attitude de son adversaire. L’exemple de Louis Lecoin qui jeûna à mort parce que le gouvernement n’avait pas tenu ses engagements est caractéristique. (Si Louis Lecoin ne se réclame pas de la non-violence, son acte peut être néanmoins considéré comme non violent.)
Par contre, certains se refusent à employer la non-violence, sans pour cela être violents. Écoutons à ce sujet Sébastien Faure (Encyclopédie anarchiste, article : Violence anarchiste).
« Je ne me bornerais pas à dire que la violence n’est pas anarchiste, j’affirmerais que la violence est anti-anarchiste. »
Mais pour des raisons tactiques, comme il l’ajoute plus loin, « les anarchistes ont la conviction que pour briser les forces d’exploitation et d’oppression il sera nécessaire d’employer la violence ».
L’action directe perd alors, incontestablement, une partie de son caractère spécifique. En effet, la violence pour s’exercer nécessite nue force matérielle (armes, nombre, etc.) qui joue le rôle d’intermédiaire entre les antagonistes. Les rapports n’ont pas lieu entre les intéressés eux-mêmes, mais entre des armes, des troupes. Certes les intéressés sont concernés et n’ont pas délégué leurs pouvoirs à des mercenaires, mais ils ne le sont qu’indirectement. L’action directe pure est sacrifiée à l’efficacité.
Il n’y a pas incompatibilité entre les deux formes prises par l’action directe, mais progression.
Je ne voudrais pas que ceux qui aujourd’hui continuent à employer la violence se sentent condamnés. Je demeure convaincu que le jour où la non-violence aura fait ses preuves en tant que force révolutionnaire, la plupart la pratiqueront. Mes réflexions n’ont pour but que de mieux, logiquement, coordonner nos actions et notre pensée.
Si la non-violence traduit mieux dans le domaine de l’action la pensée anarchiste, nous nous devons de la pratiquer, car si nous voulons demander au monde plus de logique, il nous faut nous-mêmes être à l’avant-garde.
Sans vouloir servir de guide, il nous faut donner l’exemple, sinon qui nous écoutera ? Toute révolution bien ordonnée commence par soi-même.
Jean Coulardeau