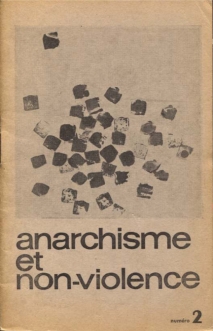De Robert Merle, nous connaissons déjà Week-End à Zuidcoote, bien connu maintenant par son adaptation cinématographique, et aussi La Mort est mon métier. L’Île a pour point de départ l’histoire des révoltés du Bounty qui s’appellera ici le Blossom. Mason, second à bord du Blossom, tue le capitaine Burt, dont la cruauté a révolté l’équipage. Les mutins fuient avec les Tahitiens, dans une île déserte, les rigueurs de l’amirauté britannique. Un « parlement » s’installe dans l’île, dominé par un marin rusé et sans scrupule, Mac Leod, et les marins rejettent l’autorité des officiers. Le refus de Mac Leod de partager équitablement les terres entre les Tahitiens et les Anglais amène une guerre à mort entre les deux communautés. Le lieutenant Purcell refuse seul de prendre les armes dans le conflit qui met aux prises ses amis tahitiens et ses compatriotes. L’histoire se passe à la fin du XVIIIe siècle.
Roman d’aventure ? Oui, mais sans rien de péjoratif, avant tout un roman très riche, dans lequel on peut trouver plusieurs thèmes mêlés : la révolte contre l’autorité, la liberté sexuelle, le racisme et, enfin, la non-violence. L’auteur s’est bien gardé, en tout cas, de tomber dans un exotisme bavard et inutile ; tout ce qui touche au cadre, à la vie des Tahitiens est dit sans surcharges et sans romantisme.
Nous voici donc dans une société en miniature, car tout de suite, au-delà du temps et de l’espace, on peut comparer cette « Île » à notre société actuelle. Mais revenons au roman, un antagonisme naît entre deux groupes ethniques différents : marins anglais et pêcheurs tahitiens, et cet antagonisme est causé par deux choses : la possession de femmes tahitiennes, d’une part, et un mode de vivre et subsister, d’autre part. Au milieu de ces deux groupes hostiles, un homme seul, Purcell, qui va chercher à concilier les intérêts de tous, qui louvoie, qui discute pied à pied avec une grande logique et une clarté inattaquable ; un homme qui refuse de régler ces problèmes par la force et par la violence. La cause des Tahitiens est juste, et l’auteur prend parti pour eux, par l’entremise de Purcell, mais ils veulent défendre par la force, et, bien sûr, le drame éclate à cet instant. La violence se déchaîne, et par l’«escalade » — pour employer un mot à la mode — arrivera à détruire la communauté. Purcell n’est pas non violent par tactique ou par faiblesse, il ne manque pas de courage, il n’est ni fataliste ni « surhomme » : il vit, il pense, il doute quelquefois, mais il est toujours conscient et responsable. Son problème est celui, véritablement, d’un homme qui refuse la violence et qui, automatiquement, est mis en accusation par les factions opposées. Peut-être est-ce là le véritable intérêt du livre d’avoir décrit un homme de chair et de sang qui choisit la position la plus difficile et qui n’est pas un héros, mais un homme comme les autres. Les mobiles qui poussent les antagonistes sont vrais : le profit, les sentiments racistes de supériorité ; il n’y a qu’à ouvrir un journal ou à tourner un bouton de transistors pour se convaincre que rien n’a changé.
Bien sûr, il s’agit d’un roman, et si Purcell arrive vivant à la fin du livre, c’est bien par la volonté de l’auteur : nous ne sommes pas dupes.
André Portal