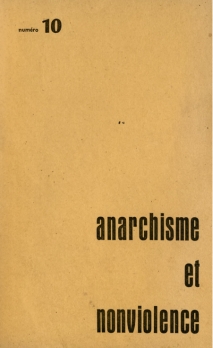Nous n’avons jamais, dans cette revue, publié d’articles sur le Vietnam. Il est pourtant nécessaire que nous définissions une position à ce sujet ; certains d’entre nous l’ont fait déjà. L’intérêt de l’article qui suit est de montrer la différence fondamentale entre les solutions théoriques que nous pouvons élaborer bien en paix, et la réalité du Vietnam en guerre. S’il est écrit par des Américains pour des Américains – d’où ses mises en garde un peu simples : « On ne peut pas parler de Menace rouge » –, il nous concerne cependant ; honnêtement, je ne peux pas rejeter ses conclusions sans en proposer d’autres.
Extrait d’un livre qui vient de paraître aux États-Unis, « The other side » (publ. by the New American Library, Viet Report, 133 West 72nd Street, New York, N.Y. 10023), il a été publié par l’excellente revue « Viet report ». Staughton Lynd est professeur d’histoire des États-Unis à l’Université de Yale et Thomas Hayden est l’ancien président de « Students for a Democratic Society ». Tous deux sont allés en Chine et au Vietnam au début de 1966, et y ont rencontré des « leaders révolutionnaires ». C’est sur cette expérience qu’est fondé leur ouvrage.
Marie Martin
Les Vietnamiens que nous avons rencontrés semblaient les gens les plus doux que nous ayons connus. Leur guerre comporte deux caractéristiques généralement associées à la non-violence : ils cherchent à construire une nouvelle société en même temps qu’ils combattent ; et cette société à venir inclut leurs antagonistes actuels (Vietnamiens et Américains) comme des partenaires, des frères. La guerre de guérilla, nous l’avons ressenti là-bas, a renforcé les traditions de communauté et de démocratie qui sont enracinées dans l’histoire du Vietnam. Néanmoins, ils trouvent le « pacifisme » et la « liberté » occidentale des notions difficiles à comprendre. Nos hôtes du Vietnam parlent de démocratie tout en critiquant les « éléments obstinés » et les « intellectuels socialistes dans la forme, mais capitalistes dans le contenu ». Ils ne pouvaient pas comprendre comment on peut refuser de combattre, car ils sont convaincus de faire une révolution juste et populaire qui les défend contre l’agression américaine.
Nous partageons leur conviction. Et, en conséquence, le problème que nous posons synthétise nos propres sentiments sur la non-violence et les libertés civiles, et notre expérience au Vietnam. Est-il possible de soutenir à la fois la non-violence et la révolution anticoloniale, les libertés civiles pour tous et le renversement de l’ancien ordre social ?
Révolution ou pureté révolutionnaire
La description occidentale établie de la révolution et des révolutionnaires ne convient pas au Vietnam. Selon elle, le révolutionnaire est un homme qui sacrifie tout le présent en faveur d’un futur abstrait, d’une idéologie, d’une vision totale. Alors meurtre et terreur sont commis au nom d’une justice non encore réalisée ; et les révolutionnaires sont endurcis, étroits d’esprit, féroces, ils manquent de toute décence.
Les révolutionnaires que nous avons rencontrés, y compris les guérilleros, étaient des gens dont le comportement envers le futur naissait de leur comportement dans la vie présente qu’ils menaient et les désirs qui y germaient. Quand ces hommes nous disaient que « malgré le bombardement et la mitraille, la vie se développe dans les zones libérée », que « il n’y a pas de gens vraiment riches ni de gens vraiment pauvres », que « chacun de nous aide l’autre dans la production », nous comprenions le profond enjeu personnel que les gens placent dans la guerre révolutionnaire. Les hommes ne se révoltent pas simplement pour des ambitions utopistes ; ils se révoltent par colère contre les crimes impunis et parce que les semences de la vie qu’ils ont choisie ne peuvent germer dans la société où ils vivent.
Autant il est inadéquat de croire à une diabolique Menace rouge, autant il est inadéquat de penser que la révolution est moralement pure. La vérité d’un tel processus de tâtonnement, englobant tant de milliers d’hommes, est qu’inévitablement des actes destructifs se produiront.
La révolution vietnamienne n’a pas été pure. Des gens innocents ont été tués. Des hommes respectables ont été « purgés ». Des paysans et des fermiers ont subi non seulement les répressions du colonialisme, mais aussi la coercition de leurs camarades pendant la révolution. Cette brutalité peut être expliquée comme une partie nécessaire de la résistance contre un mal plus grand : l’agression et le gouvernement étrangers. Elle peut être expliquée, mais non justifiée, parce que des hommes réels décident de commettre des brutalités, parce que des hommes réels en sont responsables. Si des hommes décident de se rebeller dans un État policier, ils choisissent aussi la forme que prend leur rébellion. Que ces choix soient conditionnés par la situation générale ne change rien au fait que des hommes en délibèrent, souvent dans la tourmente et le conflit, et qu’ils ont la possibilité, confrontés à une décision particulière, de dire non.
Nous devons séparer l’idée d’une authentique force révolutionnaire de la pratique organisationnelle et du caractère moral de révolutionnaires particuliers. Il y a une force révolutionnaire au Vietnam. C’est simplement l’aspiration à sortir de la misère, car les gens y ont réalisé que la misère n’est pas inévitablement leur condition. En dehors de ce que tel sociologue nomme désespoir social, il naît des protestations variées, individuelles ou collectives qui deviennent communes, et finalement une tradition. Cet ensemble d’expériences est nommé « le mouvement », ou « la révolution ». En créant cette tradition de protestation, les gens découvrent ce dont ils ont besoin et quelles étapes ils doivent franchir pour réaliser ces besoins : pétitions, marches, campagnes politiques, désobéissance civile, grèves. Les étudiants abandonnent leurs livres et font de l’action directe. Des organisations se développent pour exprimer divers courants : groupes de travail, associations de paysans, partis, mouvements étudiants. Le peuple apprend quelle est sa propre force et quelle résistance lui est opposée. C’est un petit aspect du processus. II est cependant aussi réel que l’aspect le plus respectable, exprimé dans ces mouvements lorsque les individus se surmontent eux-mêmes, ou que l’on sent soudain la profonde signification émotionnelle de la solidarité et de la communauté. Nous ne pouvons définir la révolution par ses moments les plus intenses ni les plus faibles, mais nous la définirons comme une réalité objective, une force qui étreint les hommes : une force que les hommes peuvent quelque peu façonner, pour le meilleur et pour le pire, mais qu’ils ne peuvent jamais créer ou abattre arbitrairement. Nous suggérons cette définition comme alternative à la révolution jugée soit sur le nombre de corps éventrés, soit sur l’humanisme de sa vision.
En général, nous croyons à l’identification avec le processus révolutionnaire et à la découverte de voies qui le rendent aussi humain que possible. Mais ce ne sont que des mots : aucune formule ne peut prendre la place d’individus qui se battent en personne ni des décisions existentielles que cela comporte. Si nous étions au Vietnam, nous pensons que nous soutiendrions le FNL sans abandonner le droit à la critique et au refus de participer à des actions particulières. Mais cette question est irréelle puisque nous ne sommes pas au Vietnam. Nous trouvons qu’il y a quelque chose d’artificiel dans l’attitude des Américains, des Occidentaux en général, qui condamnent catégoriquement la violence du FNL sans avoir démontré eux-mêmes qu’il existe une alternative ; nous nous sentons presque aussi éloignés de ceux qui soutiennent le Front et tout ce qu’il fait sans comprendre que (comme l’écrivait Frantz Fanon) « personne ne lance une bombe sur une place publique sans un débat de conscience ».
La violence, dernier recours
Dans l’Algérie que décrit Fanon, dans le Vietnam que décrit Burchett, la décision d’utiliser la violence a été prise à contre-cœur, après que d’autres méthodes coûteuses avaient échoué à briser l’étau de la répression. (…)
Selon nous, ce qui distingue la violence vietnamienne de l’américaine n’est pas tant une question de motifs qu’un contexte objectif. Les deux camps emploient la violence, mais cela ne signifie pas que les deux camps soient également violents. En dernière analyse, l’«autre camp » utilise la violence de façon plus discriminatoire ; d’abord, simplement parce qu’il a moins de matériel militaire, et qu’il est plus obligé de se reposer sur des hommes ; ensuite, parce qu’il combat contre son propre peuple pour une cause qui jouit d’un plus grand soutien populaire que la cause soutenue par les États-Unis.
Puisque la solution de la violence est utilisée par le gouvernement américain comme seule possibilité de sa répression « dans l’autre camp », expliquons plus complètement pourquoi nous ne pouvons admettre la condamnation conventionnelle des révolutionnaires vietnamiens comme meurtriers. La violence des guérillas est une réaction contre la violence de la domination coloniale, système qui a continué avec Diem après le départ des Français, sous les auspices américains. Presque tous les canaux d’action politique étaient fermés. En mars 1965, prendre la défense de la paix devenait un crime capital ; cette loi était confirmée en août par des peines de dix à vingt ans de prison, par des exécutions en septembre. En mars 1960, un groupe d’experts réunis par les quakers américains releva âprement que le gouvernement américain clamait que son plus grand engagement militaire avait renforcé la volonté sud-vietnamienne de victoire, « mais cet effet est difficile à démontrer car la junte actuelle dirigée par le général Ky a mis hors-la-loi tous ceux qui discutent même la possibilité d’une solution pacifique, et elle en a fait des traîtres ». Aujourd’hui, le gouvernement Ky refuse de donner au FNL une place dans les élections nationales, ainsi qu’aux communistes et aux neutralistes.
C’est le même schéma, sous une forme extrême, que celui qui apparaît dans notre société quand des ouvriers font une grève violente ou que des Noirs, des minorités se révoltent. Une telle rébellion nous semble excessive ? Ce sont les propriétaires, les magistrats, la police qui la rendent telle en interdisant toute autre possibilité de transformation sociale.
De même que la terreur FNL et celle des États-Unis naissent de différentes haines, de même elles ont des buts différents. Burchett cite une guérilla FNL pour montrer que l’assassinat de magistrats villageois est dirigé uniquement contre des administrateurs particulièrement cruels, et seulement après qu’ils ont été invités à cesser la collaboration avec Saïgon et l’ont refusé.
Une violence sélective
Le FNL réduit et souvent tue des gens qui représentent le gouvernement de Saïgon ou des États-Unis dans les villages ; pour en donner le type, ce sont des catholiques, citadins, beaucoup plus riches que les villageois, nommés par Saïgon plutôt qu’élus par le peuple. Ce ne sont pas d’«innocents civils », mais des partisans salariés dans une guerre. S’ils sont tués, c’est souvent pour gagner la confiance et le soutien des villageois, non pour les réduire au silence par la terreur.
Par ailleurs, le FNL bombarde des restaurants, des hôtels, d’autres quartiers de Saïgon. N’est-ce rien d’autre que de la terreur contre des innocents ? Une fois de plus nous répondrons non ; le FNL prend à son compte le concept américain de « refuser ses sanctuaires » à l’ennemi. C’est cette manière de penser qui a été employée pour justifier les bombardements aériens des populations civiles de tout le Vietnam. Mais les bombardements occasionnels du FNL contre des lieux de réunion américains sont quantitativement différents du pilonnage de villages suspects d’abriter le FNL. La raison fondamentale pour laquelle les atrocités américaines sont plus nombreuses est qu’il leur manque la confiance du peuple. Le FNL vit essentiellement parmi le peuple ; les Américains au Vietnam vivent entourés de barbelés. Le FNL use de la terreur sélective sur le terrain, les Américains – non parce qu’ils sont sadiques mais parce que leur gouvernement est contre-révolutionnaire – font pleuvoir indistinctement la terreur et les bombes. D’un certain point de vue, il faut dire que tout acte de violence est faux ; mais il est aussi important de relever que la balance de la terreur n’est d’aucune manière équilibrée. (…)
Communisme et liberté
Parce que leur société combat entre la vie et la mort, les Nord-Vietnamiens acceptent plus de discipline et de dirigisme que nous ne serions prêts à tolérer dans notre société souple. La guerre du Vietnam est marginale pour nous, primordiale pour eux. Nous avions eu un peu froid dans le dos quand un interlocuteur nord-vietnamien nous avait fait la remarque que certains intellectuels dissidents sont « socialistes dans la forme mais capitalistes dans le contenu» ; nous croyons maintenant que la grande majorité des Nord-Vietnamiens tiennent pour appropriée à leur situation la loi martiale d’une forteresse assiégée, et ne considèrent pas leur gouvernement comme une tyrannie oppressive. Les Américains doivent admettre l’ambiguïté suivante : le gouvernement communiste du Nord-Vietnam met beaucoup de restrictions à la vie de ses citoyens, mais il semble à la majorité de ces citoyens qu’ils vivent dans une société plus libre que sous les Français. Leur premier contact avec les avocats des libertés civiles a été avec ceux qui défendaient des privilèges injustes : colons français, propriétaires fonciers, riches catholiques, américains hypocrites…
Nous protestons contre l’assertion tacite des politiciens américains que, lorsque un pays est « perdu » au communisme, cela l’éloigne de la liberté, et que le pays en question devient qualitativement si différent des sociétés occidentales « libres » que toutes mesures sont justifiées pour éviter une prise de pouvoir communiste. C’est la prémisse qui permet à Johnson et MacNamara, après avoir ordonné le bombardement de femmes et d’enfants, de dormir sur leurs deux oreilles.
St. Lynd, Th. Hayden