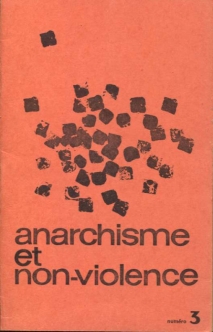Mettre au point des idées cohérentes sur la non-violence théorique, présenter et analyser des expériences pratiques et vécues, donner le point de vue de l’Église par un des siens, voilà bien une gageure difficile à soutenir dans une modeste plaquette de 170 pages. Il ne fallait pas moins de J.Pyronnet, leader incontesté de l’Action civique non violente et compagnon de l’Arche, pour y parvenir. Il est inutile de le présenter, il nous suffira de dire que l’A.C.N.V. sans J. Pyronnet serait autre chose, et, pour nous, anarchistes, autre chose de moins attachant, de moins convaincant.
Dans sa longue préface, l’abbé Louis Rétif passe brièvement en revue l’action passée, et comme il le spécifie lui-même : « C’est à la fois le point de vue de l’homme et le jugement de l’Église que je voudrais apporter. »
Il s’en dégage d’ailleurs que celle-ci, malgré ses références permanentes et tenaces aux Évangiles, n’a pas des idées très claires, ou a des engagements trop complexes et trop profonds dans le monde capitaliste qui étouffent trop souvent les possibilités d’application des thèses évangéliques.
Abordant ensuite le problème de la non-violence et de l’ordre établi, ainsi que celui du droit et du devoir de désobéissance, il adopte, semble-t-il, et malgré toutes les réserves dues à sa fonction, une attitude révolutionnaire, dont, malgré toutes nos préventions, nous devrons tenir compte dans l’avenir.
Concluant enfin sur les rapports entre la non-violence et l’Église, il déclare : « Considérée souvent comme l’une de ces puissances qui gouvernent le monde, l’Église devra, au nom de l’esprit évangélique, se dégager de tout ce qui, dans son mode d’être, est signe de richesse, d’intolérance, d’appuis politiques et économiques, de moyens de propagande et d’influence. »
Comment désavouer de telles affirmations ?
Dès les premiers mots, dès les premières idées développées, J.Pyronnet s’inscrit, lui aussi, comme révolutionnaire : la société est faite pour et par l’individu, pour tous les individus, or un nombre de plus en plus considérable de ceux-ci sont mécontents, mal à l’aise, malheureux, la société est donc mauvaise, ou incomplète, ou anormale. Elle doit donc disparaître. Nous sommes là aussi d’accord, bien sûr. Où nous le sommes moins, c’est lorsque Lanza del Vasto dans le chapitre Action psychologique et non-violence active semble rendre le matérialisme, l’athéisme responsables de l’état de fait actuel.
Il est vrai que la foi, la religion esquivaient bien des problèmes : on faisait le bien par peur, on obéissait par peur, et ainsi de suite ; bien trop souvent la foi ne venait qu’après pour beaucoup de croyants.
Aujourd’hui, une partie de ceux qui se sont dégagés de cela en sont conscients, la majorité des hommes a, hélas ! besoin, dans l’actuel et de par son inexpérience, d’un « bâton de soutien » d’une consolation, d’une justification, d’un guide, et combien de fois n’avons-nous pas entendu, comme conclusion d’une discussion sur ces problèmes : « Mais alors si l’on m’enlève aussi ça (la foi), que me restera-t-il ? Autant mourir. »
Matérialistes, athées, nous n’avons pas mis d’autres idées, d’autres mystiques à la place de la religion, mais pour ceux d’entre nous qui sont convaincus et sereins dans leurs conceptions, celles-là ne sont pas nécessaires, elles sont même inutiles, seraient néfastes et remettraient, encore une fois, tout en question.
Bien que matérialistes et athées, nous sommes aussi sensibles à la justice, à la beauté, à la vérité, à la bonté ; nous avons remplacé la charité au nom de Dieu par la solidarité au nom du plaisir de donner, de la joie de voir un être humain ou un animal heureux.
Nous ne nous considérons pas comme des êtres imparfaits, incomplets, à qui manquerait la foi, mais comme des êtres heureux sans elle.
Un être normal a‑t-il besoin d’une canne?…
Nous sommes heureux sans foi, sans religion, sans autorité spirituelle, par le simple fait qu’il nous est plus agréable d’être heureux et de voir les autres heureux que d’être malheureux, de faire du mal et d’en jouir.
Après l’introduction de J. Pyronnet viennent des textes choisis sur des faits mal connus : de Lanza del Vasto sur la résistance des professeurs norvégiens au nazisme, de Martin Luther King sur le combat des Noirs américains contre la ségrégation, d’amis anglais, enfin, sur les problèmes atomiques et leur importance capitale dans le combat non violent.
J. Pyronnet fait ensuite le point de deux années d’action non violente en France, allant de la définition du non-violent à une analyse succincte du pouvoir, en passant par l’objection de conscience, la défense civile nationale et la désobéissance civique, brossant un tableau instructif et documenté, à bien des égards, tant pour le profane que pour l’initié.
Une conclusion rapide, enfin, sur le conflit sino-indien et la dégénérescence de la non-violence en Inde depuis sa quasi-officialisation, clôt ce livre qui devrait rester encore longtemps un sujet de méditation, de discussion et d’enrichissement pour tous ceux qui se réclament de la non-violence ou y tendent.
Lucien Grelaud