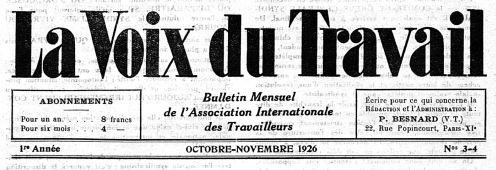La grève générale anglaise, qui se continue par celle de tous les mineurs britanniques, est d’un intérêt essentiel pour le prolétariat français, en particulier et pour le prolétariat mondial, en général.
La classe ouvrière française, les syndicalistes révolutionnaires doivent, d’une façon plus particulière, en examiner les causes, le déroulement, en étudier les phases diverses, déterminer les rôles de chacun des participants directs et indirects et, enfin, en dégager les leçons que comporte l’expérience.
Disons tout de suite que ce conflit fut le plus formidable qu’ait connu l’Angleterre. Par son caractère, par les problèmes qu’il posait, il mérite d’être considéré comme la bataille de classes la plus importante qui se soit déroulée jusqu’à ce jour.
Quelle est l’origine de ce conflit sans précédent par l’importance des effectifs engagés et l’enjeu de la lutte ?
Les mineurs revendiquaient le maintien des 7 heures dans les mines, la réorganisation de celles-ci et une augmentation de salaires correspondant au coût de la vie. Les propriétaires des charbonnages refusèrent nettement de donner satisfaction à de telles revendications. Le gouvernement soutint le patronat et, d’accord avec lui, prétendit imposer la journée de 8 heures et une diminution de salaires.
L’opposition entre les deux points de vue était totale. La crise traversée par l’industrie minière, vue sous ces angles nettement opposés, rendait la lutte inévitable entre les forces ouvrières d’une part, les forces patronales et gouvernementales d’autre part.
Il convient de remarquer que seuls les mineurs posaient la question essentielle de la réorganisation des mines qui, suivant eux, ne pouvait être solutionnée que par la nationalisation.
Il convient de bien poser la question, de la rendre compréhensible à tous nos camarades. Voici comment elle se présentait, à l’origine du conflit :
1° L’industrie minière britannique, qui joint à la tradition anglaise générale le mépris du progrès, continuait à travailler avec un outillage désuet, périmé. Les frais d’exploitation des entreprises étaient, à ce moment, tels que, pour garantir les dividendes aux actionnaires, le gouvernement devait attribuer de larges subventions aux sociétés minières, auxquelles les concurrents étrangers enlevaient les débouchés mondiaux, en livrant à meilleur compte sur toutes les places du globe.
2° Le gouvernement, devant l’énormité des sommes ainsi dépensées, déclara, sous la pression des autres industries qui n’étaient pas soutenues par l’État, ne plus pouvoir continuer à aider les exploitants des mines. D’autre part, étendre aux autres industries ces subventions, c’était s’engager dans la voie de la nationalisation généralisée, c’était s’acheminer, à brève échéance, vers la socialisation, c’était, en somme, poser lui-même la question de régime. On comprend aisément que le gouvernement anglais n’ait pas voulu s’engager plus avant dans cette voie.
3° Les mineurs, de leur côté, prenant le problème dans son entier, déclaraient avec juste raison qu’ils ne pouvaient accepter des conditions de travail. et de rémunération inférieures à celles qu’ils avaient à ce moment. Ils ajoutaient même que les secondes étaient insuffisantes et qu’il convenait de les relever.
Ils affirmaient que la mauvaise gestion actuelle des mines n’était pas leur fait et, fixant les responsabilités, ils n’hésitèrent pas à en démontrer les causes exactes. Ils concluaient fort justement en demandant une réorganisation complète de l’industrie minière, au triple point de l’outillage, de l’exploitation et de la gestion, qui ne pouvait trouver son expression que par la nationalisation de ces richesses collectives. Ils rappelaient aussi qu’aux temps de la splendeur des dividendes élevés et faciles, jamais les propriétaires des grands charbonnages ne proposèrent à l’État et aux ouvriers de partager les bénéfices et qu’il était logique, en conséquence, que les sacrifices nécessaires fussent faits par ceux-là mêmes qui avaient encaissé les bénéfices. St tel n’est pas le point de vue patronal, il convient, disaient-ils, de nationaliser les mines immédiatement.
On voit, maintenant, quels étaient les différents points de vue en présence. Ils étaient et ils demeurent irréductibles. Seule, la force tranchera momentanément le conflit et celui-ci se reposera, sous peu, avec une force accrue, posant avec lui, à chaque, fois et jusqu’à sa seule solution logique, la question de régime en Angleterre.
Des pourparlers interminables et sans conclusion possible s’engagèrent entre les parties. Le gouvernement tentant, pour la forme, de jouer un rôle de médiateur. L’impossibilité de concilier des thèses aussi opposées, des intérêts aussi divergents dut, en dépit de toute la diplomatie des leaders « labouristes », apparaître, malgré tout, et le conflit éclata,. avec une violence extrême.
Au préalable, les mineurs, utilisant le temps, comme leurs adversaires d’ailleurs, avaient conclu une grande alliance avec les cheminots, malgré Thomas, avec les dockers et les autres organisations de transport. Le Congrès des Trade-Unions dut lui-même envisager la nécessite d’une lutte générale et son Conseil général fut forcé de la préparer. Bientôt, sous la poussée des événements, cette lutte devint inévitable et le Conseil général dut lancer l’ordre de grève générale.
Il convient de dire tout de suite que les leaders trade-unionistes et parlementaires — qui sont en grande partie les mêmes — les Thomas, les Bromley, les Ben Tillett, les Mac Donald, les Clynes, etc., n’acceptèrent la bataille que contraints et forcés. Ils ne s’y engagèrent qu’avec l’espoir d’y mettre fin au plus tôt. Toute leur diplomatie, toute leur activité ne s’exercèrent que dans ce sens. Ils ne se préoccupèrent nullement de gagner la bataille dont ils avaient dû donner l’ordre. Son succès possible les glaçait de peur. Ils ne visaient qu’à établir un « compromis » leur permettant à là fois d’affirmer leur attachement à la Couronne et de conserver leur prestige auprès des masses qu’ils voulaient continuer à tromper.
En particulier, Thomas et Mac Donald, ministres d’hier et de demain — Anglais cent pour cent et non militants ouvriers — ne perdirent jamais contact avec Baldwin et les propriétaires miniers.
Et ces hommes, qui avaient en mains un mouvement gréviste unanime, qui disposaient de 5 millions de combattants décidés à vaincre, ces hommes qui tenaient aussi entre leurs mains à merci, le sort du gouvernement anglais et du régime, capitulèrent brusquement, sans lutte, en rase campagne, sur les assurances (?!),d’un personnage louche et semi-officiel, Sir Herbert Samuel, qui faisait de vagues promesses, que Baldwin, victorieux, reniait le lendemain.
C’est ainsi que l’ordre de cessation de la grève générale fut lancé à tout le prolétariat anglais, qui ne pouvait en croire ni ses yeux ni ses oreilles.
Jamais trahison ne fut plus évidente, plus nette, plus ignominieuse. Le Conseil général des Trade-Unions venait de livrer, comme un troupeau de bétail, 5 millions d’ouvriers qui ne demandaient qu’a se battre et qui devaient, en fin de compte, triompher.
Les cheminots, les dockers, les ouvriers des transports, durent accepter des conditions abominables des renvois nombreux furent opérés ; tous ces ouvriers qui avaient usé du droit imprescriptible de refuser leurs bras pour un salaire insuffisant, pour des conditions de travail inhumaines, durent, eux, qui avaient eu la victoire en mains, faire leur « mea culpa », déclarer qu’ils avaient « fauté », permettant ainsi aux patrons de réclamer des dommages-intérêts importants qui pourraient, si les patrons le voulaient, mettre en péril jusqu’à l’existence des organisations ouvrières.
Les mineurs continuèrent seuls la lutte. Elle dure encore aujourd’hui. Quelles en seront et l’issue et les conséquences immédiates et lointaines ? Nul ne le sait.
* * * *
Voici, brièvement exposés, les causes, le déroulement, les responsabilités, la conclusion de la grève générale anglaise qui fit trembler M. Stanley Baldwin et hurler de rage les « Die-Hards » : les Churchill, les Birkenhead et les Hicks.
Aux côtés des défaillants anglais, il en est d’autres dont le rôle ne fut pas celui d’hommes chargés de conduire et de coordonner l’action du prolétariat international.
Je veux parler, en premier lieu, des dirigeants de la Fédération Internationale Syndicale et plus particulièrement des militants de l’Internationale minière et de celle des Transports.
Que fallait-il pour que les mineurs, et, avec eux, tous les grévistes anglais, obtiennent satisfaction ? Qu’il ne rentre pas un kilo de charbon en Grande-Bretagne !
Qu’on ne dise pas que la chose était impossible. Par les éléments qui la composent, l’Internationale Syndicale d’Amsterdam, qui compte dans ses rangs les mineurs allemands, belges, une partie des français, pouvait, sans la trahison de Frank Hodges et du bureau de l’Internationale Minière, obtenir ce résultat, surtout si l’on considère qu’elle disposait également des transports allemands, belges et d’une partie de ceux de la Hollande et de la France. De même, les dockers d’Allemagne, de Belgique, de France et de Hollande pouvaient l’aider à. rendre efficace le blocus de l’Angleterre.
J’ajoute, pour être précis et complet, que si les forces d’Amsterdam — mieux placées pour des raisons géographiques et de fait — avaient été appelées à l’action, celles des Internationales de Moscou et de Berlin auraient rendu total le blocus des Îles Britanniques.
Mais la Fédération Internationale d’Amsterdam semble s’être donné comme objectif de sauver la bourgeoisie et non de libérer le prolétariat. Peut-être aussi a‑t-elle eu peur d’être débordée ? Peut-être a‑t-elle craint de voir le mouvement déborder le cadre anglais et s’étendre à une partie du continent européen ? Tout cela est possible.
En apparence, l’Internationale Syndicale Rouge fit meilleure figure. Elle secourut largement les grévistes en général ; elle le continue vis-à-vis des mineurs. C’est bien, assurément, mais n’eût-il pas été mieux d’engager ses forces, de tenter d’entrainer le reste ? Et puis, qui oserait soutenir que ce secours donné aux mineurs est désintéressé, qu’il ne vise pas à permettre au « Minority Movement » de mettre la main sur la Fédération des mineurs anglais, sur les Trade-Unions tout entières pour utiliser cette force d’une façon particulière qui n’a certainement rien de commun avec les buts que poursuivent les mineurs britanniques ?
J’ose pourtant croire que ceux-ci, rendus clairvoyants par les événements qu’ils vivent en ce moment, sauront comprendre que le salut ne peut leur venir de ce côté, qu’il est en eux, rien qu’en eux.
* * * *
Une grande leçon se dégage de la grève générale anglaise. C’est celle-ci : Les ouvriers doivent faire leurs affaires eux-mêmes ; le mouvement syndical doit être totalement indépendant du mouvement politique et lui seul doit diriger l’action du prolétariat en lutte.
Les politiciens, qui ont toujours, et quels qu’ils soient, un pied dans les deux camps ennemis, ne peuvent être à la fois à la tête des mouvements politique et économique et les servir également. L’opposition fondamentale de ces deux mouvements les obligent à choisir et les ouvriers ne doivent pas tolérer à leur tête des députés, des anciens ministres, des ministrables, qui ne visent qu’à les trahir ou’ à les asservir.
La politique dans le syndicat, c’est le ver dans le fruit.
Les syndicalistes français, dans les circonstances présentes, doivent surtout tirer cet enseignement de la grève anglaise.
Jamais plus qu’aujourd’hui, l’indépendance et l’autonomie — les deux et non la dernière seulement — doivent être affirmées, défendues et sauvegardées dans la mesure où cela reste possible.
D’autres expériences viendront malheureusement confirmer celle-ci. Et celles-là viendront plus sûrement du côté communiste que du côté réformiste. Elles prouveront le caractère néfaste de l’action des partis et la nécessité pour les syndicats de se libérer.
Lorsque ce sera chose faite, les ouvriers désabusés comprendront l’impossibilité de leur affranchissement par les partis et les gouvernements. Le moment du syndicalisme sera venu.
Œuvrons pour que ce soit le plus rapidement possible et tentons d’éviter au prolétariat, si nous le pouvons, les déboires que les politiciens lui préparent.
Pierre Besnard.