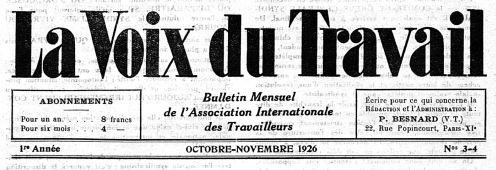La crise sans précédent que traverse la France depuis la guerre est bien près d’atteindre son maximum d’intensité. Huit ministres des Finances se sont succédés au cours des deux dernières années, sans apporter la moindre solution à une situation absolument désespérée.
Les doctrines et les hommes qui les représentent se sont affrontés au Parlement sans aucun succès et il ne semble pas que la crise approche de sou terme pour cela. Bien au contraire. Les récents débats qui viennent de se terminer à la Chambre, qui virent le gouvernement triompher avec une majorité précaire de 22 voix, ont fait ressortir plus que jamais la gravité de la situation financière, monétaire, économique, politique et sociale.
Il fallait, affirmaient les augures, placer le débat au-dessus de la politique, lui trouver une solution technique et nationale a la fois. C’est pour cela que le gouvernement constitua un Comité d’experts financiers.
Après un mois d’efforts, ce Comité déposa un rapport, un plan complet, dont M. Caillaux adopta les conclusions générales, se réservant, disait-il, d’y apporter quelques, modifications de détail.
En principe, un tel plan eut dû rencontrer l’adhésion générale. Or, que vîmes-nous ? Ceux-là mêmes qui auraient dû l’accepter, c’est-à-dire la droite, le centre-droit, le rejetèrent d’accord en cela avec les socialistes, les communistes et certains radicaux. En somme, on peut dire que le plan des experts basé sur la ratification des accords Mellon-Béranger et les ouvertures de crédit extérieurs ne tient plus. Et, malgré son succès à Londres — qui doit nous coûter cher — Caillaux ne pourra plus faire triompher ce plan technique (?!) auquel il se raccroche.
Quoi qu’il en soit, le problème est aujourd’hui posé dans toute sa netteté. On sait enfin que c’est de stabilisation du franc qu’il s’agit. On considère que cette opération est essentielle, que de son succès dépend la solution de toute la crise, le rééquilibre de l’État, du Commerce, de l’Industrie, de toutes les entreprises privées.
À priori, personne ne peut être contre la stabilisation. Là n’est pas la question. Le tout est de savoir si la stabilisation est possible et comment. Et c’est une autre affaire. Je ne décomposerai pas les phases de la stabilisation : pré-stabilisation, stabilisation de fait, stabilisation légale. La première condition de réussite, avant la pré-stabilisation, c’est d’arrêter la chute du franc. Le reste ne pourra être envisagé que si cette baisse continue de la devise peut être arrêtée, freinée définitivement. Le reste du problème ne doit être examiné qu’en cas de succès.
Voyons si cela est possible et à quelles conditions.
* * * *
À mon point,de vue les conditions essentielles d’une stabilisation réelle sont les suivantes :
1° Un budget en équilibré et comprenant toutes les, dépenses de l’exercice ;
2° Une balance commerciale favorable ;
3° Une masse de manœuvre suffisante ;
4° Un gouvernement complètement maitre de son action.
Ce ne sont, bien entendu, que des conditions indispensables. Il y en a d’autres, moins importantes, mais non négligeables.
Cependant, pour la clarté de ma démonstration, je m’en tiendrai à celles que j’énumère ci-dessus, Je les considère, d’ailleurs, comme « sine qua non ».
Examinons, maintenant, les points ci-dessus.
1° Un budget en équilibré et comprenant toutes les, dépenses de l’exercice — Le budget n’est en équilibre que sur le papier. C’est en 1925 que le chiffre des dépenses et des recettes a été arrêté, alors que le cours de la livre était aux environs de 100 francs. La ratification du budget en avril 1926 ne peut changer ces évaluations. Elle ne saurait modifier le chiffre des dépenses reconnues nécessaires à cette époque. Elles sont donc, ces dépenses, immuables. C’est de 37 milliards à 100 francs la livre que l’État avait besoin. Il convient, pour qu’il y ait équilibre, que le gouvernement dispose d’une somme représentant la même puissance d’achat que ces 37 milliards de francs papier à 100 francs pour une livre. Personne ne peut donc contester que si les dépenses sont restées invariables dans leur évaluation-or, les recettes, qui se produisent, elles, au cours du change ont considérablement varié.
Quelle que soit la parité économique de la livre, qui est certainement supérieure au change, il est cependant certain que l’écart des prix intérieurs et des prix mondiaux diminue chaque jour. Chiffrons cette parité à 150 francs, sans tenir compte des cours actuels de 190 et 195, afin de ne pas pousser le tableau au noir.
Immédiatement, un point très grave se pose :
De deux choses l’une : ou les 37 milliards de recettes à 150 francs la livre ne peuvent couvrir les dépenses à 100 francs la livre, ou il faut réduire les dépenses dans la mesure même du déficit constaté. C’est la première condition.
Dans les deux cas, les deux opérations suivantes s’imposent :
1° Pour couvrir 37 milliards de dépenses à 100 fr. pour une livre, il faudra, au cours de 150 francs la livre 37 x 150 : 100 = 55 milliards 500 millions de recettes. On peut donc dire que le budget présente un déficit théorique de 55,5 — 37 = 18 milliards 500 millions. Admettons, pratiquement, que les recettes effectuées à des taux inférieurs à 150, mais toujours supérieurs à 100, aient réduit ce déficit de 5 milliards — chiffre fort — on est obligé de conclure que, pratiquement, réellement, le budget, chiffré à 37 milliards, présente un déficit de 18,5 — 5 = 13 milliards et demi.
2° Si vous acceptez le système de la compression, afin de réduire le déficit, vous devrez réduire vos dépenses d’une somme du même ordre de grandeur, sur le cours de 100 francs la livre bien entendu.
Vous obtenez alors, cette réduction faite, un budget des dépenses de 37 — 13,5 = 23,5 milliards, à 100 francs la livre.
Cette somme de 23,5 milliards représente en fait la véritable puissance d’achat des 37 milliards de recettes envisagées ou rentrées au cours de 150 francs, parité économique intérieure de la livre.
Cette réduction est-elle possible ? C’est ce qu’il faut, sur le champ, examiner.
Le budget comprend :
1° 22 milliards pour le service de la dette intérieure, chiffre invariable qui, au cours de 150 ne représente plus que 22 x 100 : 150 = 14 milliards 666 millions à 100 francs la livre ;
2° 5 milliards pour le budget de la guerre et de la marine, chiffre variable celui-ci que j’accepte cependant de prendre comme tel.
Ces deux postes seuls donnent 20 milliards en chiffres ronds. Il reste donc pour faire face à toutes les autres dépenses de l’État 23,5 — 20 = 3 milliards 500 millions.
Est-ce possible ? Non. Et on doit conclure qu’à peu de chose près les dépenses prévues sont nécessaires et incompressibles.
Maintenant, une deuxième question se pose. Le budget de 1926 contient-il au moins toutes les dépenses de l’exercice ? Voyons cela.
Les dépenses de la dette anglo-américaine : 4 milliards au moins, tous moratoires compris ; les frais de la guerre du Maroc et de l’expédition de Syrie, environ 3 milliards ; les augmentations de salaires des fonctionnaires : 1 milliard, selon M. Caillaux ; soit, ensemble, 8 milliards. Sont-elles comprises dans le budget général ? Non.
Il conviendra de les faire figurer au budget-annexe, dont les recettes envisagées par M. Caillaux seront de 2 milliards, ce qui laissera un déficit réel de 6 milliards.
Récapitulons :
1° Déficit de 13 milliards et demi sur le budget. Général ;
2° Déficit de 6 milliards sur le budget annexe.
Soit un déficit réel de 19 milliards et demi au cours économique de 150 francs la livre.
Ce sont là des choses que le monde financier connaît et que M. Winston Churchill a dites crûment à M. Péret.
La grosse erreur du Parlement fut de n’avoir pas utilisé une mesure fixe d’évaluation pour l’établissement du budget des recettes et de celui des dépenses. Si cette évaluation avait été faite avec cette mesure fixe qu’est, en ce moment, le dollar, devise-or par excellence, nous saurions exactement où nous en sommes et le super-déficit que je signale apparaitrait clairement. Le pouvait-on ? C’est une autre affaire.
2° Une balance commerciale favorable — Malgré toutes les statistiques qu’on veut faire apparaître comme favorables, chacun sait que la balance commerciale des quatre premiers mois de 1926 présente, sur les mois correspondants de 1925, un déficit de 4 milliards, soit un milliard par mois, 12 milliards par an (chiffre très faible).
Il en sera toujours ainsi tant qu’on persistera à évaluer les importations et exportations en francs-papier au lieu de les évaluer en dollars. Comparer des francs-papier au cours de 78, 80 ou 100 en 1925 avec des francs-papier à 130, 150 ou 200 en 1926 est une hérésie. par de tels procédés, on aveugle les ignorants, mais on ne prouve pas —. et loin s’en faut — l’équilibre d’une balance.
3° Une masse de manœuvre suffisante — Pour battre en brèche, avec succès, l’action de la spéculation, de la finance internationale et, aussi, des défenseurs des autres changes avariés, il faut disposer d’une masse de manœuvre capable de résorber tous les francs qui sont à l’étranger. Ces francs constituent l’essentiel de le masse de manœuvre adverse, celle des cambistes étrangers qui, jusqu’alors, grâce à ces francs, n’ont pas engagé un dollar ou une livre de leur avoir propre.
La première chose à fixer, c’est l’importance de cette masse. Elle est, par définition, égale au montant des capitaux français évadés. Or, d’après l’Information du 9 juillet, le montant des évasions est de 30 milliards de francs-or, soit environ 220 milliards de francs-papier. Personne ne peut contester que ces 220 milliards de francs-papier sont de la substance française. Que ce soit en titres, en bons de la Défense, en argent. en billets, en bijoux, en tout ce qu’on voudra, ces 220 milliards sont dehors, réalisables, partiellement ou totalement, à discrétion, par les adversaires du franc, en livres, en dollars, en lires, en florins, en marks et, aussi, en francs, à nouveau, si on le désire.
En face de cette masse énorme de 220 milliards-papier, que peut-on opposer ?
L’encaisse métallique de la Banque de France — 5 milliards-or (dont il convient de déduire, en ce moment, 1 milliard 300 millions-or en garantie en Angleterre), soit 27 milliards-papier environ.
Le moment semble venu, pour moi, de poser la question suivante :
Par quels moyens techniques peut-on, disposant d’une masse de manœuvre de 27 milliards-papier, arrêter l’effort spéculatif et l’offensive continue d’une masse de 220 milliards qui nargue votre action et grignote chaque jour votre propre masse ?
En y adjoignant des crédits américains et anglais, dit-on ? Nous verrons plus tard ce que vaut cet argument.
Peut-on engager l’encaisse métallique de la Banque de France ? Ceci est encore délicat. En principe, non, puisque l’encaisse métallique est la garantie (partielle) des billets en circulation. Et il est fort possible, si on s’engageait dans cette voie, que l’or de la Banque aille rejoindre rapidement les capitaux évadés, dévoré qu’il serait par l’effort des cambistes internationaux.
Pratiquement, il pourrait être engagé, si certaines conditions étaient remplies, si on avait la certitude que le seul fait de mobiliser l’encaisse-or ferait reculer la spéculation et l’offensive adverse. Mais a‑t-en cette certitude ? Non. Il semble, au contraire, que l’expérience aurait pour résultat de vider les coffres de la Banque, comme ce fut le cas, en 1923, pour la Reichsbank.
Pour que la chose devienne possible, il faudrait modifier radicalement les données actuelles du problème. Je ne crois pas qu’on le puisse.
Quant à la rentrée des 220 milliards-papier — des 30 milliards-or — qui pourrait seule permettre de tenter l’opération, j’en parlerai plus loin.
4° Un gouvernement complètement maitre de son action. — Le gouvernement français remplit-il cette condition ? Peut-on dire que, depuis la conférence de Londres et l’application du plan Dawes, mais depuis bien plus longtemps en réalité, le gouvernement est maître de ses actes ?
Pour cela, il faudrait ignorer que les banquiers détiennent directement 25 milliards de bons de la Défense et qu’ensuite, par leurs conseils, par l’influence qu’ils exercent sur leurs clients, ils sont indirectement maîtres de la totalité.
Il faudrait encore ne pas savoir qu’ils disposent aussi, en propre, dans leurs coffres, de 10 milliards de bons à court terme (1 ou 2 Mois, peu à 3 mois), que les 15 milliards de ces bons qui sont en circulation n’échappent pas à leur action ; il faudrait nier que ces banques, qui peuvent ou renouveler ces bons ou les faire rembourser à leur gré, peuvent aussi, le jour qu’elles le voudront, mettre l’État en faillite, si le gouvernement n’exécute pas leurs ordres, tous leurs ordres .
Parler, après cela, de la liberté d’action du gouvernement est, je pense, superflu.
Récapitulons donc maintenant.
Constatons :
1° Que le budget de 1926 présente un déficit réel de 19 milliards ½ (toutes dépense, de l’exercice comprises) au cours économique de 150 francs la livre.
2° Que la balance commerciale sera en déficit de 12 milliards au minimum.
3° Que la masse de manœuvre est insuffisante et peut être dévorée, sans obtenir aucun résultat.
4° Que le gouvernement, financièrement asservi, est prisonnier politiquement des forces d’argent.
Conséquence :
Aucune des conditions essentielles n’étant réunie, la stabilisation réelle est impossible et les coups de frein intermittents, à caractère électorat ou parlementaire, ne peuvent, sur les données actuelles, éviter la chute irrémédiable du franc.
* * * *
Les moyens de renverser un tel état de choses ont été à la portée du Cartel des gauches. Il n’a pas eu le courage de les utiliser. D’autres, si cela est encore possible, les mettront en action.
Il convient, en effet, de faire d’expresses réserves, en raison des faits nouveaux et importants qui viennent de nous être révélés.
En présence .de l’échec retentissant de la tentative de stabilisation belge, il apparaît que la confiance, la fameuse confiance chère à M. Bokanowski, sera insuffisante pour assurer le succès de l’entreprise projetée.
En Belgique, on a constitué le ministère d’Union Nationale que réclame ici la réaction ; on ne fait plus de politique, la commerce de l’argent y est libre, il n’y a ni bordereau de coupons, ni affidavit, et In livre est à 225. C’est la panique, en dépit de tout cela.
Nous devons tenir compte aussi que les Belges, malgré, tous ces éléments de confiance — les mêmes qu’on réclame ici — ne rapatrient pas les devises-or qu’ils ont placées à l’étranger ; qu’ils laissent s’effondrer le franc — qui n’est plus qu’un souvenir ― et que les transactions s’opèrent maintenant en dollars ou en livres à l’intérieur même du pays. Ceci indique que le franc belge est bien mort.
Le moment de parler des fameux crédits qui doivent rendre possible la stabilisation me semble venu.
Les experts et Caillaux avec eux, nous répètent sur tous les tons que, seu1s, des crédits étrangers peuvent permettre de stabiliser le franc.
Une première constatation s’impose. Le fait, pour le gouvernement français, de recourir aux prêts — quelle qu’en soit la forme — des gouvernements et financiers anglais et américains, place le gouvernement français en posture d’infériorité politiquez voisine du vasselage. Il devra ― quoi qu’en disent nos augures — donner des gages, payer de lourds intérêts. Prisonnier de la finance nationale par les bons que celle-ci détient, il abandonnera sa liberté extérieure en empruntant à l’Amérique et à l’Angleterre.
Mais, nous dit-on, le seul fait que l’Angleterre ait fait appel au concours de la Federal Reserve Bank des États-Unis a suffi pour stabiliser la livre et elle n’a même pas eu à utiliser les crédits accordés.
L’argument serait sans réplique si d’autres expériences, plus récentes, ne venaient, nombreuses déjà, infirmer celle de l’Angleterre.
Les Belges, les Italiens, les Polonais ont tenté la même opération. Non seulement le franc belge, la lire italienne et le zloty polonais ne se sont pas stabilisés, mais les crédits sollicités pour leur défense sont dévorés en ce qui concerne la Belgique et la Pologne et sont sur le point de l’être pour l’Italie.
La ruine du franc belge, celle du zloty sont consommées, celle de la lire, en dépit d’un gouvernement fort, disposant des pleins pouvoirs, prescrivant restrictions sur restrictions, se poursuit.. Il n’y a aucun doute qu’elle ne devienne, elle aussi, comme celle du franc français, définitive.
Quelle est la rançon d’une telle opération ?
Les Polonais ont dû céder leurs monopoles, engager leurs entreprises privées ; les Belges ont dit accepter la présence au sein du Conseil des ministres d’un représentant des banques anglaises ; ils ont été obligés de céder 2 milliards d’actions des mines de cuivre du Congo ; demain, ils devront donner leurs chemins de fer en gages, s’ils veulent continuer à être « secourus ». Quant à l’Italie, la « commercialisation » d’une partie de sa dette en a fait le « Portugal » de l’Amérique. Ce n’est pas Mussolini qui commande en Italie, c’est Morgan.
Ceci fait apparaître la stabilisation sous deux jours nouveaux :
Il est devenu, patent que les devises belge et française sont devenues solidaires, que la défense de l’une d’entre elles affaiblit les autres et qu’en conséquence, il n’y a plus de stabilisation possible dans le cadre national.
Seule, une opération d’ordre international peut permettre de ramener au pair les monnaies dépréciées. Il est de plus en plus évident que le succès est subordonné aux conditions suivantes : annulation des dettes extérieures, conversion des dettes intérieures dans chaque pays, adoption d’un étalon monétaire international.
C’est vraisemblablement là. qu’on en arrivera. Mais pas tout de suite.
Toutes les solutions proposées par les experts, le gouvernement, le parti socialiste, les groupes de droite, ne peuvent permettre de stabiliser. Ce ne sont que des solutions partielles, fragmentaires, ou dépassées par les événements et, par conséquent, inapplicables.
J’ai dit plus haut ce que je pensais du plan des experts et du gouvernement, j’ai également exposé que celui de la droite appliqué au maximum en Belgique, en Italie, en Pologne, avec les moyens réclamés ici, ne pouvait donner aucun résultat.
Il me reste à examiner le prélèvement sur le capital qui constitue le plan socialiste. Pour une fois, je suis d’accord avec M. Caillaux pour reconnaître que ne seront « victimes » du prélèvement que ceux qui n’ont pu mettre leur avoir en sûreté. Mais j’y ajoute une autre, deux considérations, plutôt. Ce sont celles-ci :
1° Les artisans, commerçants, industriels, rentiers, qui ne possèderont pas le disponible liquide nécessaire, devront s’adresser à des banques hypothécaires qui leur consentiront des prêts à des taux élevés. On m’a affirmé que tout était prévu pour leur fonctionnement. Que cette opération, étendue à tout le pays, doit permettre à quelques gros banquiers de ramasser. des fortunes colossales ; elle risque de ruiner les malheureux qui devront passer sous les fourches caudines de l’Argent.
2° Pour pouvoir payer le montant du prélèvement qui, à 10%, correspond actuellement à l’ordre de grandeur de 180 à 200 milliards, il faudra une somme énorme de billets qui ne sont pas en circulation, que les Banques devront demander au gouvernement. Et l’émission de ces billets entraînera automatiquement l’inflation qui rendra vaine toute tentative de stabilisation.
M. Caillaux a donc, sur ce point, raison lorsqu’il dit que le plan socialiste « sue l’inflation » — comme celui des experts d’ailleurs — et que ce seront toujours les mêmes qui paieront. C’est l’évidence même. Pratiqué en 1920⁄21, le prélèvement — que les capitalistes auraient presque tous accepté à cette époque — était susceptible de donner des résultats. Aujourd’hui, il est trop tard. L’heure de son application est passée, même si le consentement de tous était acquis, ce qui n’est pas. Qu’on ne parle pas non plus du prélèvement par tranches, il est sans efficacité. Il serait dévoré au fur et à mesure.
Quant à la solution communiste qui s’exprime ainsi : Contrôle des banques, monopole du commerce extérieur, contrôle ouvrier, elle est exclusivement d’ordre post-révolutionnaire. Elle n’a pas sa place dans un débat institué sur le plan capitaliste, puisque sa réalisation suppose que cet ordre est disparu. C’est, concurremment avec la nôtre, après l’accomplissement de la révolution, qu’il conviendrait de l’examiner. Mais, à ce moment, le problème de poserait-il ? J’en doute ! En tout cas, ce ne serait pas de la même façon.
* * * *
Cependant, avons-nous épuisé toutes les solutions capitalistes ? N’y en a‑t-il pas d’autres ? Si, il y en a une, extrêmement redoutable, la voici :
La combinaison capitaliste est en chantier depuis près d’un an et demi. Elle est sortie de conférences répétées auxquelles participèrent, soit ensemble, soit à tour de rôle, les personnages suivants : MM. Montagu Norman, gouverneur de la Banque d’Angleterre ; Benjamin Strong, directeur de la Federal Reserve Bank des États-Unis ; Hautrain, directeur de la Banque Nationale de Belgique ; Schacht, directeur de la Reichsbank, qui sont désireux de s’adjoindre au plus tôt M. Moreau, gouverneur de la Banque de France, après que celle-ci sera devenue entièrement libre de la tutelle du gouvernement. Ces conférences se poursuivent en ce moment à Antibes, ou ces Messieurs « se reposent » et attendent un appel qu’ils savent prochain. M. Gilbert Parker, agent général des paiements du plan Dawes, prépare l’élargissement et les modalités du nouveau plan pour l’Europe, cependant que M. Mellon, secrétaire américain du Trésor et troisième fortune des États-Unis s’embarque pour mettre le sceau à l’affaire.
Quel est le plan de tous ces financiers ?
Bien qu’ils soient convaincus que la stabilisation partielle est une impossibilité, ils sont décidés à en laisser tenter l’expérience… nécessaire pour eux. Après l’échec, les États « cobayes » seront ruinés. Leur industrie, leur commerce seront voisins de la faillite ; les valeurs, l’or, les actions, seront, à titre de gages, passés entre les mains des banquiers anglo-américains, malgré la défense d’une partie de la finance nationale qui sera attelée, elle aussi, aux chars des vainqueurs ou ruinée, si elle résiste contre toute évidence.
Les financiers de la Cité et ceux de Wall Street auront tout raflé pour un morceau de pain, en laissant s’accomplir, simplement, une bêtise dont ils ont, par avance, prévu la conséquence.
Lorsque tout l’actif réel des pays « en mal de stabilisation » sera passé dans leurs portefeuilles, ils jugeront alors qu’il est temps de stabiliser. Ils iront plus loin, ils revaloriseront ce qu’ils auront déprécié jusqu’à zéro ; ils reviendront aux transactions or, à la monnaie or.
C’est alors qu’entrera en fonction leur système, préalablement mis au point. Ce système aura la forme de Consortium bancaire. Il disposera de l’ensemble des ressources de tous les pays, puisqu’il sera composé de toutes les banques nationales d’émission et d’escompte citées plus haut.
Il sera divisé en deux grandes branches tentaculaires. L’une, américaine, aura son siège à New-York. Elle aura sous sa dépendance toutes les banques d’Amérique (Nord et Sud) ; l’autre, européenne, aura son siège à Londres et toutes les banques du vieux continent seront sous sa direction.
L’ensemble du système permettra au Consortium, qui disposera de toutes les ressources du mode, d’exercer l’hégémonie universelle. Les grands capitaines d’industrie seront ses contremaitres, les gouvernants leurs fondés de pouvoir très surveillés, et le fascisme sa doctrine internationale de gouvernement. Oh peut être certain qu’à ce moment-là, le problème des dettes, de la stabilisation, de la revalorisation sera rapidement résolu. Ce sera la colonisation de l’Europe et l’asservissement des travailleurs par la haute banque américaine qui ne manquera pas, à l’heure choisie par elle, de se débarrasser de sa rivale anglaise essoufflée, succombant sous les crises de son industrie.
Et qu’on ne me parle pas de la résistance des partis, des Parlements, pour briser une telle offensive. Les financiers auront tôt fait d’envoyer à la niche ces « aboyeurs » qui ne peuvent mordre. D’une chiquenaude, ils renverseront les fragiles « barrages » que pourraient tenter de dresser ces « velléitaires » qui ne peuvent se résoudre à passer aux actes.
* * * *
Une seule chance de succès subsiste : la révolution sociale profonde, entrainant dans une lutte sans merci les peuples des trois grands pays de l’Europe : l’Allemagne, la France et la Russie, qui sont l’épine dorsale, l’armature de l’Europe, et qui disposent des ressources et des moyens de faire vivre la Révolution et de l’étendre au reste de l’Europe tributaire de ces pays. Si cette éventualité, cette possibilité devenait une réalité, c’est le monde entier qui se dresserait contre l’Argent et l’abattrait.
Mais ceci est autre chose. Une telle œuvre ne peut être accomplie par aucun parti politique. Seul, le prolétariat, qui dispose de toutes les forces de destruction et de construction, peut, en conjuguant les efforts de ces forces sur tous les terrains, assurer le succès d’une telle entreprise par la défense de la révolution, l’organisation de la production, des échanges et de la consommation.
Valois prouve qu’il l’a compris, tout comme Mussolini, lorsqu’il tente d’adapter à ses fins, à ses buts, la doctrine du syndicalisme révolutionnaire. Ceci ne nous échappe pas non plus.
En définitive, c’est entre le fascisme, doctrine sociale de l’argent, et le syndicalisme, doctrine sociale du travail, que la bataille se livrera. Et la stabilisation n’est, en somme, qu’une phase de cette lutte déjà engagée.
Pierre Besnard.
N.B. — Cette .étude a été écrite avant la chute du cabinet Briand-Caillaux. Cet événement ne modifie d’ailleurs en rien mes conclusions. Le plan capitaliste, dont j’expose les caractéristiques essentielles, est le seul qui soit applicable dans la société présente. Toutes les expériences que feront les démocrates et les socialistes associés ne pourront que précipiter, par la chute du franc, l’application du plan des financiers.
Je le répète, c’est entre ces derniers et nous que se jouera le sort de la bataille : Ou eux ou nous, mais pas d’autres
P.B.