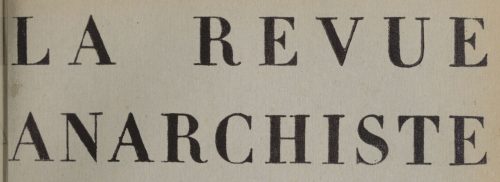1Voir le N°1 de la Revue Anarchiste : « Le XXe siècle contre l’individu »
Que penseriez-vous d’un homme qui, désireux de pratiquer la nage, se jetterait simplement à l’eau, sans étude et sans technique, prétendant découvrir comme par inspiration ou par don naturel, ces rythmes simples et logiques qui permettent à un corps de flotter et de se déplacer sur l’eau ? …
Pourtant, la plupart de ceux qui prétendent réaliser dans leur vie intérieure et dans leur vie apparente la dignité d’être un individu, semblent trop souvent croire qu’il ne s’agit là que d’un simple acte de foi, de volonté, et négligent le rude et décourageant entraînement mental qui permet à un apprenti individualiste de s’affranchir des contingences évitables.
Une illusion commune aux esprits les plus libres, les plus loyaux envers eux-mêmes, c’est de s’imaginer qu’ils affirment beaucoup mieux et plus nettement leur individualité, ses libres choix, ses libres déterminations, quand ils projettent leur désir, leur amour, leur semence, que lorsqu’ils pèsent, jugent et s’efforcent d’assimiler des froides et désespérantes notions que je leur propose comme filtres et tamis de leurs actes. Ils admettent, confusément ou après étude, que d’inflexibles lois restreignent, dans le milieu physique, dans le milieu mental, dans le milieu social, l’affirmation et l’expansion de l’individu. Et cette pénible vérité, pour ceux qui ont su l’incorporer, devient finalement une force. Une force, puisque, si elle appauvrit leur champ d’action, elle le dépouille, elle le dénude de ces illusions et prestiges, de ces mensonges dans lesquels les apprentis-individus s’avancent trop complaisamment, tels les héros légendaires du Tasse à travers les enchantements d’Alcine.
Un individualiste, je ne saurais trop le répéter dans ces notes didactiques — un individualiste n’est pas un être qui s’imagine « être individuel », individu, parce qu’il le souhaite et qu’il le croit, parce qu’il a prononcé les voeux d’individu comme on prononce ceux de moine. Celui-là est un faible et un velléitaire, qui a simplement changé de troupeau.
Un individualiste est, d’abord, un patient, laborieux, objectif et impitoyable esprit, qui, après avoir analysé, comme un chimiste dans son laboratoire, tout ce qui peut limiter, restreindre et nier les tendances d’un être vers l’individuation, arrive à tirer de ces constatations (désolantes pour un esprit passif, logiques et naturelles pour un esprit qui veut réaliser l’homme) un ensemble de règles qui lui permettent de se faire sa loi, son unité mentale et pragmatique.
Ceux qui dirigent les sociétés humaines l’ont si bien compris dans leur maligne et retorse prévoyance, qu’ils laissent volontiers les philosophes ou les savants à leur solde présenter aux apprentis-individus tout un jeu de niaiseries philosophiques, sociologiques, médicales, hygiéniques, économiques, qui satisfont la plupart de ces derniers et les empêchent (au fond, bien contents !) de s’avancer sur la route glaciale qui mène l’être social vers l’individu affranchi…
— O —
Une illusion commune aux esprits les plus nets, c’est d’oublier trop souvent que nous sommes, par destination, des animaux reproducteurs
Dans le milieu physique, certes, ils admettent bien les réalités, les lois, de la masse, de l’espace, de la pesanteur. Dans le milieu mental ils admettent bien que la forme de l’intellect conditionne son contenu, comme celle d’un vase rond ou cubique conditionne la forme du liquide que vous y versez. Dans le milieu social ils savent que la révolte même peut bien insulter des forces ennemies de l’individu, mais non les nier. Avec les stoïciens antiques, ils comprennent que c’est en s’identifiant à tant d’exigences que l’être arrive à conquérir la liberté compatible avec sa nature contingente (« Bian homologoumenôs tê physei » disaient les disciples de Zénon et d’Epictête).
Mais les plus sages croient volontiers que l’amour et son cortège de joies complexes leur permettent d’affirmer der Einige, alors que les états physiques et affectifs de l’amour commencent au contraire par resserrer autour de l’être les mailles inflexibles des instincts.
Dans le recueillement de notre vie intérieure, face à nous-même, nous sommes trop souvent des menteurs inconscients. L’homme que Platon montrait enchaîné dans une caverne, devant un mur sur lequel passaient des ombres, ombres d’êtres qui défilaient, au dehors, devant un grand feu, invisible pour l’homme enchaîné ; ce captif symbolique est notre image, à tous. Dans l’impossibilité où nous sommes de rompre les déterminismes d’airain qui nous tiennent liés, nous nous imaginons volontiers que certains états exceptionnels viennent limer ces chaînes et permettent à l’individu de surgir, libre et titubant, devant la caverne des images…
L’amour, ainsi compris, serait le haschich ou le peyotl de la chair et des fonctions cérébrales.
Soyez sincères et véridiques : en est-il un seul, parmi vous, qui n’ait pas eu cette illusion ?
L’amour, par la psychose qu’il entretient, par l’euphorie accidentelle qu’il crée, semble devoir libérer nos états intérieurs de ce crible inévitable par lequel nous prétendons les faire passer tous.
Ainsi compris et pratiqué, il n’est que la plus grave et la plus captieuse des illusions, le plus grand dissolvant de cette opération de galvanoplastie mentale qui doit recouvrir le moule, l’idée que nous nous faisons de notre individualité possible.
Comme l’a dit Schopenhauer, en effet, c’est justement à ces moments là que le génie de l’espèce nous empoigne par la nuque, et nous courbe, pantelants, pour accomplir une volonté d’être extérieure à nous, dont nous ne sommes que l’accident, que la localisation fugitive.
Si nous admettons, comme définition, que l’individualiste est un être raisonnant qui tente d’acquérir les franchises et la dignité d’individu ; que l’individu est l’être qui parvient à réduire au minimum — en ce qui le concerne — le poids et l’adhérence des contingences physiques, mentales et sociales ; il nous faut, sans hypocrisie et sans illusion, analyser les concepts d’amour et d’espèce, par rapport à l’individu, tel que nous le cherchons en nous et autour de nous.
— O —
L’amour est vraisemblablement le phénomène humain autour duquel ont le plus disserté et batifolé, depuis des millénaires, les chercheurs et les philosophes. Cela ne prouve pas qu’un individu, pris à l’improviste, puisse vous en donner une définition suffisante, analytique. Nous sommes bien baignés dans l’air atmosphérique, de nos premiers à nos derniers jours. Et combien peu d’humains, pourtant connaissent avec exactitude non seulement les composants chimiques de ce milieu vital que nous finissons par oublier, mais encore les dures lois physiques qui règlent sa stabilité et ses mouvements ?
Le sage et subtil Platon, dans son Banquet et dans son Phèdre nous a donné, du processus même de l’amour par rapport à l’individu humain, une analyse ‚à la fois poétique et profonde, et qui, sur bien des points, garde encore toute sa valeur aujourd’hui.
L’amour, dit-il dans le Banquet, est le désir du Beau. C’est un désir de possession, en vue du bonheur.
L’objet de l’amour, poursuit-il, est d’abord la génération, la reproduction de l’individu dans la beauté. C’est la nature mortelle de l’homme qui cherche à se perpétuer, à se rendre immortelle autant qu’il lui est possible.
« Mais, ajoute la mystérieuse Diotime, l’étrangère de « Mantinée », ceux qui sont féconds selon le corps aiment les femmes et se tournent de préférence vers elles, croyant s’assurer, par la procréation, le bonheur de voir se poursuivre leur individualité dans la suite des temps,
« Mais ceux qui sont féconds selon l’esprit cherchent non plus un corps, mais un esprit qu’ils puissent féconder ».
Une fois pénétré de cette pensée socratique, notre homme « doit se montrer l’amant de tous les beaux corps et dépouiller comme une petitesse méprisable toute passion qui se concentrerait sur un seul. »
En d’autres termes Platon affirme que, si l’homme qui distribue la vérité et le savoir le fait pour toutes les consciences qui lui en semblent dignes, sans se croire contraint de ne créer qu’un couple didascalique, il ne peut, dans les actes mêmes de l’amour, avoir d’autre règle d’action.
Car, ajoute-t-il, si quelque chose donne du prix à la vie humaine, ce n’est pas la contemplation des belles femmes ou des beaux jeunes gens, mais la contemplation de la beauté absolue, dont la possession charnelle d’un corps aimé, n’est que l’occasion, le prétexte, le degré physique d’initiation.
Ainsi, à son plus haut période, l’amour, pour Platon, ne serait plus que ce que nous appelons l’esprit de propagande, qui aurait su se libérer, pour féconder une ou des consciences, de l’esclavage de l’espèce, des lois brûlantes de la sexualité.
En d’autres termes encore, pour lui, le sage (que nous appelons, nous, l’individu) jouit de la contemplation et du commerce de la beauté intellectuelle dans un état d’affranchissement que ne lui donnera jamais la contemplation et le commerce de la beauté charnelle. Il ne nie pas, certes, les douceurs du commerce amoureux. Mais il ne les considère que comme une gymnastique préalable d’un corps qui cherche à libérer ce produit floral des corps humains qui est l’individualité.
« Les âmes sont mues, suggère d’autre part Socrate dans le Phèdre, d’abord par le désir de la volupté. Ce désir s’appelle amour lorsqu’il s’attache au plaisir que procure la beauté.
« Mais, ajoute le vieux sage, les amants aiment leur bien-aimé comme le loup aime l’agneau ».
Et cette phrase, en forme de fable, est comme le théorème des droits de l’amour opposés aux droits de l’individu.
Elle pose, en son riche et symbolique raccourci, que l’amour limite la liberté de l’homme, restreint sa personnalité, son effort d’individuation, tant que cet amour ne s’attache pas à ce qui affranchit l’homme, c’est-à-dire à la recherche de la beauté pure.
Or, la beauté est la traduction, par des sens humains, d’une harmonie sensible à l’individu. L’art est essentiellement (c’est un lieu commun des traités d’esthétique) essentiellement individualiste. Leur qualité, leur spécificité individualistes est même ce qui distingue, à l’analyse, une sensation ou une émotion d’art d’une sensation ou d’une émotion ordinaires. C’est par l’art, par l’état d’art que l’homme s’affirme le plus nettement individu, qu’il affirme, au travers du torrent des contingences indissolublement liées, sa volonté de rompre leur enveloppement fatal.
Mais pour arriver à cet état interne d’esthéticisme qui permet à l’homme de se formuler comme individu, il faut une franchise vis-à-vis de soi-même dont les humains sont communément dépourvus. Il faut d’abord savoir s’affranchir de l’état euphorique — commun à l’espèce — que notre corps exige, tout d’abord, dans les impulsions de l’amour et du désir ; c’est pourquoi, de tous les états physiques qui tendent naturellement à dissoudre l’individu en gestation, les actes de l’amour sont les plus dangereux, parce que ce sont ceux pour lesquels il nous est le plus agréable de trouver des excuses.
Certes, sans nier le rôle excellent de ces gestes pour assurer l’équilibre et l’évolution normale de nos organes de sécrétion, l’homme peut s’élever assez haut dans l’affranchissement de son moi individualiste pour en venir à considérer les actes physiques de l’amour avec la même sérénité organique qu’il considère les autres actes résultant des fonctions mêmes de la vie…
La femme, si intelligente puisse-t-elle être, est — d’après les lois mêmes de sa construction organique — plus étroitement assujettie que l’homme à ses organes générateurs.
Trop souvent, des femmes qui se disent « individualistes » ne voient, si elles sont belles, dans l’adoption de leur doctrine que le moyen d’apaiser leurs organes, en donnant à des exigences physiques le prestige et la parure d’une opinion, d’un système ; si elles sont laides, elles se servent de leur doctrine, consciemment ou non, pour donner un corps dogmatique à leur ressentiment et à leur jalousie latente contre la vie et contre le destin.
— O —
Faudra-t-il donc que, découragé, l’homme qui s’efforçait d’échapper à l’oppression autoritaire du milieu social trouve en lui, dans sa chair et dans son esprit, une oppression et une servitude aussi tenaces ? Et comment conserver un équilibre entre les exigences et les illusions des sens, d’une part, et les exigences et résolutions de l’intelligence qui veut, d’autre part, permettre à l’être de réaliser un idéal d’existence individualiste ?
La règle est simple, tout au moins en son principe ne pas se mentir à soi-même.
C’est élémentaire, disiez-vous ?
Non.
Si vous osez, loyalement, fouiller dans votre conscience, vous verrez que, le plus souvent, l’homme se ment à lui-même, et prend les impulsions confuses de ses organes pour les résolutions et décisions claires de son esprit.
Ceux qui ont la manie raisonnante transforment leur inclination en système.
Ce qui est une méthode beaucoup plus facile, beaucoup plus commune qu’on ne le croit. Et combien de révoltés oublient qu’il faut, d’abord être un révolté contre soi-même. Combien oublient qu’il y a une véritable hypocrisie à dénoncer et à flétrir tout ce qu’il y a d’inharmonieux dans la Société, si l’on ne s’est pas efforcé, dans la mesure compatible avec nos forces et notre courage, de réaliser d’abord en nous-mêmes cette harmonie qui doit être l’état normal de tout individualiste.
La sagesse, c’est-à-dire l’ensemble des méthodes qui mettent à l’entraînement l’individu, la sagesse est dans l’art de ne donner à la nature que ce qui est nécessaire à la paix de nos sens et à l’équilibre de notre esprit. Pour celui qui a su choisir sa route, l’espèce ne saurait être plus exigeante et plus importune que la Société et le despotisme des instincts plus pesant que la contrainte sociale.
Ainsi un être à la recherche de son individualité, désireux, comme écrivit Montaigne, de « jouir loyalement de son être », doit oublier, quand il constitue un couple par accord avec un autre être, à la fois d’être mâle, c’est-à-dire maître, et d’être femelle, c’est-à-dire réceptacle, servitude charmée.
Vous avez vu, à l’analyse, que l’individualisme n’était pas seulement un brutal et simpliste acte de foi, une enseigne que le premier imbécile venu pourrait mettre sur sa porte, mais le fruit d’un lent, clairvoyant et impitoyable entraînement.
L’individualiste est celui qui est arrivé à n’avoir jamais peur de sa pensée, et je vous assure que s’il n’est pas un hypocrite intérieur, comme 95 % des hommes, il passera de bien désolants moments, face à face avec lui-même, seulement armé de cette analyse mentale, aiguë et dangereuse comme un bistouri… !
Hors de toutes les hypocrisies organiques qui recouvrent nos actes comme le caractère recouvre nos états affectifs, comme la peau recouvre notre paquet de muscles, de nerfs et de veines, l’amour peut être l’antidote de l’individualité, cet amour qui faisait préférer à un homme de la qualité mentale de Goethe sa gigantesque ânerie catholico-médiévale du second Faust, sur « l’éternel féminin » das erige weibliche…
Mais l’analyse de ces éléments complexes nous entraînerait trop loin, et nous n’entendons, dans ces études sommaires, que rédiger la préface, l’introduction à un traité d’entraînement individualiste.
Notons, en tous cas, que l’individualiste est mis hors de sa voie par l’amour uniquement dans la mesure où il oublie, où il néglige d’aider l’être aimé à se façonner et à s’affirmer comme individu.
Le mot « possession » définit les amours des temps archistes et grégaires. Le mot « émulation » définirait cet accord, cet unisson individualiste entre deux êtres également désireux de voluptés loyales, mais également jaloux de leur liberté mentale et physique, « par delà le Bien et le Mal », comme dirait le Zarathoustra Nietzschéen.
Si nous entendons par individu ce qui s’efforce vers l’unité, vers l’Einigkeit, vers l’indivisibilité (opposée au dividere étymologique) nous lui éviterons sciemment tout ce qui pourrait dissocier cette imité toujours instable.
Puisque l’individualiste, en dernière analyse, est celui qui cherche à créer en lui l’individu au milieu du torrent des contingences, il ne saurait considérer les lois de l’espèce que comme assujetties à sa propre loi, et les pactes de l’amour que comme un moyen de créer un autre individu, qui lui soit librement apparenté.
Ainsi le pauvre, précaire et vagissant amour humain, avec son immuable gymnastique de gestes animaux devient, comme l’amitié socratique, un moyen pour l’être de s’affirmer dans la recherche de ce que les Anciens appelaient la Beauté, de ce que le XIXe siècle appelait la Vérité, de ce que nous appellerons l’homme, c’est-à-dire quelque chose qui n’existe encore, au fond des meilleurs, que comme une tendance — et non comme un fait.
Ganz-Allein
- 1Voir le N°1 de la Revue Anarchiste : « Le XXe siècle contre l’individu »