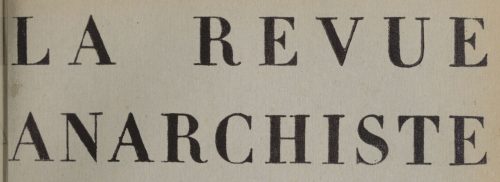— Vous devriez, m’a-t-on dit, écrire pour les femmes, vous qui êtes une femme.
Il y a donc une façon spéciale d’écrire pour les femmes ? Hélas, oui !
On écrit pour les femmes avec une plume dorée, sur du papier azur ou mauve, en un français spécial, sans vigueur et sans consistance, où les mots semblent enduits de brillantine et de pommade rosat.
Et comme écrire, au sens littéraire du mot, ne peut guère être que décrire ou sa pensée ou l’univers, on a un univers et une pensée arrangés, fabriqués, montés comme une féerie, ad usum Delphinœ.
Depuis le pauvre vieux raté du journalisme qui, sous le riant pseudonyme de « Monique de Crèvecœur » ou de « Tante Arsinœ » dispense aux midinettes et aux petites bourgeoises leur pâture intellectuelle dans les colonnes des journaux de mode, jusqu’à l’académicien tout de vert orné qui pond chez l’éditeur favori des douairières, d’aristocratiques romans, tous obéissent aux règles qui, pour n’avoir point été prescrites par Albalat en son docte Art d’Écrire, n’en sont pas moins impérieuses — et respectées.
En cette langue singulière, en ce Parafrançais subtilement déformé, une femme qui a procrée est non seulement une « maman », mais une « petite maman », même si elle a quarante ans passés, un mètre 80 de haut et un soupçon de moustache. Un être humain en bas âge est non seulement un « bébé », mais une « poupée », une « mignonne poupée ».
Un taudis malsain est un « intérieur », et une guenon, une « aimable lectrice ».
Faite de suppressions et de conventions, tacites plutôt que d’affirmations, elle aboutit, cette langue, à créer un surprenant ensemble d’erreurs dans lequel les femmes amies (de par leur éducation millénaire) de l’ignorance et du mensonge, vivent une vie de l’esprit qui est latérale à la vie, à la vie où vivent et se battent la plupart des hommes…
Dans ce monde conventionnel de la littérature féminine, la croyance catholique est implicitement admise, avec un ensemble de postulats sur la « bonne conduite », les « bonnes mœurs », le « bonheur », le « devoir », les principes de l’éducation puérile et honnête, l’organisation politique et sociale de l’État, les relations sexuelles, dont le docteur Toulouse a si justement dit qu’elles étaient la clé de la question sociale, y sont envisagées sous l’angle exclusif du mariage bourgeois et même petit-bourgeois, avec (car il faut tout prévoir en ce bas monde!) une théorie de l’Adultère et de son habituelle punition par Croquemitaine, je veux dire par la Providence.
D’ailleurs, qu’écrit-on d’ordinaire pour les femmes, en dehors des traités techniques consacrés à leurs occupations habituelles, « traités » réduits le plus souvent à des recettes ménagères, et à des conseils de couture, de mode et de puériculture ?
Des romans et des chroniques ; car pour les vers, ils sont quantité négligeable…
Je me garderai d’autant plus de dire du mal des romans, que j’en suis une grande liseuse. Non seulement je les considère comme de fort agréables amusettes, mais encore je ne conteste pas une très grande utilité à ceux d’entre eux (rares!) qui sont dignes de voir le jour.
Seulement, il faut savoir les lire, et, avec eux comme avec les autres sources d’information, il faut un certain degré de culture pour commencer à se cultiver.
Il faut savoir discerner d’abord, assimiler ensuite, ce qui vaut la peine d’être recueilli il faut savoir le retenir intelligemment, et le fondre dans la réserve d’idées générales bien et clairement assises sans lesquelles il n’est pas de vraie pensée.
Et, ce travail de la mémoire et de l’esprit, on voit tout de suite combien il s’accorderait peu avec la lecture et l’analyse de romans « pour dames ».
La femme qui n’aurait guère lu que Zola, Flaubert, Balzac et les romans de Victor Hugo, mais qui en aurait exprimé pour l’embellissement et l’élévation de son esprit tout ce qu’on en peut exprimer, serait en possession d’une belle somme de savoir, et pourrait en tirer une sagesse assez ferme et assez complète pour lui être un guide précieux dans la recherche de soi-même.
Mais c’est précisément parce qu’il ne s’agit pas là de romans pour dames et parce que cette femme n’aurait pas fait œuvre de femme en les lisant, même si ses conclusions étaient dominées, « conditionnées », comme il est normal, par l’idiosyncrasie de son sexe.
Or, nul n’ayant pris soin d’apprendre à lire à la masse des femmes, et elles-mêmes ayant peu de penchant naturel à l’autodictatisme en cette matière, elles sont inévitablement portées à la lecture des romans faits pour elles, c’est-à-dire d’où se trouvent évincés ces éléments utiles dont je viens de parler.
Ai-je besoin d’évoquer l’exaspérante niaiserie de ces monuments « littéraires » où se déverse, sous le couvert de l’analyse psychologiques des états d’âme de Madame de Saint-Machin, ce que Wells appellerait « un plein baquet d’âme féminine frelatée » ?
Ou de ces « œuvrettes » où les pauvres gosses du peuple apprennent qu’une cousette a, dans la vie, deux débouchés à peu près sûrs : épouser un noble jeune homme dont l’auto la heurta un jour qu’elle courait rapporter sa paye à sa vieille mère malade, ou débuter brillamment à l’Opéra après qu’un impresario l’a par hasard entendu fredonner dans la rue ?
Reste la chronique, c’est-à-dire les articles « billet » et « topos » consacrés à peu près dans toute la presse à des rubriques féminines tenues par des femmes : ainsi les « Ingénument » de Blanche Vogt dans l’Intransigeant, les papiers d’Arnolde dans l’Ami du Peuple, les « Pour les Femmes » d’Huguette Godin dans le Quotidien, les « Disques » de Germaine Beaumont dans les Nouvelles Littéraires. D’abord, et quoi que pensent en leur foi intérieur ces « rubriquardes », qui ont du talent, elles sont, bien entendu, les servantes perinde ac cadaver du journal qui les rétribue. Et si leur féminisme s’édulcore de toutes les conventions énumérées plus haut, ces conventions à l’usage du beau sexe ne sont que le reflet des conventions sociales d’ordre plus général dont le respect est prescrit par la ligne politique et commerciale de l’organe où il se manifeste.
Ensuite, ne sont-elles pas, souvent, et plus ou moins inconsciemment, gênées par ce principe que je cherche à combattre ici même, selon lequel une femme doit écrire pour les femmes ?
Qu’elles le fassent, certes, si c’est chez elles un tour d’esprit spontané : mais sinon qu’on nous épargne de pressentir la contrainte et l’absence d’intérêt que fait naître un sujet ingrat. Oblige-t-on une actrice à ne jouer que devant un auditoire de femmes ? Une femme peintre, à ne peindre que des femmes ?
Ces journalistes en jupon (encore une fois celles, du moins, que se trouve ne pas satisfaire entièrement la spécialisation le leur public) tendent à s’échapper en écrivant, indirectement, pour les hommes : en traitant des sujets très féminins tout en guettant du coin de l’œil le lecteur mâle, pour lequel on prend une allure gentiment désinvolte, doucement ironique à l’égard de ses « sœurs » « Voyez-vous, je dis ceci et cela parce que c’est nécessaire, mais notez avec quel secret détachement je le dis, moi qui, n’est-ce pas ? suis si supérieure à tous ces papotages ! »
Elles font bien. Car cette trahison apparente de leur mission est un instinctif retour vers une façon d’écrire plus sage, plus conforme à la raison.
Point n’est besoin d’écrire pour les hommes, pour les femmes, et pour les Auvergnats. Il faut écrire tout simplement. Chaque lecteur saura, selon ses capacités et ses tendances, tirer de l’œuvre les conclusions qui lui conviennent.
On admet que bon nombre des maîtres de la pensée humaine Swift, Molière, de Foë, Cervantes, La Fontaine, etc., ont écrit à la fois pour les enfants et pour les grandes personnes les plus intelligentes, les plus noblement douées. Ce qui n’empêche pas un enfant chez qui déjà se révèle une âme d’homme de les lire en homme, — et une grande personne dont le cerveau demeure en état d’infantilisme, de les lire en enfant.
Ne peut-on faire aux femmes l’honneur — ou rendre aux femmes la justice — de les traiter en enfants ?
Maximilienne.