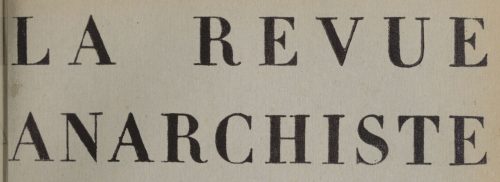On sait comment fut créé le prix Goncourt. Dès la disparition de son frère puîné, Edmond de Goncourt avait commis une lourde faute ; celle de s’acharner à vivre pour démontrer inconsidérément que ce n’était point lui qui détenait le talent de la firme littéraire exploitée en commun.
Depuis ce moment, on avait vu le malheureux, désireux de faire figure malgré tout, s’acharner sous prétexte de Mémoires, à colliger les notes de son blanchisseur, les ragots de son perruquier, les cancans de la gent littéraire, les mots de sa ventouseuse, les puériles anecdotes qui avaient trait à son existence de vieux garçon solennisant les moindres événements de son privé, de sa vie de célibataire égoïste, qui ne peut pas se résigner à n’être plus une vedette sensationnelle.
Il était ainsi un des plus affligeants échantillons du gendelettre contemporain retourné à l’enfance. À l’instar des catins périmées, il ne pouvait consentir à s’effacer, à disparaître. La figure maquillée et rechampie, il faisait la fenêtre, aux heures du soir, pour raccrocher encore le client, c’est-à-dire le lecteur, avec des grimaces séniles et les minauderies de ses fanons pendants.
Pendant dix années, chaque dimanche, il avait réuni dans son somptueux « grenier » d’Auteuil, une basse-cour de littérateurs qui dégustaient, autour de lui, avec des gloussements d’aise, les rogatons et les détritus d’une conversation de fossile inane et prétentieux.
Par testament, il décida la création d’une Académie libre, dite Académie Goncourt, qui devait faire pièce aux coupolards de l’Institut, et perpétuer à travers les âges, sa mémoire auguste de fanfaron littéraire, laquelle sans cette palinodie aurait sombré vertigineusement dans l’oubli.
Aussitôt, Me Raymond Poincaré, alors jeune avocat voué, déjà, à la défense de tous les puffismes sociaux, vint soutenir ledit testament devant les tribunaux. Il débutait brillamment ainsi dans la carrière qui devait le mener à être plus tard un des fauteurs de la guerre et le plus grand faux-monnayeur des temps modernes.
Pareil à une vieille fille asthmatique et onaniste qui, en mourant, laisse tout son bien à ses chats ou à ses serins favoris, Edmond de Goncourt légua donc toute sa fortune à ceux qui avaient assisté sa vieillesse d’une oreille longanime et de caresses intéressées.
Et c’est pourquoi, en ce mois hivernal où la superstition asiatique, connue sous le nom de Christianisme, pousse ses tenants à s’empiffrer de charcuterie en l’honneur de la naissance de Jésus qui émascula l’humanité et la fit choir dans l’hébétude ; alors que sur les trottoirs de la Ville coulent en ruisseaux écumeux les vomissures des poivrots du réveillon ; c’est pourquoi nous assistons, chaque année, à l’ignominieuse et adéquate mystification du prix Goncourt.
L’avenir devait faire justice de ce Décemvirat de ratés plus grotesques encore que les « Quarante ». Au cours de plus d’un quart de siècle, ils furent incapables, à eux dix, d’écrire une seule œuvre viable, de produire un seul roman de valeur. Et ils étaient chargés de décerner le laurier, de découvrir les jeunes talents ! S’estimaient-ils qualifiés par leur seul néant ?
Tout d’abord soumise au caporalisme d’un Lucien Descaves, prototype du médiocre et volatile désailé qui picore sur le fumier naturaliste les vermisseaux oubliés par autrui, cette Académie de caboulot tomba bientôt sous la sujétion d’un Léon Daudet, sycophante du genre persécuté-persécuteur, dont la rage inutile a pour cause profonde son impuissance à répercuter le lyrisme poissard, mais si souvent magnifique d’un Veuillot.
Marchant au doigt et à l’œil, les comparses : les Rosny, qui nous conte filandreusement des histoires à la Jules Verne ou à la Zola dans un style de maître d’hôtel ; les Ajalbert, prébendier officiel et patriotard, dont le talent, hélas ! est en raison inverse du volume de sa graisse ; les Pol Neveux, les Hennique dont les « œuvres », ainsi qu’ils s’expriment pompeusement, sont pour faire regretter à Gutenberg d’avoir si inutilement inventé l’imprimerie ; les Raoul Ponchon qui, pendant un demi-siècle, chanta la soulographie en remplaçant la césure de ses alexandrins par des hoquets : ceux-là et tous les autres déférèrent, tel le gendarme de Nadaud, à l’injonction du « cerveau-chef » et aux intérêts des éditeurs malins qui n’ignorent pas comment on travaille un aéropage.
Comme l’événement l’a prouvé, les Goncourt se sont toujours montrés attentifs à écarter tout tempérament réel, tout écrivain né qui aurait pu leur porter ombrage par la suite.
Les romans couronnés par eux depuis 27 années s’en iront, au regard des temps futurs, rejoindre les vieilles lunes. Et toute cette réclame outrancière faite sur eux par la grande presse, quotidiennement occupée à opérer le public de son entendement comme d’une faculté honteuse et anti-sociale, n’aura servi qu’à démontrer la servilité des littérateurs contemporains qui s’employaient à se monter sur le ventre, tout en se bousculant par l’escalier de service du bistrot où siège, chaque frimaire, ce jury bouffon.
Lesdits Goncourt n’ont-ils pas d’ailleurs, contrevenu aux clauses formelles du testament qui les faisait légataires ? Par cet acte, ils avaient reçu mission impérative de publier le fameux Journal : ce qu’ils ont refusé de faire par pleutrerie intime et crainte des malencontres éventuelles.
Avec beaucoup plus de sagacité, ils se sont contentés de garder l’argent. On peut donc dire qu’ils n’ont aucune existence légale, ni morale, ni légitime d’aucune sorte. Le prix Goncourt, en réalité, n’existe pas. Il n’est qu’une pure supercherie à laquelle se livrent des héritiers infidèles et ingrats, lesquels dans leur cénacle ne cessent de se reprocher réciproquement leurs tares, et menacent parfois, au cours du fameux déjeuner, de se jeter les assiettes à la tête, comme le prouve le livre écrit par l’un d’entre eux, dont la bouffissure du « Moi » égale celle de son ventre.
Mais objectera-t-on, comment la critique indépendante ne réagit-elle pas ? La critique indépendante, ne savez-vous donc point d’où elle sort ?
Il y a une quinzaine d’années, un milliardaire américain, jaloux d’imiter son compatriote Carnegie dans les fondations dites « philanthropiques », créa, à Paris, une institution remarquable. Voulez-vous savoir son nom ? Elle s’intitule : École de rééducation professionnelle des ratés littéraires.
De même qu’on rééduque les aveugles et autres mutilés de guerre, tous les écrivains ratés, tous ceux qui se sont montrés incapables d’écrire un roman faisant paraître quelque forme ou idées personnelles, suivent ces cours doctes et avisés.
Au bout de trente six mois d’études appropriées, grâce aux leçons des maîtres qui leur enseignent, avec leur grande expérience, la soumission aux intérêts des gros éditeurs comme aux vérités premières ; qui leur apprennent à lécher les hémorroïdes des augures en même temps qu’à flatter le public dans ses parties basses, ils en sortent parfaitement adaptés à leur nouveau métier d’aristarques.
Avons-nous besoin de dire qu’en ces trois derniers lustres, tous ceux qui ont régenté l’opinion dans la gamme des journaux qui va du Temps au Petit Pharisien, ainsi que dans ces maisons closes à façade de Revue bien achalandée, sont sortis de cette École de rééducation des ratés littéraires ?
Fernand Kolney