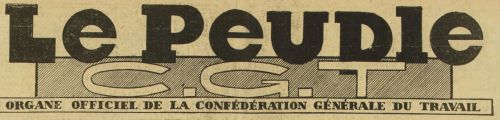III
L’assassinat de Victor Noir.
Il y a de cela près de trois quarts de siècle et ma mémoire se rappelle la commotion que suscita dans Paris, éclatant comme un coup de foudre, la nouvelle de l’assassinat de Victor noir par le prince Pierre Bonaparte.
Ce personnage, cousin de l’empereur, vivait à Auteuil, à l’écart de l’élégante cour des Tuileries qui, au fond, le méprisait pour son humeur farouche et brutale. Député de la Corse à l’Assemblée constituante de 1848, il avait affecté au début, à l’instar de tous les aventuriers politiques, des opinions ultra-démocratiques et même une opposition à la politique du prince-président. Ce qui ne l’avait pas empêché de se rallier au régime né du 2 décembre et d’émarger pour une somme respectable à la liste civile que le peuple français avait l’honneur de servir à la famille Bonaparte.
L’entretenu voulut gagner sa provende en menaçant, dans un écrit furibond publié par L’Avenir de la Corse, les adversaires du régime napoléonien. Il ne s’agissait de rien de moins que de leur mettre « le stentine per le porrette » (« les tripes aux champs »).
Cette littérature de maquis visait spécialement les républicains clairsemés en Corse et aussi les rédacteurs de la Marseillaise, quotidien que Rochefort, élu député de Paris, venait de fonder en remplacement de La Lanterne, hebdomadaire. Le principal rédacteur de ce nouveau journal était, après Rochefort, Paschal Grousset, Corse de naissance et républicain d’avant-garde ; Gustave Flourens, fils du célèbre physiologiste et lui-même jeune savant à l’âme héroïque de paladin, y collaborait, ainsi que Millière, Vallès, Arthur Arnould, Ulric de Fonvielle, Victor Noir. Presque tous ces noms se retrouveront dans l’épopée de la Commune.
En même temps que paraissait son article comminatoire, Pierre Bonaparte adressait une lettre violente à Rochefort, le défiant de venir le trouver chez lui. En prévision de cette visite espérée, le prince s’était armé.
Guet-apens flagrant et qui lui eût été payé bien cher en cas de réussite !
Au reçu de cette lettre, Rochefort décida de charger Millière et Arthur Arnould d’aller trouver le provocateur pour arrêter les conditions d’un combat. Mais il ne put communiquer tout de suite avec le second : le télégraphe n’était pas encore inventé ! Et, pendant ce temps, Paschal Grousset, relevant la menace adressée à ses compatriotes républicains, avait envoyé au tranche-montagne deux témoins : Victor noir et Fonvielle.
Voici publié par ce dernier dans La Marseillaise, le récit du drame :
« Le 10 janvier 1870, à 1 heure, nous nous sommes rendus, Victor Noir et moi, chez le prince Pierre Bonaparte, rue d’Auteuil, 59 ; nous étions envoyés par M. Paschal Grousset pour demander au prince Pierre Bonaparte raison d’articles injurieux contre M. Paschal Grousset, publiés dans L’Avenir de la Corse.
« Nous remîmes nos cartes à deux domestiques qui se trouvaient sur la porte ; on nous fit entrer dans un petit parloir au rez-de-chaussée, à droite. Puis, au bout de quelques minutes, on nous fit monter au premier étage, traverser une salle d’armes et, enfin, pénétrer dans un salon.
« Une porte s’ouvrit et M. Pierre Bonaparte entra.
« Nous nous avançâmes vers lui et les paroles suivantes furent échangées entre nous :
« – Monsieur, nous venons de la part de M. Paschal Grousset vous remettre une lettre.
« – Vous ne venez donc pas de la part de M. Rochefort, et vous n’êtes pas de ses manœuvres ?
« – Monsieur, nous venons pour une autre affaire, et je vous pris de prendre connaissance de cette lettre.
« Je lui tendis la lettre ; il s’approcha d’une fenêtre pour la lire. Il la lut, et après l’avoir froissé dans ses mains il revint vers nous.
« – J’ai provoqué M. Rochefort, dit-il, parce qu’il est le porte-drapeau de la crapule. Quant à M. Paschal Grousset, je n’ai rien à lui répondre. Est-ce que vous êtes solidaires de ces charognes ?
« – Monsieur, lui répondis-je, nous venons chez vous loyalement et courtoisement, remplir le mandat que nous a confié notre ami.
« – Êtes-vous soidaires de ces misérables ?
« Victor Noir répondit :
« – Nous sommes solidaires de nos amis.
« Alors s’avançant subitement d’un pas et sans provocation de notre part, le prince Bonaparte donna, de la main gauche, un soufflet à Victor Noir, et en même temps il tira un revolver à dix coups qu’il tenait caché et tout armé dans sa poche, et fit feu à bout portant sur Noir.
« Noir bondit sous le coup, appuya ses deux mains sur sa poitrine et s’enfonça dans la porte par où nous étions entrés.
« Le lâche assassin se précipita alors sur moi et me tira un coup de feu à bout portant.
« Je saisis alors un pistolet que j’avais dans ma poche et, pendant que je cherchais à le sortir de son étui, le misérable se rua sur moi ; mais lorsqu’il me vit armé, il se mit devant la porte et me visa.
« Ce fut alors que, comprenant le guet-apens dans lequel nous étions tombés, et me rendant compte que si je tirais un coup de feu on ne manquerait pas de dire que nous avions été les agresseurs, j’ouvris une porte qui se trouvait derrière moi et je me précipitai en criant : « À l’assassin ! »
« Au moment où je sortais, un second coup de feu partit et traversa de nouveau mon paletot.
« Dans la rue, je trouvai Noir, qui avait eu la force de descendre l’escalier et qui expirait…
« Voilà les faits tels qu’ils se sont passés, et j’attends de ce crime une justice prompte et exemplaire. »
Noir n’avait pas encore vingt-deux ans et il allait se marier dans huit jours.
La nouvelle de cet assassinat commis délibérément, sans la moindre excuse d’une provocation, éclata comme un coup de tonnerre.
La Marseillaise parut le lendemain [[C’était ce même numéro, antidaté du 12 janvier 1870, qui contenait le compte-rendu du crime écrit par Ulric de Fonvielle.]] contenant, encadré de noir, cet émouvant appel, signé de Rochefort :
« J’ai eu la faiblesse de croire qu’un Bonaparte pouvait être autre chose qu’un assassin.
« J’ai osé m’imaginer qu’un duel loyal était possible dans cette famille où le meurtre et le guet-apens sont de tradition et d’usage.
« Notre collaborateur Paschal Grousset a partagé cette erreur et, aujourd’hui, nous pleurons notre pauvre et cher ami Victor Noir, assassiné par le bandit Pierre-Napoléon Bonaparte.
« Voilà dix-huit ans que la France est entre les mains sanglantes de ces coupe-jarrets qui, non contents de mitrailler les républicains dans les rues les attirent dans des pièges immondes pour les égorger à domicile.
« Peuple français ! Est-ce que, décidément, tu ne trouves pas qu’en voilà assez ? »
C’était un cri venu de l’âme. Un cri de guerre au gouvernement impérial. Il eut un écho profond dans la population parisienne. Les exemplaires du journal furent saisis par la police, mais on ne pouvait les saisir tous.
Ceux qui avaient échappé à la razzia se vendaient 20 francs. Des gens se regardaient, s’interrogeaient : « L’avez-vous lu ? » Beaucoup pensaient que cette journée pourrait voir la chute du régime instauré dans le sang du 2 décembre. Sous la pluie battante, une foule qu’on a évaluée à deux cent mille Parisiens, s’était portée à Neuilly, où dans la petite maison de la famille Noir reposait le corps de l’assassiné. Cette malheureuse victime, totalement inconnue la veille et fauchée dans la fleur de la jeunesse, inspirait, certes, une grande pitié mêlée d’indignation et de fureur contre le meurtrier, mais sa personne même disparaissait dans le frémissement universel. Elle était devenue le drapeau de cette foule grondante, prête à la révolte.
Ce qui se passa à Neuilly, l’histoire l’a dit : les républicains révolutionnaires, et parmi eux, au premier rang, Gustave Flourens, réclamant le transport du corps à Paris pour soulever le peuple des faubourgs contre l’Empire abhorré ; les supplications de Louis Noir, épouvanté du rôle justicier qu’eût joué le cadavre de son frère, se levant comme le spectre de Banco pour prononcer la condamnation du régime infâme. Vingt-trois siècles auparavant, la mort d’une femme outragée avait soulevé Rome contre la tyrannie monarchique. Le cadavre de Victor Noir allait-il, comme celui de Lucrèce faire surgir, vengeresse, la République ?
Les fidèles de Blanqui étaient là, prêts à l’action. Même le gouvernement avait pris ses mesures et n’eût sans doute, pas plus qu’au 2 décembre, hésité devant un massacre. Une formidable cavalerie occupait les Champs-Élysées, prête à se ruer. Rochefort, auquel on a reproché un manque de décision en l’occurrence, eut la vision d’un carnage probable et déconseilla la marche sur Paris. À deux reprises, il se trouva mal : très brave dans un duel, il n’était pas, avec sa nervosité presque maladive, l’homme d’un mouvement des masses.
Rochefort, à qui les plus ardents demandaient impérieusement de donner, comme représentant du peuple, le signal de la lutte, ne s’était pas cru autorisé à le faire. « une foule bien décidée – a‑t-il dit peu après pour se justifier – n’a pas besoin du signal d’un individu. »
En cette circonstance, Delescluze, présent à la manifestation, appuya nettement Rochefort. On ne pouvait taxer de pusillanimité l’austère républicain qui, après toute une vie consacrée au triomphe de son idéal, devait, seize mois plus tard, se faire tuer sur une barricade.
Seuls, ceux qui ont vécu dans la foule savent par expérience combien elle est terrible dans ses ruées et folle dans ses paniques. La masse des manifestants eut-elle, comme une avalanche, balayée sous son poids les forces de police et de cavalerie ? Se fut-elle, au contraire, dispersée sous les charges, permettant à l’Empire de se reconstituer par un triomphe du sabre ? Il est impossible de se prononcer. Ce qu’il y a de certain, c’est que la troupe était terriblement massée au rond-point des Champs-Élysées et que, à la hauteur du palais de l’Industrie, des régiments de chasseurs à cheval se tenaient prêts à sabrer.
Il y eut quelques bagarres de courte durée. Rochefort, après avoir inutilement parlementé afin d’obtenir le libre passage pour cette foule rentrant dans Paris, courut à la Chambre des députés déposer une protestation émue.
Le crime de Pierre Bonaparte avait produit dans la partie de la masse capable de penser une commotion galvanique. Celui perpétré par Troppmann, l’assassinat ayant le vol pour mobile, d’une famille de sept personnes, servait depuis plusieurs mois de pâture à cette autre masse qui ne pense pas et qui borne son activité intellectuelle à la lecture des faits divers ou des romans-feuilletons.
Le 20 septembre 1869 avaient été découverts, dans un terrain vague de Pantin, les cadavres de la famille Kinck. Ils étaient là depuis la veille, enfouis très superficiellement, encore chaud. La piste de l’assassin fut bientôt trouvée et la chasse à l’homme commença. Troppmann, traqué, fut arrêté au Havre, trois jours après, par un gendarme, comme, sous le nom de Fisch, il allait s’embarquer pour l’Amérique.
Pendant ce temps, des badauds de Paris chantaient sur l’air de Fualdès cette complainte :
Écoutez, fruitiers sensible,
Sénateurs et marchands d’vins,
Le récit le plus horrible :
C’est l’assassinat d’Pantin !
Pierre Bonaparte, jugé par la haute Cour, fut acquitté. Troppmann, jugé par la cour d’assises fut condamné à mort et exécuté. Pourquoi n’était-il pas prince et cousin du chef d’État ?
La naïveté populaire est incommensurable : il se trouve une foule d’individus pour révoquer en doute l’existence de Troppmann et voir dans cette affaire tragique, demeurée célèbre, une invention du gouvernement destinée à occuper l’attention publique. Un demi-siècle plus tard, il devait se trouver pareillement des gens pour révoquer en doute l’existence de Landru, le tueur de femmes.
« Manœuvre politique ! » disaient-ils.
Peu leur importait que les restes des victimes eussent été vues, qu’un grand nombre de personnes eussent assisté au procès et à la décapitation du meurtrier : la foi de ces aveugles demeurait entière. Ils ne se disaient pas que le comparse eut dû y mettre une singulière bonne volonté !
Tout ce qu’on peut constater, c’est que les journaux officieux, gavant leurs lecteurs de récits rocambolesques de crimes, de scandales et de gravelures, s’efforçaient de les détourner des questions sérieuses pour le plus grand profit du gouvernement. L’exécution de Troppmann, qui eut lieu le 19 janvier – sept jours après l’enterrement de Victor Noir et au moment où le gouvernement demandait des poursuites contre Rochefort – fut certainement un événement de haute importance pour le public du Petit Journal, mais ne put faire diversion au mouvement des idées.