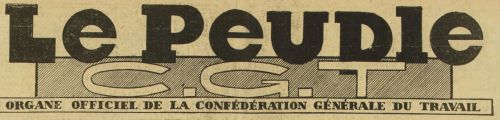IX
Bombardement, famine et capitulation.
Les Prussiens avaient la facétie lourde. Pour cadeau de nouvelle année ils offrirent aux Parisiens le bombardement, qui commença exactement le 5 janvier, s’acharnant surtout sur les quartiers de la rive gauche.
Notre 5e arrondissement fut un des mieux visés : le dôme du Panthéon servait de point de mire aux batteries du plateau de Châtillon. Sur les flancs de la Montagne Sainte-Geneviève, les projectiles pleuvaient. Le premier obus était tombé rue Daguerre, tuant un petit chien ; un autre, rue de la Parcheminerie, hacha une fillette de six ans dont les restes – de vraies miettes – furent recueillis dans une serviette. Les rues Descartes, Lacépède, Monge, Gay-Lussac, Cajas, des Carmes, étaient aussi éprouvées que la nôtre.
Eh bien ! je l’avoue, si je déplorais cet arrosage pour les victimes qu’il faisait, car, après tout, je n’étais pas un monstre, il ne m’était pas foncièrement désagréable.
Les pièces des appartements ayant vue sur la rue passant pour les plus exposées, et celles donnant sur la cour l’étant presque autant, mes parents me logeaient, aux heures de bombardement, dans un cabinet de débarras meublé d’une paillasse. Abri tiède et demi-sombre où ma petite voisine Hélène venait me tenir compagnie. Ses parents, comme les miens, ne s’imaginaient pas que deux enfants de notre âge pussent ébaucher une idylle. Et, pourtant, ce fut une idylle très confuse et à peu près platonique. Nous prenions prétexte des détonations pour nous serrer un peu plus l’un contre l’autre, mais au fond, ce que nous nous moquions des canons prussiens ! Nous leur avions presque de la reconnaissance.
C’était tout juste si, lorsqu’ils faisaient relâche, nous ne récriminions point :
– Eh bien ! qu’est-ce qu’ils font donc, les paresseux ?
Comme quoi le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres.
Ce bombardement, qui s’attaquait non plus à des ouvrages militaires, mais à un foyer de civilisation séculaire et mondial, provoqua partout de pathétiques protestations. Soudard piétiste, Guillaume Ier affirma, sans rire, son humanitarisme : c’était non pour détruire leurs vies, mais pour ébranler leur moral et les contraindre à une capitulation qui eût mis fin à la guerre !
Dès cette époque s’annonçait dans l’état-major allemand la doctrine que, plus tard, devaient formuler dogmatiquement Treitschke et Bernhardi, celle qu’il ne faut pas chercher à tempérer les horreurs de la guerre. Plus celle-ci est atroce, plus vite la résistance serait brisée et la paix – quelle paix ! – rétablie.
Si telle avait été réellement la pensée de Guillaume Ier et de ses deux conseillers, Bismarck et de Moltke, le trio s’était grandement trompé.
En entendant, au lieu du grondement lointain des forts et des batteries prussiennes croisant leurs feux, un tonnerre continu, accompagné du sifflement et de l’éclatement des obus, les Parisiens avaient ressenti non de l’effroi, mais une sorte de surprise amusée et, déjà les gamins, saluant de leurs cris joyeux le passage des projectiles, se précipitaient à peine ceux-ci explosés pour en ramasser les éclats.
À partir de ce moment, ma mère qui se rendait rue Daubenton tous les deux ou trois jours, y alla quotidiennement.
Les vieilles dames de la pension Comoléra supportaient sans grande émotion le bombardement. Quelques-unes, demeurées confiantes dans le génie de Trochu, inspiré par sainte Geneviève, répétaient sentencieusement le cliché lancé dans la circulation depuis bientôt quatre mois :
– Patience, il a un plan !
Mais, en dépit de quelques respectables momies des deux sexes, mûres pour le sarcophage, la croyance au plan Trochu ne subsistait plus guère dans la population !
Et, même dans cette antichambre de cimetière qu’était la pensions Comoléra, j’ai entendu une bonne septuagénaire exprimer avec véhémence son irrespect du gouvernement :
– Mais qu’attendent-ils donc pour vider les lieux tous ces Jules ? (la moitié de ces dirigeants, et les plus impopulaires, se prénommaient Jules). Ce n’est pas Gambetta et Trochu qu’il faut les appeler, mais Grand Bêta et Torche-Cul !
Car sur Gambetta lui-même, quoique éloigné, rejaillissait l’impopularité de ses collègues.
La dame qui exclamait son indignation avec cette verdeur gauloise avait pourtant reçu une excellente éducation à l’époque où vivait le général Cambronne. Elle avait appris, comme il était de rigueur alors dans les familles qualifiées de « bonnes », à pianoter, tapisser et danser aux bals officiels, où l’on ne présentait pas encore la valse chaloupée et le charleston. Mais elle était patriote !
En 1814 ou 1815, sa famille avait été désignée parmi les plus notables de sa ville lorraine, qu’occupait Allemands, Autrichiens et Russes, pour héberger un certain nombre d’officiers alliés ; la dame, alors jeune fille d’une quinzaine d’années, avait demandé à l’un de ces guerriers :
– Et vous, monsieur, à quelle nation appartenez-vous ?
– À celle qui déteste le plus les Français, avait répondu haineusement le malotru.
Il était Prussien !
V’lan ! Une gifle lancée à toute volée l’aveugle.
Il y eut un beau tapage. Les Allemands ne parlaient de rien moins que de brûler la maison. L’affaire finit toutefois par s’arranger.
Cette personne à la main leste était ma grand’mère, pourtant si bonne !
J’ai gardé le souvenir d’une promenade aux Halles avec mes parents, un peu avant ou un peu après le Nouvel an. Quelques volatiles fraîchement occis et d’apparence moyenne s’étalaient sur la table d’une marchande, pour la bourse des nababs, lesquels ne dédaignaient pas de venir faire eux-mêmes leurs emplettes.
Mon père en désigna un :
– Combien ce poulet ?
– Soixante francs.
Nous laissâmes l’animal emplumé et poursuivîmes notre route. Le pavillon des légumes était d’un vide désespérant ; pourtant nous finîmes par découvrir une demi-douzaine de navets glacés et raide comme la justice, tenant tête à deux boisseaux de pommes de terre boursouflées de germes.
La plupart des marchandes installées devant leurs tables dégarnies semblaient venues là par habitude, pour regarder la mine anxieuse des clients et bavarder entre elles.
– Combien la livre de beurre ?
– Cinquante francs.
– Et ce poireau solitaire ?
– Un franc.
Toutes ces réponses sont faites d’un ton péremptoire. C’est à prendre ou à laisser.
Nombre de bourgeoises, aisées avant la guerre et qui ont maintenant congédié leur bonne, viennent faire leurs emplettes elles-mêmes. Il faut voir l’ironique hostilité avec laquelle le regard des femmes en cheveux poursuit les femmes en chapeau.
C’est surtout aux queues pour le pain ou la viande, stationnement de plus de deux heures sous la pluie, la neige et les bombes, que cette hostilité éclate.
– Eh là-bas ! la grande au chapeau ! En a‑t-elle un air de marquise !
– Marquise de la dèche !
– À la queue ! À la queue !… Tu passeras à ton tour !
Haine de classe qui couvait peut-être et que les souffrances ont fait éclater en l’exaspérant. Revanche légitime, sans doute, dans sa cause première, cruelle et injuste le plus souvent dans ses manifestations.
Ma mère fait la queue comme presque toutes les Parisiennes. Aussi loin que remontent mes souvenirs d’enfance, je ne me rappelle pas avoir connu à mes parents de domestiques mâles ou femelles. Une femme de ménage, le plus souvent la concierge, ou, pour les gros travaux, un homme de peine, c’est tout. Ma mère, malgré son éducation soignée, n’a jamais voulu avoir d’esclave à son foyer et la vie révolutionnaire de mon père l’a habitué à se servir lui-même ; il adore d’ailleurs cuisiner et, à l’instar de Rossini et d’Alexandre Dumas père, y déploie une virtuosité de gourmet. Conscient de sa valeur dans cette branche de l’activité humaine, jamais il n’a consenti à abandonner à des mains vulgaires la confection du macaroni.
Pourquoi avoir auprès de soi, à demeure, des domestiques qui, vivant comprimés, dans votre ombre, forcément vous détestent, vous épient et se moquent de vous si vous les traitez sans hauteur.
Ainsi pensent mes parents et c’est aussi mon sentiment. J’ai toujours eu horreur de me faire servir et de regarder comme mes inférieurs d’autres êtres humains.
C’est aussi ce sentiment-là qui m’a toujours fait préférer dans la conversation l’usage du français à celui de l’italien. Cette dernière langue, avec toute sa beauté musicale, m’agace à la longue par des formules cérémonieuses rappelant le servilisme et la flatterie des anciennes cours de la péninsule. J’ai horreur du lei, cette troisième personne féminisée, même lorsqu’elle s’adresse à un homme, qui sous-entend « Sa Seigneurie » et remplace le voi dans les rapports d’inférieur à supérieur ou entre messieurs du beau monde, tandis que ceux-ci vouvoient dédaigneusement les gens d’un cran au-dessous d’eux et soufflettent du tu leurs domestiques. Le usted espagnol, qui répond à « Votre Grâce », ne me choque point parce qu’il présente plus de réciprocité. De même le you anglais, qui élimine le tutoiement sauf en langue mystique, et le gy flamand qui s’emploie seul pour tu et pour vous .
Quant à l’allemand, il reflète dans sa grammaire l’esprit hiérarchique de la société d’outre-Rhin.
Avant d’arriver à la fin lamentable du siège de Paris, je citerai un fait divers que relata le Rappel :
Un passant aperçoit, en traversant le pont des Saints-Pères, une femme qui tenait un petit chien chaudement abrité sous son manteau, tout en traînant par la main un enfant en larmes qui gémissait : « Maman, j’ai froid ! » La mère, impassible, s’arrêtait de temps à autre pour gifler le petit malheureux. Sans doute histoire de le réchauffer.
Indigné, le passant s’approche, arrache le chien à sa maîtresse, le jette à la Seine et met à sa place, sous le manteau protecteur, le petit grelotteux en disant à la mauvaise mère : « Marchez droit ! Je vous accompagne jusque chez vous !»
De faim, de froid et de maladie, il périt 40.000 enfants pendant le siège de Paris.
Sur ces cadavres grandit la gloire de Guillaume Ier. Le 15 janvier 1871, le vieux roi de Prusse fut proclamé empereur d’Allemagne par les princes souverains réunis au château de Versailles dans la galerie des glaces.
Pourtant, l’esprit de résistance de la population parisienne demeurait inébranlable. Les rares reconnaissances au cours desquelles le gouvernement militaire s’était décidé à employer la garde nationale avaient montré celle-ci pleine d’élan. On lui avait pourtant donné comme généralissime un homme indifférent aux uns, exécré des autres pour son rôle de réacteur en juin 1848.
C’était Clément Thomas. Celui-ci, commandant la cavalerie au cours des journées tragiques, avait, désignant de son sabre les héroïques meurt-de-faim des faubourgs, ceux mêmes qui avaient fondé la République en février, lancé cet ordre furieux :
– Sabrez-moi cette canaille !
La canaille, vingt-trois ans plus tard, devait avoir sa revanche.
Malgré Trochu et ses acolytes, ceux qui identifiaient France et République persistaient à tenir bon. Les « guerre-à-outrance » devaient les surnommer plus tard en ricanant, les militaires professionnels, dont le rôle s’avérait si piteux !
– La garde nationale veut une saignée : donnons-la-lui ! déclara à ses collègues le piètre chevalier de sainte Geneviève.
Ce fut la sortie de Buzenval (19 janvier).
Comme celle de Champigny, elle fut marquée par le même élan des troupes et la même impéritie du commandement. La redoute, la villa et la terrasse de Montretout furent enlevées avec brio puis on tâtonna dans le brouillard, laissant à l’ennemi le temps d’envoyer des renforts et de consolider sa résistance à Buzenval. Finalement, les bataillons décimés furent ramenés sur Paris.
Dès lors, les plus obstinément crédules devaient voir le proche et inexorable dénouement. À quelle issue lamentable allaient aboutir tant de souffrances !
Deux jours après c’était une autre tragédie : à Paris, cette fois. Une fusillade de mobiles bretons, embusqués aux fenêtres de l’Hôtel de Ville, foudroie une pacifique manifestation venue demander la continuation de la résistance. Les gens de la « Défense nationale » ne savent remporter de victoires que sur leurs compatriotes !
Flourens et les autres détenus politiques enfermés à Mazas avaient été délivrés dans la nuit.
Dans une proclamation, en date du 6 janvier, le pieux Trochu avait déclaré solennellement :
– Rien ne fera tomber les armes de nos mains. Courage, confiance, patriotisme. Le gouverneur de Paris ne capitulera pas !
Alors que même lancer le mot de « capitulation » c’était déjà trahir !
Au lendemain de Buzenval, le tartufe démissionne comme gouverneur de Paris, supprime ce poste, passe le commandement de l’armée à son compère Vinoy, et c’est celui-ci qui signe la capitulation !
Escobar n’était pas mort.
Quel coup de massue pour la population lorsque, le 28 janvier au matin, on lut sur les murs et dans ceux des journaux que le gouvernement n’avait pas supprimés, la consternante nouvelle !
Paris avait été livré nuitamment, traîtreusement par les incapables qui s’étaient chargés de le défendre. Les forts, sauf le Mont-Valérien, allaient être occupés par les Allemands ; les armes et canons de l’armée régulière devaient être rendus. Seule une division, jugée nécessaire pour maintenir « l’ordre », et la garde nationale, qu’ont n’eût osé défier, ne seraient point désarmées.
Cette reddition ignominieuse s’accomplit comme un mauvais coup dans les ténèbres. Le dernier coup de canon fut tiré le 27 janvier, à minuit, et, au jour, les Parisiens se trouvèrent devant le fait accompli.
La ville restait morne, comme écrasée. Ainsi, tant de souffrances stoïquement supportées pour en arriver là !
Un bataillon de garde nationale vint crier devant l’Hôtel de Ville : « À bas les traîtres ! » Le soir, 400 officiers de la milice citoyenne, en laquelle s’incarnait l’âme de Paris, signèrent un pacte de résistance et élirent pour chef Brunel, commandant du 107e. C’était un homme énergique, ancien officier de carrière, que ses opinions républicaines avaient fait exclure de l’armée sous l’Empire.
Dans notre quartier nous percevions l’écho, parfois confus, des mouvements qui se produisaient sur la rive droite. Le 29, à notre réveil, nous apprîmes que Brunel, secondé par un autre républicain, Piazza, comme lui officier de la garde nationale, avait fait battre le rappel et sonner le tocsin dans quelques arrondissements. Leur but était de se saisir des forts avant qu’ils fussent occupés par les Prussiens et réorganiser la défense. Mais la nuit était glaciale et leur appel dans les 10e, 13e et 20e arrondissement ne fut guère entendu : seulement deux ou trois bataillons se réunirent. C’était trop peu et il était trop tard : la tentative, dernière convulsion de la défense, avait échoué.
Deux jours plus tard, Brunel fut arrêté.
Les forts avaient été évacués le 28, à 3 heures de l’après-midi. Les marins, qui avaient tenus pendant quatre mois sous les canons allemands, se replièrent sur la capitale, où la population leur fit cortège, et, dans l’air, s’éleva le refrain d’un chant devenu populaire :
Les marins de la République
Montaient le vaisseau Le Vengeur
Le symbolique vaisseau de la Ville de Paris s’était bien identifié avec le célèbre navire sombré dans le combat du 13 prairial an II, au cri de : « Vive la République ! » Mais, plus heureux que Le Vengeur, et comme le voulait sa devise, quoique vaincu, ou plutôt livré, il continuait de flotter !
La capitulation fut suivie aussitôt du ravitaillement : les Anglais furent les premiers à nous envoyer des vivres.
Quel ravissement lorsqu’on revit le pain blanc au lieu de l’ignoble mixture de son et d’avoine ! Au milieu de la misère générale quelques privilégiés avaient pu se fournir clandestinement de pain mangeable, qui eût dû strictement être réservé pour les hôpitaux. Un jour même mon père, avec quelques gardes de sa compagnie, ayant surpris un cénacle où se distribuait en cachette du pain de luxe, était revenu à la maison avec une grosse miche de pain blanc. Quelle bombance ce fut !
Et, maintenant, des denrées magnifiques apparaissaient : des harengs saurs, des boîtes de sardines, et du vrai saucisson, non plus ce saucisson imposteur, empli de crottin que des misérables osaient parfois livrer à la consommation !
La vue des premières côtelettes nous causa une impression profonde : on avait presque oublié le goût du mouton ! Et ce fut un moment auguste celui où mon père déposa sur notre table, fumant dans un arôme combiné de beurre, de parmesan et de jus de viande, relevé de noix de muscade – la tomate seule y manquait – un vrai macaroni qu’il avait solennellement confectionné.
Les mercantis se hâtaient alors de sortir de leurs caves les denrées qu’ils avaient laissé pourrir, dans l’attente fiévreuse du moment où ils pourraient les vendre leur poids d’or à la population affamée. Combien ces français, hommes d’ordre, étaient plus haïssables que les soudards allemands !
Hélas ! aucun de ces honnêtes commerçants ne fut accroché à un réverbère. On n’était plus en 1793 !