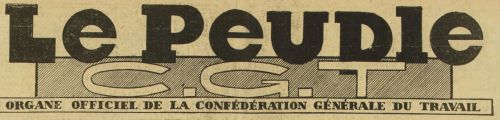X
De la capitulation (28 janvier) à la révolte (18 mars).
La capitulation avait eu pour prétexte, en outre du manque de vivres, la nécessité d’élire une Assemblée Nationale qui déciderait sur la conclusion de la paix ou sur la prolongation de la guerre.
Ces élections, forcément hâtives, se firent dans une partie de la France, sous les baïonnettes allemandes et, dans l’autre partie, sous les influences conservatrices. Elles donnèrent un résultat exécrable.
Certes, Paris avait voté pour des hommes d’avant-garde : Victor Hugo, Louis Blanc, Edgar Quinet, Garibaldi, Gambetta, Rochefort, Delescluze, Pyat, Gambon, Millière, Schœlcher, Ranc, tolain, Dorian, Lockroy, Clemenceau, Malon, etc. Les autres grandes villes avaient aussi, pour la plupart, élu des démocrates bon teint. Et les bonapartistes, répudiés comme responsables de la guerre par les mêmes paysans qui, la veille, leur avaient donné sept millions de voix, étaient écrasés, sauf dans leurs fiefs de Corse et de Gironde.
Mais une foule de fantômes du moyen âge, hommes du droit divin et du drapeau fleurdelysé, les remplaçaient. Les Belcastel, les Lorgeril, les Cumont (on disait, irrévérencieusement de celui-ci qu’il mettaient la charrue avant les bœufs), tous pourvus de la particule, arrivaient en foule, élus par les masses rurales dégoûtées de l’Empire, puisqu’il avait été vaincu, mais épouvantées par la République.
Leur premier geste fut de conspuer Garibaldi qui, à leurs yeux, incarnait la Révolution et la libre pensée. C’était pourtant le seul des généraux qui n’eût pas été vaincu. S’il n’avait pas tenté de dégager l’armée de l’Est, conduite par l’incapable Bourbaki, comme le lui ont reproché des critiques fielleux – ses forces étaient insuffisantes pour cela et c’eût été un double écrasement – il avait du moins réoccupé et tenu Dijon, protégeant contre l’invasion les établissements du Creusot, Lyon et la vallée du Rhône.
Je revois la physionomie de Paris à cette époque où la guerre était virtuellement terminée. Sur la place du Panthéon, autour du monument qui proclame la reconnaissance posthume de la patrie pour les grands hommes, des milliers de chassepots s’amoncelaient. Dans les mairies des autres arrondissements et dans les casernes se formaient de semblables dépôts. C’étaient les armes de la troupe régulière qui, en vertu des clauses de la capitulation, allaient être livrées à l’armée allemande.
Aux vitrines des librairies, nombre de dessins satiriques, quelques-uns spirituels, d’autres idiots. Parmi ces derniers, je me rappelle un Bismarck recevant, l’oreille basse, les reproches de son maître :
— Comment ! mes soldats sont encore battus ?
— Sire, j’avais pourtant mis en ligne dix Prussiens contre un Français…
— Ah ! seulement dix ! Alors, je comprends !
À la fin d’une guerre désastreuse, où les chefs français avaient presque tous fait preuve de l’incapacité la plus notoire, et d’un siège où un demi-million d’hommes avaient capitulé devant cent cinquante mille, semblable mélange d’ignare légèreté et de grotesque vantardise soulevait le cœur.
Les mêmes vitrines exposaient des chansons patriotiques ou révolutionnaires d’un sentiment naïf. La génération actuelle ne chante plus guère ; celle de « l’année terrible », au contraire, avait retrouvé les effusions humanitaires de 48, les aspirations à la fois généreuses et vagues. L’une de ces chansons affirmait dans un refrain :
Jésus-Christ, fils de Dieu, était républicain.
L’existence – si controversable – du Christ paraissait alors une vérité démontrée, même aux libres penseurs qui refusaient de croire à sa divinité.
On vendait et chantait une nouvelle Carmagnole :
Monsieur Trochu avait promis (bis)
Avec son plan d’sauver Paris (bis)
Sur l’air de Monsieur Dumollet, on continuait de chanter cet adieu ironique, composé au lendemain du 4 septembre :
Bon voyage, mon cher Badinguet !
Le roi Guillaume t’emmèn’ dans son royaume,
Qu’il te garde si ça lui plaît.
Tu l’as voulu, c’est bien fait, Badinguet.
Mais la chanson qui détenait encore le record, c’était le Sire de Fische-ton-khan, créée pendant le siège de Paris et dédié au commandant Brunel. Chant de marche des bataillons qui partaient monter la garde aux bastions :
C’est le sir’ de Fische-ton-khan
Qui s’en va-t-en guerre.
En deux temps et trois mouv’ments
Sens devant derrière(…)
L’pèr, la mère’ Badinguet,
À deux sous tout l’paquet !
L’pèr’, la mèr’ Badinguet
Et l’petit Badinguet !
J’avais jusque-là continué de suivre les événements, dévorant les journaux qui s’amoncelaient sur le bureau de mon père, et tout enfiévré de vivre une époque extraordinaire. Mais, quoique cette nourriture intellectuelle fût pour moi bien autrement appétissante que la nourriture illusoire du siège, je dus m’arrêter : la typhoïde, couvée pendant les deux derniers mois, venait de me frapper.
Mon jeune organisme qui avait supporté le surmenage cérébral infligé par mon docte aïeul, réagit encore et sortit victorieux de la lutte au bout de trois semaines. Lorsque je pus me lever, ce fut pour apprendre que les Allemands allaient faire leur entrée dans Paris.
L’empereur Guillaume avait voulu à la fois grandir son prestige et donner satisfaction à ses troupes.
L’entrée d’une partie de l’armée assiégeante – trente mille hommes – dans les 16e et 7e arrondissements, c’est-à-dire dans un secteur limité par la Seine, les Ternes et le faubourg Saint-Honoré, n’amena point d’incident grave. Ah ! si cette entrée se fût fait par Belleville !
Pourtant, l’avant-veille, la nouvelle avait causé une profonde émotion. Les gardes nationaux, qui s’étaient tout récemment fédérés, ne reconnaissaient plus d’autre autorité que celle de leur comité central : alertés par le tocsin et le rappel, ils s’étaient réunis à quelque quarante mille et portés dans le haut des Champs-Élysées. Là, toute la nuit, ils avaient attendu les Prussiens. Le même jour, Brunel, l’énergique commandant du 107e, avait été délivré par les fédérés de la prison de Sainte-Pélagie.
En s’en retournant, les bataillons de Montmartre ramenèrent des canons qui restaient parqués à Passy et place Wagram. Ces pièces, fondues avec l’argent des souscriptions populaires, étaient la propriété des Parisiens qui devaient les conserver en vertu même des clauses de la capitulation. Il convenait de ne pas les laisser sous la main rapace du vainqueur : on les installa au parc Monceau, sur la place des Vosges et devant la mairie de Montmartre.
Ces canons étaient une défense à la fois contre les soldats de Guillaume et contre un coup de force monarchiste. Si l’Empire ne trônait plus aux Tuileries, ses généraux, élevés à l’école du Deux Décembre, restaient, comme Vinoy, à la tête de l’armée ; ils brûlaient de prendre contre les Parisiens, leurs compatriotes exécrés, une revanche des défaites que leur avaient infligées les Prussiens.
Satisfaits d’avoir sauvegardé leurs canons, les gardes nationaux ne revinrent point le 1er mars pour engager avec les Allemands une lutte impossible.
Sur le passage des vainqueurs, la population des quartiers occupés avait fait le vide. Le plus grand nombre des magasins étaient clos, d’aucuns arborant courageusement cette inscription : « Fermé pour cause de deuil national. » Au débouché de la rue de Rivoli et du quai des Tuilleries, sur la place de la Concorde, un cordon de lignards et de gardes nationaux formaient barrage : d’un côté les Parisiens, de l’autre les Allemands.
C’était comme le symbole de la séparation entre deux humanités.
Ce fut ma première grande sortie de convalescence. Je la fis avec mes parents, qui me quittaient moins que jamais.
Les habitants des arrondissements restés indemnes de l’occupation venaient dévisager ces ennemis d’outre-Rhin qui, pendant près de cinq mois, les avaient assiégés, affamés et bombardés. On jetait un coup d’œil sur les cavaliers aux casquettes plates, sur les fantassins coiffés du célèbre casque à pointe, fourmillant sur l’immense place, au pied des statues impassibles des grandes villes de France.
Puis on s’en retournait, la curiosité satisfaite. L’irritation du vaincu non dompté subsistait, certes ; mais l’indignation allait bien plus aux fantoches de l’Hôtel de Ville qu’aux soldats allemands qui avaient rempli leur rôle de machine à tuer.
Cette exhibition dura deux jours, les 1er et 2 mars. Des lazzis de Gavroche la ponctuèrent, mais sans amener de tragédie. Incident plus pénible : quelques femmes dont les allures avaient paru équivoques furent malmenées par la population et même fouettées. Étaient-elles réellement des trafiquantes d’amour cherchant à vendre leurs caresses aux bombardeurs de Paris ? Il serait impossible de le dire : la foule est tout impulsive – lâche et cruelle plus souvent qu’héroïque et généreuse. Sa justice n’est pas plus infaillible que celle des magistrats.
L’esprit révolutionnaire grandissait dans Paris. Révolutionnarisme bien inconscient, certes. Toutes les souffrances, toutes les rancœurs du siège montaient en bouillonnant à la surface. On maudissait les incapables, les vendus, l’« infâme » Bonaparte, le « traître » Bazaine ; épithètes milles fois méritées pour la plupart et dont nul ne souriait.
Les jours précédant l’entrée des Allemands dans Paris avaient vu d’imposantes manifestations se dérouler sur la place de la Bastille. Le 24 février, anniversaire de cette révolution de 48 d’où était sortie la Deuxième République, les bataillons de la garde nationale s’étaient fédérés, nommant au Tivoli-Vaux-hall un comité central. Puis, à l’issue de la réunion, ils avaient défilé drapeaux et tambours en tête, autour de la colonne de Juillet, acclamés, grossis par une foule immense. Un manifestant, le commandant Meyer, se hissant hardiment au faîte du monument, jusqu’à la statue qui le surmonte, y avait fait flotter le drapeau rouge en fixant la hampe dans la main du génie de la Liberté.
Geste symbolique ! C’était l’étendard populaire, teinté du sang des martyrs, qui se déployait maintenant comme un appel d’affranchissement adressé à tous les prolétaires du monde, remplaçant le drapeau tricolore de Valmy, déshonoré par les crimes des dirigeants et les défaillances de la démocratie bourgeoise.
La révolution couvait : le gouvernement lui-même allait la faire éclater.