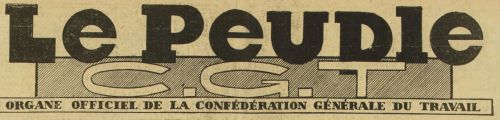XII
Paris contre Versailles, le second siège
Cependant les événements se précipitaient.Avec une activité qu’ils n’avaient jamais su déployer contre les Prussiens, les gens de Versailles organisaient une armée. En province — surtout en Bretagne — préfets et maires leur recrutaient des volontaires. Les zouaves pontificaux de Charrette et de Catelineau, vibrants de la légende des luttes vendéennes et enragés de fanatisme contre la ville des révolutions, des corps de gendarmerie et de police accouraient grossir les troupes de « l’ordre ». À cet embryon d’armée, chiffrant déjà de trente à quarante-cinq mille hommes, allaient s’en ajouter cent mille autres, Thiers et Bismarck s’étant facilement entendus pour rapatrier d’Allemagne les prisonniers de guerre. Et cette masse, exaspérée de ses défaites et de ses souffrances, allait chercher furieusement une revanche sur ces monstres de Parisiens qui, ne se résignant pas à la capitulation, avaient prolongé la guerre et leur captivité.
Les premiers coups de feu furent tirés le 2 avril, à Courbevoie, où une reconnaissance versaillaise se heurta à un poste de fédérés.
Dans la soirée s’opéra une concentration des forces de la Commune. Mon père partit avec tout le 160e, jeunes des compagnies de marche et vieux de la sédentaire, mêlée.
On était grave, pressentant qu’un grand choc allait se produire. Une proclamation de la Commission exécutive de la guerre annonçait que les « conspirateurs royalistes » avaient attaqué. La riposte était à prévoir. Toute la nuit fut emplie de mouvements de troupes. Les généraux de la Commune, ardents mais inexpérimentés, préparaient une marche concentrique qui, théoriquement bien conçue, devait, dans la pratique, aboutir à un désastre.
Trois mouvements devaient converger sur Versailles, partant : l’un, dirigé par Flourens et Bergeret, de la presqu’île de Gennevilliers ; un autre, conduit par Eudes, du Bas-Meudon ; le troisième, avec Duval, du plateau de Châtillon. Le plan conçu par Eudes paraissait fort beau. Malheureusement, une chose devait le ruiner.
Les forts du Sud, situés sur la rive gauche de la Seine — ceux d’Issy, de Vanves, de Montrouge, de Bicetre et d’Ivry — avaient été évacués par les Prussiens après la signature de la paix, puis occupée sans difficulté par les fédérés. Seul, le Mont-Valérien, beaucoup plus important, puisque d’une hauteur de 136 mètres il domine toute la vallée de la Seine et peut l’écraser de son feu plongeant, avait conservé une garnison de ligne, commandée par le lieutenant-colonel Luckner.
Lullier, ex-lieutenant de vaisseau rallié à la démocratie révolutionnaire, avait été chargé d’assurer l’occupation du fort par les fédérés. C’était un homme capable et énergique, de stature et de force herculéennes, avec une belle tête de lion et un faible pour l’absinthe qui lui faisait parfois perdre son sang-froid.
Ce marin, qui n’était pas d’eau douce, avait montré de la décision en maintes circonstances et s’était fait nommer par le Comité central commandant en chef de la garde nationale, dans la nuit du 18 au 19 mars. Cette fois, il fut mal inspiré en se contentant de la parole que lui donna le gouverneur de demeurer neutre dans un conflit entre Paris et Versailles. Il s’abstint de prendre possession du fort.
Le lieutenant-colonel Luckner, bon élève en casuistique du général Trochu, n’eut rien de plus pressé, une fois Lullier éloigné, que de télégraphier la chose au gouvernement de Versailles. La garnison fut aussitôt relevée et le commandement de la citadelle remit à un autre officier supérieur qui, lui, n’avait engagé aucune parole d’honneur.
Dans la matinée du 3 avril, les bataillons de Bergeret, venant de Neuilly, se préparent à faire leur jonction avec les bataillons de Flourens, arrivant d’Asnières. Vingt mille hommes [[Vingt mille d’après le « Rappel », beaucoup moins d’après Lissagaray, qui dit « six mille hommes de Bergeret et un millier de Flourens ».]] se dirigent de ce côté sur Versailles en tournant le Mont-Valérien. L’avant-garde atteint déjà Rueil.
Soudain, le fort, que tous croyaient neutre, ouvre le feu. Une bordée foudroie la colonne des fédérés. Coup de théâtre. Aux cris de « Trahison ! » et de « Sauve qui peut ! » les hommes se débandent et s’enfuient vers Paris.
Le canon continuait de tonner.
Dans Paris, nous entendions ce canon qui, après une trêve de deux mois, nous rappelait les jours du premier siège. Le bruit courait qu’une grande bataille était engagée et mille rumeurs contradictoires circulaient.
Étreints par l’incertitude, ma mère et moi recevions coup sur coup les visites de femmes venant nous réclamer leurs maris, partis avec la compagnie de mon père. Hélas ! nous ne pouvions ni les leur rendre ni même leur en donner des nouvelles !
Ma mère, angoissée, allait elle-même aux informations, s’adressant à des fuyards déjà rentrés dans le quartier. Leurs réponses étaient souvent extraordinaires :
— Ils sont en train de « monter à l’assaut » de Versailles ! disait textuellement l’un, qui avait jugé bon de ne point participer à cet « assaut » d’une ville ouverte.
— Ah ! madame, répondait un autre, frissonnant à la pensée de la terrible surprise, tout ce que je puis vous dire c’est que votre mari n’était pas encore parmi les morts.
C’était plus ou moins rassurant !
Toute la journée se passa ainsi. Seulement, vers dix heures du soir, nous entendîmes un pas connu résonner dans l’escalier et la voix de mon père crier dans son français italianisé : « Souis moi ! »1« C’est moi ! » Textuellement « je suis moi » (Sono io.).
Mon père était éreinté. Sur pied depuis la veille, il s’était efforcé d’endiguer la débandade et de retenir sa compagnie. Mais, dans la panique générale, ses énergiques exhortations étaient inutiles. Du moins, il était resté sous le feu jusqu’au dernier moment, ne se retirant — avec ceux auxquels la terreur n’avait pas donné des ailes — que lorsque toute idée d’offensive avait dû être abandonnée.
Flourens, qui venait de voir se dissiper son armée et son rêve de victoire, ne voulut pas rentrer dans Paris comme un Ducrot, vivant et vaincu. Malgré les exhortations de son aide de camp et ami Cipriani, il demeura seul avec son compagnon, murmurant : « Je ne reculerai pas ! »
Fatigués, cependant, les deux hommes entrèrent dans une auberge pour se reposer. Soudain, des gendarmes — une quarantaine — apparaissent et, bientôt renseignés par un habitant, se dirigent vers l’établissement. Nul moyen de fuir : la maison est cernée. Des coups de revolver s’échangent : Cipriani est arrêté au rez-de-chaussée. Il n’est que roué de coups, car c’est surtout Flourens qu’on cherche et une perquisition le fait bientôt découvrir.
C’est sur lui que la rage des Versaillais va se satisfaire. On le conduit sur le bord de la Seine, où, tête nue et les bras croisés, il attend, muet et stoïque, sa destinée. Il ne l’attend pas longtemps. Le capitaine de ces hommes, Desmarets, accourt à cheval et, hurlant : « Ah ! c’est vous, Flourens ! », lui fend le crâne d’un furieux coup de sabre qui, selon l’expression spirituelle d’un des gendarmes, lui fait « deux épaulettes ».
Ainsi périt un noble type de paladin, possédant tout : jeunesse, fortune, savoir pour vivre heureux, s’il ne se fût voué au culte de la liberté et de la justice sociales. C’était à lui qu’Eugène Pottier avait dédié sa belle poésie, Don Quichotte, et nul n’en était plus digne. Au milieu des graves soucis causés par un échec militaire de fâcheux augure, la fin tragique de Flourens causa chez tous les démocrates une tristesse profonde.
Le corps, réclamé par la famille, fut enterré à Paris. Les parents infligèrent à la dépouille de ce révolutionnaire libre penseur les rites d’une religion qu’il avait répudiée.
La sortie du 3 avril avait été une défaite sur tous les points. Au Petit-Bicêtre, les fédérés, conduits par Duval, ouvrier énergique, fondeur intelligent, mais général improvisé, s’étaient trouvés brusquement attaqués par les lignards de la brigade Derroja, surgis des bois de Villacoublay. Refoulés en désordre sur le plateau de Châtillon, ils avaient dû mettre bas les armes.
Parmi eux se trouvait Élisée Reclus, simple garde.
Un général versaillais apparut subitement. C’était Vinoy.
— Y a‑t-il des chefs parmi vous ? demanda-t-il.
Duval sortit des rangs et se nomma.
— Qu’auriez-vous fait de moi si vous m’aviez pris ? lui demanda l’ex-gouverneur de Paris.
— Je vous aurais fait fusiller ! répondit sans hésitation le révolutionnaire.
C’était son arrêt de mort. Duval s’adossa intrépidement à un mur, face au peloton d’exécution, et tomba au cri de : « Vive la Commune ! »
Son chef d’état-major et un autre officier fédéré, aussi crânes, partagèrent son sort.
Au centre, les fédérés, quoique moins malmenés, avaient dû se replier sur le fort d’Issy, après avoir échangé une vive fusillade avec un millier de gendarmes retranchés dans les villas crénelées du Bas-Meudon.
L’insuccès avait été complet. Les quelques républicains bourgeois qui siégeaient à la Commune, au milieu des révolutionnaires, donnèrent leur démission : les uns, comme Méline, parce qu’ils n’entendaient pas compromettre leur avenir politique dans une lutte défavorablement engagée ; les autres, comme Ranc, honnête jacobin, pour ne pas se laisser entraîner sur le terrain trop inquiétant pour eux d’une révolution sociale.
Cluseret avait été délégué au ministère de la Guerre. Il ne manquait ni d’idées, ni de courage, ni de métier : capitaine de mobiles en juin 1848, il s’était battu contre les insurgés, leur enlevant, à la tête de ses hommes, la barricade de la rue Saint-Jacques et recevant de ce fait le ruban rouge. Ayant quitté l’armée sous l’Empire, il avait émigré aux États-Unis et servi dans les forces fédérales pendant la guerre de Sécession, avec le grade de général de brigade. Au lendemain du 4 septembre, il avait paru un instant à Lyon, dans une éphémère tentative de Bakounine pour substituer au gouvernement bourgeois et unitaire une fédération d’organisations révolutionnaires.
Hélas ! si les généraux de l’Empire et de la Défense nationale n’avaient point brillé contre les Prussiens, les généraux de la Commune ne devaient pas être plus heureux contre les Versaillais !
Pourtant, à partir de la désastreuse journée du 3 avril, les bulletins officiels n’annonçaient guère que des victoires. Victoires à Issy, à Asnières, à Neuilly surtout. Ne soupçonnant pas, dans ma candeur juvénile, qu’un gouvernement populaire pût, tout comme un autre, mentir par raison d’État, je me disais : « Si cela continue, on finira tout de même par arriver à Versailles ! »
En attendant, l’armée de l’« ordre » grossissait de jour en jour, et le maréchal de Mac-Mahon en avait reçu le commandement. Le vaincu de Reichshoffen et de Sedan avait deux grandes défaites à effacer.
Les Versaillais, repoussés le 6 avril au pont de Neuilly, s’en emparent le 7, après avoir perdu les généraux Besson et Péchot. Le 11 et le 13, attaques contre le fort d’Issy, victorieusement déjouées, annonce-t-on. Mais ces attaques étaient surtout des canonnades furieuses qui, appuyées par des fusillades de tranchées, achevaient de démanteler le fort, terriblement éprouvé par le bombardement du premier siège. À la fin du mois, l’armée régulière l’encerclait presque, s’étant emparée des Moulineaux, du cimetière, du parc et du château d’Issy. Cette partie de la banlieue parisienne a, pendant de longues années, conservé les vestiges de la terrible tourmente de fer et de feu qui s’était abattue sur elle.
Le 30 avril, la garnison fédérée, aux ordres du blanquiste Mégy, voyant l’ennemi s’étendre sur sa droite, évacua cette ruine. Cluseret, averti, réunit en hâte quelques centaines d’hommes, les déploya en tirailleurs, marchant à leur tête, vêtu en civil, et, s’avançant à travers le parc, réoccupa le fort. Il était temps. Le délégué à la Guerre trouva un héroïque gamin qui, demeuré seul dans cet amas de décombres et de cadavres, attendait l’arrivée de l’ennemi près de la poudrière pour y mettre le feu. Cet épique gavroche s’appelait Dufour.
Comme dans toutes les révolutions, enfants et vieillards se montraient les plus intrépides : les premiers, enthousiastes et espérant tout ; les seconds, bronzés par les luttes de la vie et ne regrettant rien.
Ceux qui tombaient avaient de belles funérailles. Ils étaient conduits à leur dernière demeure sous les plis du drapeau rouge, au son de la Marche funèbre de Chopin, exécutée par les musiques fédérées. Des détachements de leur bataillon et des délégués de la Commune suivaient le corbillard et des discours vibrants d’une émotion sincère étaient prononcés sur leur tombe. Leurs veuves et leurs orphelins étaient adoptés par la Commune.
C’était impressionnant, d’un effet théâtral peut-être, mais sans le moindre cabotinage. On ne cabotinait pas avec la mort.
Si l’armée de Versailles se renforçait, celle de la Commune fondait à vue d’œil. Sur le papier, elle chiffrait 200.000 hommes, dont une moitié pour la garde nationale sédentaire, et l’autre pour les compagnies de guerre ; mais, en réalité, elle n’atteignait pas, pour les deux catégories réunies, la moitié de cet effectif. Les bataillons tombaient à trois cents hommes au maximum, les compagnies à moins de cinquante. Celle de mon père s’élevait à une trentaine de gardes.
Pour les esprits clairvoyants, la situation se dessinait : les bataillons fédérés qui n’avaient pas marché sur Versailles dès le lendemain du 18 mars, alors qu’ils avaient l’avantage matériel du nombre et l’avantage moral d’une première victoire, étaient maintenant, condamnés à l’impuissance devant une armée supérieure en organisation et, déjà, en nombre. Les rôles se trouvaient renversés.
Les Versaillais occupaient une partie de Neuilly, les communards l’autre. Les premiers étaient protégés par les feux plongeants du Mont-Valérien, en attendant l’établissement à Montretout d’une formidable batterie de soixante-dix pièces ; les seconds étaient appuyés par quelques canons de la porte-Maillot, dont les servants se montraient héroïques.
La situation des habitants de Neuilly, pris entre deux feux, était épouvantable : un ouragan ininterrompu de mitraille les emprisonnait dans les caves, sous des pans de murs croulants. Un armistice de vingt-quatre heures fut conclu, le 25 avril, pour leur permettre d’évacuer les ruines qui avaient été leurs maisons.
Entre le pont de Neuilly et la porte-Maillot, les combats faisaient rage. De la presqu’île de Gennevilliers, le feu des fédérés pouvait gêner les Versaillais ; une attaque de nuit enleva aux soldats de la Commune le château de Bécon. Poursuivant ce succès, l’armée régulière les rejeta sur Asnières, qu’elle occupa ensuite. Le pont resta au pouvoir des fédérés, défendu par deux locomotives blindées et armées.
La bourgeoisie républicaine redoutait à peu près également la victoire de la Commune, par peur d’une brusque transformation sociale, et celle de l’Assemblée nationale, par crainte d’une réaction monarchique. Des tentatives de conciliation entre Paris et Versailles s’ébauchaient, mais sans succès ; des démocrates radicaux, qui se jalonnaient, pour quelques-uns, une route à la députation, avaient formé une Union républicaine pour les droits de Paris, mais leur voix se perdait dans la bataille. D’ailleurs, ils n’avaient guère la confiance de la Commune, et encore bien moins la sympathie de l’Assemblée.
Parmi eux se trouvaient l’ancien maire du IIIe, Bonval et l’historien Maurice Lachâtre, Laurent Pichat, Mottu et trois députés démissionnaires : Clemenceau, Lockroy, Floquet.
Le mouvement du 18 mars avait eu pourtant son contrecoup en province ; Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Limoges, Narbonne s’étaient soulevées. Dans cette dernière cité, un ardent républicain, Émile Digeon, proscrit du 2 décembre et qui était destiné à devenir un des premiers propagandistes de l’anarchisme, avait organisé une défense énergique. Mais partout aussi l’insurrection avait été étouffée en peu de jours. L’avocat Gaston Crémieux, républicain enthousiaste et humanitaire, membre de l’éphémère Commune de Marseille, fut arrêté par ordre du général Espivent et déféré à un conseil de guerre. Il fut condamné à mort et fusillé, expiant son cri indigné de « Majorité rurale, honte de la France ! » qu’il avait lancé à l’Assemblée de Bordeaux, venant de huer Garibaldi.
Paris demeurait isolé, cependant que j’entendais chanter dans les rues, à peu près sur l’air de O Neptune, dieu des eaux :
Sauvez Paris, enfants de la province !
Avec ardeur, accourez à nos cris.
On nous mitraille et sous le joug d’un prince,
On veut nous mettre ! Ah ! secourez Paris !
(…)
Les ménestrels ambulants chantaient aussi une autre poésie, aussi folâtre que l’eussent pu être les prédictions du prophète Jérémie mises en vers avec musique. Le refrain en était :
Pauvre Paris ! tu verras bien des larmes
Si tes vieux murs ne sont pas engloutis !
D’autres poésies présentaient, à la vérité, des perspectives moins lugubres.
La génération de 1871 était autrement enthousiaste et sentimentale que celle qui est venue un demi-siècle plus perd. Réveillée de la torpeur où l’avait plongée le régime impérial, elle vibrait aux grands mots et s’épanchait en des effusions souvent naïves, toujours généreuses. Bon nombre de déportés que j’ai connus, quelques années plus tard, en Nouvelle-Calédonie, avaient leur cahier de chansons.
« — À en juger par l’histoire, me disait, en 1913, Alfred Naquet, les élans populaires de la Grande Révolution ont été sublimes. J’ai vu 48 ; c’était admirable. Il y avait dans le peuple un enthousiasme, un esprit de fraternité émouvants. 1871, c’était encore très bien. Mais maintenant ! » Les vieux sont souvent injustes en s’imaginant que l’époque qui les vit jeunes et pleins de sève l’emporte en beauté sur le temps de leur décrépitude. C’est excessif et humain, mais il semble bien que, dans les sociétés comme chez les individus qui les composent, l’esprit se développe et s’aigris au détriment du cœur. Celui-ci se dessèche au fur et à mesure que celui-là devient raisonneur, critique et acerbe.
Dès la fin d’avril, si les clairvoyants, mieux renseignés que la masse, envisageaient la défaite ; si la bourgeoisie, même républicaine, se détachait prudemment de la Commune, la ferveur révolutionnaire persistait dans la population des faubourgs. Les quelques décrets, nullement terrifiants, rendus sur les loyers, les échéances, la suppression des amendes et retenues de salaires, l’installation d’une école professionnelle — la première créée — dans l’établissement des Jésuites, rue des Postes, la pension promise aux veuves et aux orphelins de fédérés, amorce d’une transformation sociale, suffisaient, avec quelques prédications dans les clubs, pour maintenir une atmosphère révolutionnaire.
Les combattants, néanmoins, demeuraient une minorité. Il se rencontrait chez eux des héros, mais cette discipline rationnelle — que même les plus libertaires doivent, sous peine d’écrasement, se donner en temps de crise — disparaissait de plus en plus. Rossel, qui venait de remplacer Cluseret comme délégué à la Guerre et qui le resta huit jours, avait rêvé de faire de la garde nationale une armée régulière. Entreprise impossible !
Rossel était un jeune capitaine du génie, patriote jacobin et protestant, qui, s’échappant de Metz lors de la capitulation, avait été nommé par Gambetta lieutenant-colonel. Indigné de la signature de la paix, il était venu s’offrir à la Commune avec l’espoir que celle-ci, victorieuse, reprendrait la guerre contre l’Allemagne. Espoir d’un patriote sincère et aveugle, non dépourvu d’ambition, qui se croyait peut-être à même de jouer les Hoches… ou les Bonapartes.
Sa nomination fut saluée avec espoir, notamment par le Mot d’ordre, journal que faisait paraître Rochefort, démissionnaire de l’Assemblée de Versailles, et par le Père Duchesne, pamphlet hebdomadaire de Vermersch. Celui-ci, poète de grand talent, destiné à mourir dans la misère et dans l’oubli, avait ressuscité le journal d’Hébert avec la même langue faubourienne.
Malgré ces appuis, Rossel, républicain très bourgeois d’esprit, aux allures rigides, ne devait pas, tarder à se sentir fourvoyé dans ce bouillonnement populaire dégénérant en chaos, où ses ordres se perdaient.
Le 9 mai, le fort d’Issy, pulvérisé par les feux convergeant de Châtillon, Meudon, les Moulineaux et le Mont-Valérien, avait cessé toute résistance et ses occupants, presque cernés, s’étaient échappés dans la nuit. Paris ressentit une commotion en lisant cette fatale nouvelle que, dans un accès d’exaspération, Rossel venait de faire afficher :
« Le drapeau tricolore flotte sur le fort d’Issy, abandonné hier par sa garnison. »
C’était un premier tintement de glas : il devait être suivi d’autres.
Pendant l’agonie du fort d’Issy, le 160e bataillon sédentaire avait été de garde aux remparts du côté de la porte de Versailles. Puis il revint dans notre cinquième arrondissement. Quelques hommes manquaient, entre autres un sergent nommé Noël, de la compagnie de mon père. Ce fédéré, ferme et modeste républicain, qui, presque quinquagénaire, servait avec son fils la révolution communaliste, avait été envoyé du secteur avec un détachement pour escorter un convoi d’artillerie destiné au fort d’Issy.
Le détachement n’avait point reparu. On pouvait le supposer massacré, capturé ou bloqué dans la malheureuse citadelle. Car l’affiche décourageante de Rossel avait été suivie d’une autre annonçant, à la fois, la réoccupation du fort et l’incarcération du délégué à la guerre, remplacé par le vieux Delescluze.
Or, notre trio familial, se promenant près de la place Maubert, rencontra soudain le brave Noël.
Non sans quelque émotion il nous narra son odyssée.
Le convoi d’artillerie et le détachement d’escorte s’étaient trouvés soudainement attaqués par les Versaillais qui encerclaient le fort d’Issy, et ils avaient dû se replier en hâte sur celui de Vanves, à leur gauche.
À son tour, celui-ci avait succombé. Trois jours plus tard sa garnison l’évacuait par les souterrains.
Ces souterrains communiquaient avec les carrières de Montrouge. Sans doute formaient-ils un labyrinthe à plusieurs issues, car Noël s’était trouvé égaré dans les catacombes. Il venait enfin d’en sortir et, maintenant, rentré à la surface du sol, il allait simplement et bravement reprendre son service.
Mon père lui recommanda de ne pas ébruiter la décourageante nouvelle. Et moi, je réfléchissais que cette évacuation de deux forts jurait un peu avec les bulletins victorieux publiés par les journaux révolutionnaires.
Les deux forts du sud-ouest étant perdus, la Commune s’attendait à une attaque contre la partie de l’enceinte qui se trouvait, autant dire, à découvert. Toute la cinquième légion se porta vers le secteur menacé, le 160e bataillon occupant, en soutien, le collège des Jésuites de la rue de Vaugirard, à deux pas de la porte de Versailles.
La canonnade faisait rage. Son grondement ininterrompu emplissait notre quartier. Comme au 3 avril, les femmes des fédérés venaient, angoissées, nous demander des nouvelles. Mais, alors, c’était la Commune qui, prenant l’offensive, marchait sur Versailles, tandis que, maintenant, c’était l’armée régulière qui frappait aux portes de Paris !
L’anxiété des familles s’expliquait surabondamment.
Tout combattant est exposé à la mort ou à la capture ; mais, dans cette guerre particulièrement atroce, la capture équivalait souvent à la mort sommaire — le sort de Flourens, de Duval et de nombre de simples gardes nationaux passés par les armes, aussitôt pris, l’avait bien montré. Et ceux qui se trouvaient, réservés à la justice des conseils de guerre achetaient ce bonheur relatif en souffrant tous les sévices imaginables.
Les prisonniers qui défilaient, cortège lamentable, dans les rues de Versailles, sous les injures, les crachats et les coups de fêtards et de noceuses qui, transformées en furies, s’efforçaient de crever les yeux et de fouiller les blessures de la pointe de leur ombrelle. Puis, c’étaient toutes les étapes d’un interminable calvaire.
Les femmes prisonnières — des ambulancières de la Commune — étaient aussi maltraitées que les hommes, avec, en plus, les attentats d’une dépravation féroce : les soudards s’amusaient !
Élisée Reclus, qui fut fait prisonnier à Châtillon, rapporte qu’il entendit un lieutenant versaillais proférer à l’adresse d’une prisonnière cette menace inouïe « Il faudrait l’enc… avec un fer rouge ! »
Toutes les fureurs des terreurs blanches, autrement féroces que les terreurs rouges, grondaient à Versailles, la ville des rois. Malheur à Paris si, dans cette lutte sans pitié, Paris était vaincu !
Ma mère, sans être révolutionnaire d’opinions, était très courageuse. Elle décida, avec quelques femmes de fédérés, d’aller voir ce que devenait le 160e bataillon. Naturellement, je les accompagnai.
Nous partîmes donc, à une demi-douzaine, de la Montagne-Sainte-Geneviève, pressés d’arriver auprès des nôtres.
Cinquante-six ans se sont écoulés depuis ce jour. Plus d’un demi-siècle qu’ont empli des événements tumultueux et tragiques : la ruée féroce des Versaillais dans Paris, fusillades, incendies et massacres, le départ des déportés aux antipodes, l’insurrection des Canaques anthropophages de la Nouvelle-Calédonie, l’amnistie, le boulangisme, l’affaire Dreyfus, des procès politiques retentissants, la prison, l’exil, la Grande Guerre, épopée formidable, auprès de laquelle celle de 1870 n’était qu’un jeu. Toutes ces impressions, toutes ces images se gravant successivement sur la plaque sensible qu’est le cerveau, sembleraient ne plus devoir, par leur multiplicité, laisser qu’un souvenir confus. Et, cependant, je revois toujours notre caravane s’acheminant, le long de l’interminable rue de Vaugirard, vers la partie de l’enceinte battue par le feu versaillais.
Mais à mesure que nous avancions vers la zone s’étendant entre la gare Montparnasse et les Invalides, la voix du canon s’amplifiait : cette voix passait du grondement sourd au rugissement éclatant. En même temps, les premiers obus commençaient à traverser le ciel au-dessus de nos têtes. Obus perdus qui avaient dépassé la ligne fédérée et allaient fouiller dans les rues du 14e arrondissement, tuant au hasard.
Je vis que notre groupe avait diminué : plusieurs femmes avaient rebroussé chemin. Moins par peur, sans doute — car pendant les deux sièges j’ai vu les Parisiennes très braves — que parce qu’elles disaient, ces femmes de prolétaires ayant laissé des enfants chez elles, que leur devoir était de se conserver pour ces petites créatures dont le père n’allait peut-être pas revenir.
Nous n’étions plus que trois : ma mère, une autre femme de fédéré et moi, lorsque nous atteignîmes l’immense bâtiment occupé par les bataillons de la 5e légion. Les gardes nationaux étaient surpris de nous voir arriver et mon père jeta les hauts cris, nous reprochant de nous être exposés sans nécessité.
Nous allions et venions à travers la cour et les corridors. Une impression, chez moi domina toutes les autres : ce fut de voir, dans les locaux, le sol jonché de feuillets arrachés à des volumes. La bibliothèque des révérends pères avait été saccagée, et, à en juger par ses débris épars, elle devait être assez nourrie. Cette vue me fit mal : j’avais eu de très bonne heure la passion des livres.
Pendant que nous étions là, sous les obus, les Versaillais, qui venaient de s’emparer du lycée de Vanves, y installaient de nouvelles pièces, destinées à rendre intenable le secteur Vaugirard-Grenelle, comme l’était déjà le secteur Point-du-Jour-Auteuil, et, de son côté, la Commune, dont les jours étaient comptés, abattait la colonne Vendôme.
Le 12 avril, elle avait rendu ce décret :
« La Commune de Paris, considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brutale et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République française, la fraternité, décrète :
« Article unique. — la colonne de la place Vendôme sera démolie. »
J’eus le regret de n’avoir pu assister à ce spectacle, doublé d’une haute leçon de morale sociale. Si mon imagination et mon sang sicilien me faisaient adorer les aventures épiques, mon amour passionné de la liberté et un sentimentalisme humanitaire, que je tenais sans doute de ma mère, m’inspiraient l’aversion du militarisme impérieux et brutal. Je dois pourtant confesser que, à l’âge de deux ans, au moment où Palestro, Magenta et Solferino semblaient devoir assurer la complète libération de l’Italie, j’avais été revêtu d’un petit costume de zouave ! Les zouaves étaient populaires et mon grand-père, à cette occasion, avait acquiescé au désir de mes grands-parents de me voir porter l’uniforme des vainqueurs de Palestro.
Une autre fois, au jardin du Luxembourg, où me conduisait ma mère, faisant ma partie dans une bande d’enfants qui s’étaient mis à jouer aux soldats, j’avais été placé par eux en sentinelle près d’une porte, avec la stricte consigne d’attendre la relève. Deux heures s’écoulèrent et la relève n’arrivait pas. Stoïque, je demeurais à mon poste, considérant comme ignominieux de déserter.
Feu Scribe n’a‑t-il pas écrit :
Un vieux soldat doit souffrir et se taire
Sans murmurer.
Ce fut ma mère qui arriva. Affolée de ma disparition, elle m’avait cherché en vain dans toutes les allées. Mais le Luxembourg est vaste et mes camarades occasionnels m’avaient — les garnements ! — amené à l’extérieur des grilles, assez loin de l’endroit où s’était assise ma mère. Celle-ci fondit sur moi comme une tigresse ou plutôt comme une chatte qui retrouve ses petits égarés. Elle m’entraîna malgré ma résistance, car je me trouvais déshonoré d’abandonner mon poste. Mais elle ne voulut rien entendre.
J’avais alors près de dix ans. À l’heure où j’écris ces lignes, j’en ai soixante-neuf, et j’ai pu me convaincre que les hommes, plus encore que les enfants, oublient volontiers ceux qui observent la consigne convenue. Cependant, je n’ai jamais regretté d’avoir toujours à travers les vicissitudes de la vie, et dans des occasions graves, agi comme le jour où, enfant, j’étais sentinelle oubliée, au jardin du Luxembourg.
Avec tout cela, je ne vis pas tomber la colonne, aux acclamations de la foule, laquelle, du reste, applaudit tous les spectacles. À cette exécution du despote de bronze assistait un ancien membre du gouvernement du 4 septembre, Glais-Bizoin, républicain bourgeois mais indépendant et antinapoléonien fervent,
La réponse de Versailles eut lieu le lendemain, 17 mai : ce fut l’explosion de la cartoucherie Rapp.
Explosion formidable, dont le bruit fut entendu de tout Paris. Quatre maisons voisines s’écroulèrent, ensevelissant sous leurs décombres quarante victimes. Au premier moment on en annonça deux cents2Il semble que les ouvrières, ou une partie d’entre elles, aient été congédiées plus tôt que d’habitude, ce qui appuie la probabilité d’un complot versaillais..
Un frémissement d’horreur courut dans la masse.
La Commune, pour donner satisfaction à l’opinion publique, se hâta d’annoncer l’arrestation de quatre des auteurs de l’attentat, la découverte — un peu tardive — du complot et l’ouverture d’une enquête.
Mais cette enquête ne devait jamais avoir lieu : l’agonie de la Commune allait commencer.
- 1« C’est moi ! » Textuellement « je suis moi » (Sono io.)
- 2Il semble que les ouvrières, ou une partie d’entre elles, aient été congédiées plus tôt que d’habitude, ce qui appuie la probabilité d’un complot versaillais.