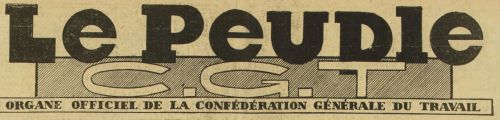I
Avant le dernier voyage. — Odyssée paternelle en Italie. — L’Immigration révolutionnaire à Paris.
Quand on est arrivé à la septentaine, après avoir subi les vicissitudes d’une existence passablement cahotée, il est sage de se préparer au dernier voyage, celui dont nul explorateur, s’appela-t-il Christophe Colomb, Cook ou Stanley, n’est revenu.
C’est mon cas.
Avant que les lèvres ne se closent pour de bon, il vous prend quelquefois l’envie de bavarder. À force d’avoir vu les humains et traversé les événements, on se sent le besoin de dire un mot final – fût-ce celui de Cambronne – en quittant le théâtre de la vie.
On estimait naguère que la durée normale de l’existence humaine ne pouvait être évaluée à soixante-dix ans, et il semble aujourd’hui, d’après des statistiques, que cette limite doive être reculée par suite des transformations sociales dont l’influence sur la longévité est indéniable. Exception faite pour les malheureux que la misère, le surtravail et les peines fauchent prématurément, ou que les ambitions des dirigeants condamnent à laisser leurs os sur un champ de bataille, cette longévité tend d’une façon générale à augmenter. Sans doute même un jour viendra-t-il où, par l’universalisation du bien-être et de l’hygiène dans une société sensiblement évoluée, la légende de Mathusalem pourra devenir une réalité. Après tout, ce patriarche neuf fois séculaire, qui n’a probablement jamais existé, sauf dans l’Histoire Sainte, ne comptait apparemment que neuf cent et quelques lunes, et non neuf cent années solaires, ce qui fait de lui un simple gamin, même pas octogénaire.
Ce fut le 7 septembre 1857, vers 11 heures du soir, que je fis mon entré dans ce monde inharmonique. La commune de Foug (Meurthe), dans laquelle je vis la lumière des lampes, ne fut aucunement révolutionnée par ma naissance, et ma première enfance me vit accomplir les mêmes gestes que tous les mioches de mon âge.
À dix-huit mois commencèrent mes voyages. Je quittais la Lorraine avant de l’avoir connue, emmené à Paris, villa Montmorency, à deux pas du bois de Boulogne. Dans ce cadre de paix et de plein air s’écoulèrent mes premières années, entre mes parents et mes grands-parents maternels.
Aujourd’hui, au bout de trois-quarts de siècle, je revois encore notre demeure familiale, très simple, et les figures des êtres chers qui m’entouraient.
Mon père avait une vie passablement mouvementée. Né en Sicile, à Trapani, l’antique Drepanon des Grecs, il présentait au physique le plus pur type… anglo-normand : chair d’une blancheur laiteuse, yeux d’un bleu profond, poil blond ardent. Aussi maintes fois lui arrivait-il d’être salué en anglais, ce qui le faisait sourire, le seul mot qu’il eût retenu de la langue de Shakespeare étant Yes. Mais lorsqu’il ouvrait la bouche, son accent qu’il garda sicilien jusqu’à la mort, démentait aussitôt ce masque septentrional. Et sa voix prompte à tonner, éclater, rugir, rappelait l’Etna dans ses grands jours d’éruption.
Par le même contraste bizarre, ma mère, Lorraine de naissance comme d’hérédité, avec ses cheveux noirs et ses yeux bruns, pensifs et doux, éclairant un beau visage ovale, ressemblait bien plus à une Espagnole du type classique peint par Joanez qu’à une femme du Nord. Elle possédait le cœur le plus généreux un grand courage physique et moral, qui devait lui faire supporter stoïquement angoisses et souffrances. Elle eût bravé la mort sans la moindre pose – cela lui arriva par la suite – mais elle se fût enfuie devant une souris.
D’ailleurs n’est-ce pas le rôle de la souris de servir de jouet au chat et d’épouvantail aux femmes ?
Le lecteur m’excusera de m’étendre aussi longuement, au début de ces Mémoires, sur ceux qui m’ont communiqué avec leur sang un peu de leur âme. Je n’entends point l’importuner de mes faits et gestes de bambin. Mes parents, au contraire, se rattachaient à un monde dont l’étude rétrospective n’est pas sans intérêt.
Mon père avait pour oncle le marquis del Carretto, omnipotent ministre du roi Ferdinand ii, dit Bomba, et qui a laissé dans l’histoire des Deux-Siciles un nom tristement célèbre d’implacable réacteur. De plus, il avait été élevé dans un séminaire et, la vocation lui faisant entièrement défaut, gratifié d’un brevet de capitaine de gendarmerie.
C’est dire que rien ne semblait le prédisposer à aller à la Révolution. Rien, sauf son tempérament et l’amour de la liberté. Au grand désespoir de son aristocratique famille, il préféra le rôle d’insurgé à celui de défenseur du trône et de l’autel ; il s’affilia à la Jeune Italie, organisée par le génie conspirateur de Mazzini, et tira sur les gendarmes royaux au lieu de les commander.
Il se battit contre Ferdinand ii, d’abord en Sicile, contribuant à la chute de Del Carretto, puis à Naples, recevant au front un superbe coup de sabre du major Pignatelli, lorsque le roi, qui avait du – la mort dans l’âme – promulguer une Constitution, eut trouvé le moyen de rétablir son absolutisme par un coup de force. Fait prisonnier sur une barricade de la via Santa Brigitta, il s’évada, grâce au concours d’un officier jadis l’obligé de la famille. Pendant qu’on le condamnait à mort par contumace. Il courut sans s’arrêter se battre à Livourne contre le grand duc de Toscane, puis alla joindre à Rome les défenseurs de la République. Pauvre république, glorieuse et éphémère, qu’assaillaient Français, Napolitains, Autrichiens et Espagnols, transformés en soldats du Pape !
Fait de nouveau prisonnier lors de l’entrée des troupes d’Oudinot dans la Ville Éternelle, il fut livré à la justice de Ferdinand II et interné dans la forteresse de Frusinone. C’étair le peloton d’exécution ; il lui échappa, s’évadant encore, cette fois dans une caisse que des mains amies avaient préparée et légèrement percée de trous. Précaution urgente, car la mort par asphyxie n’eût pas mieux valu que celle sous les balles.
Après quoi, mon père, sortant de cette demeure salvatrice mais incommode avait gagné le Piémont, seul État de l’Italie où, dans le naufrage de la révolution, surnageât un peu de liberté. Puis la France, un instant Londres où il ne put s’acclimater, et de nouveau Paris.
Là, il s’était retrouvé avec tout un flot de révolutionnaires cosmopolites, dont d’aucuns sont devenus par la suite de hauts personnages. Les jours se suivent et, bien souvent, ne se ressemblent pas… tout au moins pour ceux des acteurs qui changent de rôle.
Parmi ces exilés que, plus tard, mon enfance a entrevue et dont, sans me rappeler leur visage, je devais retenir les noms, se trouvaient – Siciliens comme mon père : Crispi, Carnazza, Carini, Friscia, pour lesquels la destinée n’avait pas dit son ultime mot.
Le premier, adjurant son républicanisme et sa devise : <i[[« Maintenant et toujours ».]], allait devenir un jour le ministre mégalomane et francophobe, aussi autocratique que Del Carretto, le précurseur de Mussolini. Il n’était pas riche dans son exil, et mon père plus argenté se fit maintes fois un devoir de solidarité de le renipper – il le regretta par la suite. Crispi, à son arrivée au pouvoir, aux honneurs et aux richesses, s’empressa de mettre les bouchées doubles.
On sait que ce personnage devint bigame, ce qui lui fut fort reproché lorsque, par la suite, il se trouva dictateur de l’Italie. Ce fut pourtant un de ses moindres méfaits. Un jour, mon père eut à intervenir très sérieusement pour empêcher qu’il fût écharpé par ses deux femmes : l’une Napolitaine, l’autre Savoyarde, qui rivalisaient de fureur.
Carnazza était un des plus aimables familiers de notre maison. Échappé, comme mon père, aux fusillades bourboniennes, il allait, au lendemain de la victoire unitaire, occuper un poste élevé dans la magistrature, prononçant à son tour, sur le sort des pauvres diables. Mon enfance lui a dû un superbe polichinelle et des friandises envoyées de Naples, à son retour triomphal dans les Deux-Siciles.
Carini, considéré comme assez médiocre combattant, devait soudainement se révéler héroïque dans la fameuse expédition des Mille. Il y trouva la gloire et y perdit un bras
Quant à Friscia, qui participa, lui aussi, à cette épopée garibaldienne, il fut élu député. Il siégea à l’extrême-gauche du Parlement italien, avec Fanelli. Tous deux étaient amis intimes du célèbre Bakounine, dont ils avaient épousé l’anarchisme.
Il convient de dire que leur mandat ne rapporta aucun profit matériel à ces intransigeants, qui crurent servir la propagande de leurs idées par leur présence au Parlement de l’Italie unifiée : les représentants ne percevaient pas de traitement.
Anarchiste aussi était Carlo Piscane, le futur martyr de Capri, que Victor Hugo proclama « plus grand que Garibaldi ». Ce n’était pas la République dure et orgueilleuse de l’ancienne Rome qu’il entrevoyait dans son rêve généreux, mais la République sociale et libertaire de l’avenir.
Combien cet anarchisme différait de ce que, plus tard, certains sans scrupules ont osé présenter sous le même nom ! L’anarchisme, selon la façon dont il est interprété, peut être ce qu’il y a de plus beau ou ce qu’il y a de pire.
Montanelli et Orsini – celui-là toscan, celui-ci Romagnol – étaient aussi de grands amis de mon père. Ils devaient mourir : le premier député (1862), le second sur l’échafaud après un attentat contre Napoléon iii (1858). Bifurcation des destinées !
Montanelli, avocat et écrivain de valeur, successivement président du Conseil des ministres de Toscane et… forçat par contumace après le rétablissement du grand-duc, demeurait près du boulevard des Italiens (était-ce par patriotisme?), rue Favart, je crois. Un jour, il avait invité à dîner plusieurs amis, dont mon père, qui l’avait proclamé triumvir à Livourne, et auquel, récemment emménagé, il donna naturellement son adresse.
Ponctuellement, à l’heure dite, mon père se présenta rue Favart et s’enquit de l’étage ou demeurait son ami Montanelli.
Le concierge nia catégoriquement avoir dans sa maison un locataire de ce nom. Après avoir insisté inutilement, mon père dut se retirer, pensant qu’une erreur d’adresse avait été commise par l’un ou par l’autre.
Peu de temps après, il rencontra Montanelli, qui lui adressa des reproches :
– Nous t’avons attendu pendant une heure avant de nous mettre à table, lui dit l’ex-triumvir.
– Comment ! s’exclama mon père, mais je me suis rendu à l’adresse que tu m’avais donnée et le concierge ne te connaissait pas !
Stupeur réciproque. Puis frappé d’un soupçon, l’amphitryon interrogea :
– Comment m’as-tu demandé ?
– Eh ! mais monsieur Môn-ta-nell’
– Malheureux ! Tu devais dire Mon-ta-nellî.
À cette époque mon père baragouinait à peine quelques mots de français, et il avait prononcé à l’italienne – pis que cela : avec un formidable accent sicilien.
Les éléments bourgeois et même aristocratiques étaient plus nombreux dans l’émigration italienne que les éléments populaires. Cela se comprend. Dans toute la péninsule, et principalement dans le royaume des Deux-Siciles, la plèbe – surtout agricole – vivait dans un état de misère et d’ignorance qui la tenait à mille lieues des enthousiasmes d’idées et des luttes politiques. Seule la classe aisée et instruite pouvait se donner le luxe de penser.
Les Bourbons de Naples, comme ceux de Madrid, disaient : « Notre peuple n’a pas besoin de savoir lire », et ils voyaient sans déplaisir l’existence du banditisme. Les brigands ne valent pas toujours mieux que les honnêtes gens. Moins hypocrites que ceux-ci en général, ils comptent souvent des éléments très mêlés : fiers réfractaires, redresseurs de torts ou autocrates rapaces et cruels. En Espagne, c’étaient des brigands, mêlés aux fanatiques paysans de Biscaye, qui avaient massacrés les libéraux des villes au cri de : « Vivent les chaîne ! » En Calabre, des brigands notoires, comme Fra Diavolo et Mammone, avaient reçu le brevet de colonel dans l’armée sanfédiste du cardinal Ruffo, allant égorger l’éphémère République parthénopéenne.
Dans cette même Calabre s’exerçait en grand, au plein milieu du dix-neuvième siècle, la traite des enfants. Les miséreux paysans, chefs de familles nombreuses, vendaient à d’âpres trafiquants leurs bambins âgés de six ans, dressés aussitôt à racler du violon, chanter et mendier, pour devenir plus tard marchand de statuettes, modèles ou n’importe quoi. Ces malheureux pifferari couchaient sur des grabats pouilleux, entassés dans une lamentable promiscuité ; ils étaient nourris dérisoirement, sauf lorsqu’ils ne l’étaient pas du tout, ayant rapporté à leur patron une recette insuffisante. Jeûne forcé par lequel le négrier compensait sa perte et qu’on appelait une mise aux « pleureurs ». Quand la recette était tout à fait négative, les petits martyrs passaient dans la catégorie des « estropiés », c’est-à-dire étaient battus comme plâtre.
Cette traite blanche, contre laquelle des journaux avaient maintes fois protesté, devait se prolonger jusqu’à la guerre de 1870. Dans le quartier saint-Victor, à cette époque peuplé d’Italiens pauvres, on voyait, pittoresques malgré leur misère, dans leur costume rapiécé, des pifferari, aux yeux brillants, souvent de fièvre.