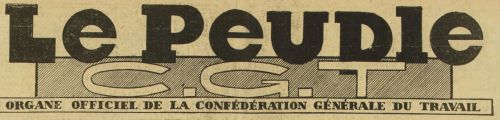VII
Le lendemain du 4 septembre.
Les gens de l’Hôtel de Ville, à l’exception d’une infime minorité, cherchaient déjà leur appui dans la bourgeoisie, se défiant du même peuple qui les avait envoyés au Parlement, d’où ils venaient de se jucher au pouvoir. Ernest Picard, dont le journal l’Électeur libre, avait coquété avec l’Empire ; Jules Favre, Jules Ferry, politiciens aspirant au rôle d’hommes d’État, qui ne connaissaient le peuple qu’aux jours d’élection ; Jules Simon, dont le bagage sociologique se bornait à un livre littéraire, L’Ouvrière, et qui avait poussé une reconnaissance rapide sur l’Internationale, pour se replier aussitôt dans le camp de la démocratie bourgeoise, n’avaient rien de commun avec ces grands passionnés qui épousent la cause de la masse miséreuse et lui sacrifient leur existence. Leurs collègues Garnier-Pagès et Glais-Bizoin, assez indépendants, manquaient de sève et de prestige. Eugène Pelletan, avec de bonnes intentions, demeurait effacé. Quant au général Trochu, gouverneur de Paris et président du nouveau gouvernement, orléaniste — ce qui ne l’avait pas empêché de servir l’Empire — et, avant tout, clérical, il se préparait à placer Paris sous la protection de sainte Geneviève, piètre moyen de défense contre les krupps prussiens !
Rochefort et Gambetta, par contre, inspiraient confiance. Mais ce dernier partit en ballon le 8 octobre, pour rejoindre à Tours Glais-Bizooin, Crémieux et l’amiral Fourichon, chargés d’organiser la défense en province. Départ qui fut salué comme un envoi vers l’espérance et la victoire ! Dès lors, le pamphlétaire se trouva majorisé par ses collègues qui s’empressèrent de l’annihiler dans les fonctions dérisoires de directeur des barricades. Des barricades ! À quoi eussent-elles servi contre un ennemi devenu maître des forts et de la première enceinte ?
Il serait injuste de ranger dans cette majorité d’impuissants, plus effrayés de la possibilité d’une République sociale que du triomphe de la Prusse, faisant la loi à l’Europe, Dorian, ministre des Travaux publics. Lui, prit son rôle au sérieux, se surmena pour organiser des fonderies de cannons et, finalement mourut à la tâche.
Ces canons, c’était le peuple de Paris qui les payait de ses gros sous. Dans les journaux et partout des souscriptions s’ouvraient.
L’élan pour la défense était unanime. Dans les journaux les plus avancés, dans ceux qui existaient déjà comme Le Rappel et Le Réveil, dans ceux qui avaient surgi, comme Le Combat de Félix Pyat, et La Patrie en danger, de Blanqui, on prêchait l’union sous le drapeau de la République française.
Et, pourtant, les vétérans de la démocratie sociale et révolutionnaire, ceux qui avaient vu Juin 48 et le 2 Décembre, ne pouvaient guère se faire d’illusions sur les hommes de l’Hôtel de Ville. Les proscrits de l’Empire, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Edgard Quinet, Schœlcher, Victor Hugo, étaient rentrés, auréolés de prestige, certes, mais vieillis, ayant épuisé toute leur sève. Victor Hugo qui, maintenant, rehaussait sa gloire littéraire en arborant le képi de garde national, demeurait Olympio, le poète superbe des Châtiments et de la Légende des Siècles ; mais ce n’étaient pas avec des strophes, si enflammées fussent-elles, qu’on eut pu dominer la situation.
Je faisais ma nourriture spirituelle des journaux qu’achetait mon père. Chaque jour je dégustais successivement Vacquerie, Félix Pyat, Delescluze et Blanqui. Malgré mon imagination très sicilienne, portée aux choses peu ordinaires, mes treize ans ne laissaient pas de s’étonner lorsque je voyais Le Combat ouvrir une souscription pour le don d’un fusil d’honneur à celui qui tuerait le roi de Prusse. Comme si les monarques de nos jours exposaient leur précieuse peau sur les champs de bataille ?
Cependant, si Félix Pyat ciselait avec un soin d’artiste les phrases grandiloquentes et sonores, se montrant romantique en politique comme en littérature, son journal, durant le premier siège, donna toujours la bonne note. Celle que donnaient en langage clair, vigoureux et pathétique, Le Réveil et La Patrie en danger. Dans ce dernier journal, Blanqui montrait avec une remarquable science militaire, bien supérieure à celle des officiers de salon du Second Empire et du sacristain Trochu, les moyens de défense que possédait Paris.
Ces moyens étaient immenses. Outre la garnison de la capitale, à laquelle étaient venus s’adjoindre les 35.000 hommes du corps Vinoy, non englobés dans le désastre de Sedan, 16.000 marins répartis dans les forts couvrant Paris, 50.000 gardes mobiles de la Seine, plus de 100.000 mobiles des autres départements et la garde nationale.
La garde nationale, c’était tout le peuple de Paris et non plus une petite phalange de boutiquiers.
Dès la proclamation de la République, mon père, retrouvant ses ardeurs de jeunesse révolutionnaire — l’avaient-elles jamais quitté ? — s’était enrôlé dans cette milice citoyenne : simple garde au 160e bataillon. De même, les autres étrangers habitant Paris se faisaient un devoir de concourir à la défense.
Force populaire qui dans ses deux catégories : les bataillons de marche et les sédentaires, pouvait, au bas mot, chiffrer 300.000 hommes1Exactement, d’après les statistiques, 313.000..
À qui ferait-on croire que, sur plus de 300.000 hommes vivant dans l’atmosphère électrisée de Paris, on n’en eût pas pu trouver au moins 100.000 capables de s’ajouter efficacement en ligne de bataille à la garde mobile et aux réguliers ? Soit environ 400.000 bons combattants à opposer aux Allemands qui, devant Paris, ne furent le plus souvent que 120.000 et jamais plus de 180.000.
Les Allemands, eux, s’approchaient. Dès le lendemain du 4 septembre, alors que la population frémissante d’enthousiasme et sûre que la Troisième République allait renouveler les miracles de la première, se préparait stoïquement à la lutte, des trains bondés emportaient loin de la capitale des troupeaux affolés de fuyards. Riches privilégiés, oisifs, indolentes poupées, noceurs et noceuses pour lesquels les dix-huit ans de régime impérial n’avaient été qu’une fête ininterrompue, s’envolaient de ce Paris prêt à se transformer de ville de plaisir en camp retranché.
Je devais revoir le même exode quarante-quatre ans plus tard !
Tandis que la bourgeoisie dorée s’enfuyait, le peuple restait : il ne possédait que sa vie et ne craignait pas de la perdre.
En hâte, le gouvernement faisait rentrer dans Paris des troupeaux, des approvisionnements. Il n’y avait pas de temps à gaspiller. Chaque jour, devant l’avance prussienne, les communications de la capitale avec la province diminuaient : le cercle se resserrait.
Le 11 septembre, les Allemands entraient à Meaux.
Personne, dans la population, ne supposait que le siège de Paris pût être de longue durée. Mes parents s’étaient approvisionnés pour un mois : cet approvisionnement ne devait être qu’un déjeuner de soleil, si l’on peut dire. Au premier étage de notre maison nous avions pour voisins une famille très sympathique et que le malheur des temps rendait peu fortunée. Nous partageâmes fraternellement avec elle ces denrées alimentaires, qui consistaient surtout en pâtes, farine et légumes secs (les conserves étaient encore choses insoupçonnées). Aussi lesdites denrées ne furent-elles bientôt qu’un souvenir.
Cette famille Chamois comptait quatre personnes : un mari, jeune encore, lieutenant dans l’armée de Paris, d’esprit indépendant et socialiste, sa femme, sa mère et une charmante fillette, moins âgée que moi de quelques années. Nos balcons se touchaient, séparés seulement par des barreaux à travers lesquels les mains pouvaient s’unir. Je n’avais pas lu Roméo et Juliette, mais je sentais confusément s’ébaucher une idylle précoce au milieu de la tragédie des événements.
Petite Hélène, qu’êtes vous devenue depuis plus d’un demi-siècle ? Dans la succession des soucis ou des drames de la vie, vous êtes-vous rappelé quelquefois votre voisin de l’Année terrible ? Êtes-vous encore de ce monde ?
Le premier combat livré devant Paris eut lieu le 19 septembre. L’armée prussienne se dirigeant au sud-ouest, sur Versailles, pour en faire sa base d’opérations, déboucha brusquement sur le plateau de Châtillon occupé par des lignards et des zouaves. Ceux-ci, jeunes recrues qui n’avaient rien de commun avec les « chacals » d’Afrique, prirent peur et se débandèrent. La redoute ébauchée du plateau qui domine la capitale se trouva, sans coup férir, au pouvoir des Allemands, qui ne perdirent point de temps pour y établir des batteries. Ce furent ces krupps qui, après s’être acharnés sur les forts du sud, bombardèrent Paris, faisant pleuvoir leurs obus de préférence sur notre 5e arrondissement : le dôme du Panthéon était pour eux un admirable point de mire.
La débandade des zouaves indigna et exaspéra. Ces fuyards déshonoraient un corps à la réputation légendaire ! Un grand nombre d’entre eux furent arrêtés aux portes de Paris par les gardes nationaux, qui eurent à les protéger contre la colère de la population. Je me rappelle avoir vu, place de la Concorde, quelques lignards qui avaient cédé à la panique et qu’on emmenait prisonniers à la place, le képi et la tunique retournés, un écriteau infamant placardé sur la poitrine. Pauvres gens ! Ont-ils été fusillés pour avoir cédé à un irrésistible instinct de conservation ?
Je n’ai pas, ici, à décrire les opérations militaires du siège de Paris. Hélas ! elles furent, du côté des chefs de la défense nationale (qui ne surent rien défendre), si dérisoires que même un garçonnet de treize ans était forcé d’en apercevoir l’insuffisance et le décousu.
On peut dire que toute la population parisienne, femmes, enfants, vieillards, comme adultes, n’avait qu’une âme pour résister. Un journal publia, une fois, un article signé Henri Bauer, qui m’enthousiasma. L’écrivain, tout jeune alors, auquel l’avenir préparait des vicissitudes politiques et une notoriété littéraire ; préconisait la formation d’un corps de volontaires de douze à quinze ans. J’en avais treize, tout récemment sonnés : je voulus aussitôt m’enrôler parmi ces guerriers imberbes.
Le corps en question ne vit pas le jour. Mon père calma mes regrets en m’annonçant que Garibaldi, qui venait mettre son épée à la disposition de la République française, ferait appel à des volontaires, sans trop se montrer exigeant sur l’âge. Avec le héros de Marsala pour chef, mes visées épiques seraient évidemment comblées.
Par malheur pour moi, Garibaldi, débarqué à Marseille, ne vint pas à Paris. Gambetta l’envoya dans l’Est où, avec ses deux fils, Menotti et Ricciotti, son gendre Canzio et un noyau de « chemises rouges », renforcés de quelques corps francs, le général populaire, haï des généraux de sacristie, créa la petite armée des Vosges, qui couvrit la Bourgogne.
Je n’avais pas eu besoin de respirer l’atmosphère surchauffée d’une capitale assiégée pour sentir s’éveiller en moi des effervescences épiques. Dès l’enfance, mon imagination sicilienne s’enflamma pour les héros antiques et les paladins. Le pieux Énée (je n’avais encore lu Virgile que traduit en vers français par Delille) me faisait bâiller, certes, mais Diomède et Renaud de Montauban demeuraient mes grands favoris. Aimant passionnément la lecture, je dévorais dans leurs traductions l’Iliade, l’Odyssée, Roland furieux, la Jérusalem délivrée. Quant au Paradis perdu, je lui préférais nettement les romans de Paul de Kock. Toute ma vie, d’ailleurs, j’ai ressenti le besoin d’une diversité d’impression et, plus tard, je n’ai pu écrire une œuvre sérieuse sans être poussé aussitôt à en écrire une autre de caractère humoristique. Tension et détente !
Cet amour de l’épopée et des aventures contrastait chez moi bizarrement avec une timidité excessive.
Comme don Quichotte, mon illustre prédécesseur, je fusse parti, les yeux bandés, pour un monde inconnu en traversant des zones enflammées, mais dans une société de grandes personnes je demeurais immobile, sans oser ouvrir la bouche, et l’obligation d’adresser la parole à une dame m’eût fait défaillir. Cette timidité, fruit d’une éducation en serre chaude, m’a poursuivi jusqu’à la vieillesse et m’a été souvent bien préjudiciable.
C’est que mes parents, antérieurement à ma naissance, avaient perdu deux enfants en bas âge, tués par le croup, maladie alors réputée inguérissable. Seul rejeton , je vis concentrer sur moi toutes les sollicitudes : on ne me laissait pas traverser seul la rue de peur qu’il ne m’arrivât quelque accident, alors que je rêvais voyager autour du monde, explorations audacieuses dans des contrées inaccessibles, peuplées de cannibales.
Dès cette époque, le capitaine Mayne-Reid, avec les innombrables romans de sa série Aventures de Terre et de Mer, était mon auteur habituel. Je le préférais à Jules Verne, qui allait devenir l’idole des adolescents, mais dont l’intéressante vulgarisation scientifique n’est pas souvent accompagnée de la chaleur et du sentiment qu’on rencontre dans La piste de guerre ou dans Les Chasseurs de chevelures. Le capitaine Meyne-Reid, de son vrai nom Thomas Meyne, avait rompu avec sa famille, qui voulait faire de lui un homme d’église et était parti dans le Nouveau-Monde mener la vie d’aventures qui m’eût tenté.
J’avais aussi commencé à lire les ouvrages d’Erckmamm-Chatrian, dont la série allait se poursuivre avec un succès grandissant.
Tout le monde, à ce moment, croyait, comme moi, que ce double nom était celui d’un seul auteur. Grand fut l’étonnement lorsqu’on apprit, quelque vingt ans plus tard, que les écrivains qui avaient si bien mêlé leur personnalité étaient deux et qu’un conflit d’intérêts venait de les dissocier !
Ma mémoire était extraordinaire et elle est restée plus que grande jusqu’à la vieillesse, bien que la fièvre typhoïde, contractée au sortir du siège, l’ait un peu atténuée. J’adorais la lecture et y consacrais non seulement tous mes loisirs diurnes, mais encore une partie de la nuit, ne me couchant pas sans avoir sous mon oreiller deux ou trois livres que, malgré les défenses paternelles, je m’efforçais de lire une fois les lumières éteintes. Comment n’ai-je pas perdu la vue !
Mémoire, imagination, amour de l’aventure, tels étaient, avec mon insurmontable timidité, les principaux traits de mon caractère. J’avais treize ans, l’âge où la personnalité se forme, et mes parents étaient aux aguets pour tâcher de découvrir en moi une vocation qu’ils n’eussent pas voulu contrarier.
Une vocation ! Tout d’abord, je m’étais cru destiné à faire un peintre ! Mânes de Raphaël et du Titien, excusez cette prétention ! Combien de rames de papier n’ai-je pas couvertes de mes aquarelles multicolores ! Mon père me donna un professeur de dessin qui, d’abord, admira ma facilité et, ensuite, se montra scandalisé de l’audace avec laquelle je me permettais de chercher à animer les modèles majestueux et froids qu’il me donnait à copier. Le digne homme ne comprenait que l’art classique !
Si j’eusse persévéré dans cette voie, sans doute eussé-je fait un peintre quelconque, dont nul Charles-Quint ne fût venu ramasser le pinceau, ou, donnant libre cours à mon originalité, un remarquable caricaturiste. Mais ma destinée n’était pas là : l’homme propose, les événements disposent !
Plus tard, je me crus appelé à devenir médecin, comme ceux de mes ascendants maternels qui n’étaient point entrés dans la carrière professorale.
Sans doute aurais-je été capable de tuer mes malades tout aussi proprement qu’un autre morticole, mais en oubliant de réclamer des honoraires, car j’étais distrait et non avide. Très heureusement pour eux et pour moi cette éventualité non plus ne devait pas se réaliser.
D’ailleurs, ce n’était pas précisément le désir de guérir des catarrhes ou des hémorroïdes qui m’attirait vers la médecine. À cette époque où la psychophysiologie était encore une science embryonnaire, à peine entrevue d’un petit nombre de chercheurs, j’eusse voulu étudier aussi à fond que possible les phénomènes troublants, parfaitement naturels, certes, mais aux causes inconnues, qui sortaient de l’ordinaire et qui, niés de parti pris par d’aucuns, étaient trop souvent déformés par des simples ou exploités par des charlatans. N’y avait-il pas là tout un monde inconnu à explorer ?
Cette exploration, combien j’eusse voulu l’entreprendre ! Prétention bien grande pour un garçon de treize ans !
Et je dévorais des traités de phrénologie, de physiognomonie, de chiromancie même – on ne parlait pas encore de graphologie. Gall, Lavater, Spurzheim, Combes, Fossati, Desbarolles, d’Arpentigny m’étaient déjà connus. Je m’indignais de l’autoritarisme routinier de l’Académie de Médecine, repoussant le rapport de Jussieu et niant dogmatiquement l’existence de tous les phénomènes magnétiques dont d’aucuns, par la suite, étudiés expérimentalement, de façon méthodique, sont aujourd’hui admis par tous sous les noms d’hypnotisme et de suggestion.
Une télégraphie sans fil visibles s’exerçant entre deux cerveaux, soupçonnais-je confusément. L’un doit jouer le rôle de pile, l’autre celui de récepteur.
Plus tard, devenu télégraphiste, je me suis confirmé dans cette idée et lorsque, une vingtaine d’années après, on commença à discuter les expériences de Marconi, je fus un des premiers croyants de la T.S.F. « Tout dans l’univers, me disais-je, doit être vibrations. »
Cette passion d’explorer un monde inconnu peut être périlleuse lorsqu’elle n’est pas équilibrée par un esprit rigoureusement analytique, et mon imagination eût pu me conduire au précipice. Très heureusement, j’avais pour me servir de garde-fou l’exemple d’un grand oncle maternel, Victor Hennequin, qui avait été détraqué par le spiritisme. Avocat de talent, républicain sincère et fouriériste, il avait siégé à l’assemblée législative de 1849. Il fut de ceux qui protestèrent contre le coup d’État, mais les tables tournantes qu’il consultait firent chavirer ses convictions. Dans un livre : sauvons le genre humain ! qu’il s’imagina dicté à lui par l’Âme de la terre, il proclama l’homme de 2 décembre une sorte de messie au rôle providentiel.
Pauvre illuminé, sincère comme Proudhon qui, sans l’intervention des esprit, écrivit la révolution sociale démontrée par le coup d’État !
Victor Hennequin, toujours abusé par cette mystificatrice « Âme de la terre », s’imagina que son éditeur allait lui compter pour ses élucubrations une somme de cent mille francs, fabuleuse pour l’époque. Dans cette douce illusion, il s’empressa de distribuer tout ce qu’il possédait à ses amis et il s’en trouva en grand nombre. Il mourut ruiné, douche s’ajoutant à celles qui lui furent administrées par prescription médicale.
La génération de 1848, qui achevait de s’éteindre en 1870, était en même temps que généreuse, terriblement mystique. On ne pourrait certes pas adresser la même critique à celle d’aujourd’hui.
- 1Exactement, d’après les statistiques, 313.000.