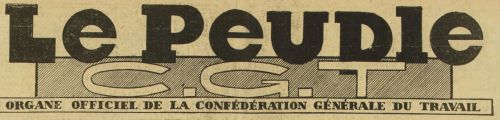VIII
Le 31 octobre. — Grisailles.
Et pourtant, au lendemain d’une entrevue de Jules Favre, investi du portefeuille des affaires étrangères, avec Bismarck, l’inexorable chancelier de fer, le gouvernement du 4 septembre avait, dans une fière proclamation, formulé cet engagement solennel : « Pas un pouce de notre territoire ! Pas une pierre de nos forteresse ! »
Des corps de partisans s’étaient formés. L’un d’eux, les Francs-tireurs de la Presse, dans une reconnaissance hardie, le 28 octobre, enleva le village du Bourget aux Allemands qui l’occupaient. Deux jours plus tard, l’autorité militaire ayant négligé de fortifier la position, elle fut reprise par l’ennemi qui fit quatre ou cinq cent prisonniers après un combat sanglant. On déclara alors que celle-ci n’avait aucune importance.
Sur ces entrefaites, le gouvernement apprit la capitulation de Metz, livré par Bazaine avec 173.000 hommes. Il garda pour lui la terrible nouvelle, mais Rochefort la confia secrètement à Flourens et celui-ci, estimant qu’elle ne devait point demeurer cachée, s’empressa de la communiquer à Félix Pyat. Le lendemain, Le Combat publia ces lignes que je cite de mémoire1La collection du journal Le Combat, publié pendant le siège de Paris, ne se trouve pas à la Bibliothèque nationale. – Note du site « La Presse Anarchiste » : cette collection semble maintenant accessible… Avis aux curieux. :
« Fait sûr et certain que le gouvernement détient comme un secret d’État : le maréchal Bazaine a envoyé un aide de camp au quartier général prussien pour traiter de la reddition de Metz. »
Le gouvernement affolé nia, laissant croire à une manœuvre allemande. D’aveugles « patriotes » coururent briser les presses du journal révolutionnaire et chercher son directeur dans des intentions peu bénignes, mais Félix Pyat se gardait prudemment ; ils ne le trouvèrent point.
Deux jours plus tard, les gens de l’Hôtel de Ville étaient contraints de proclamer la vérité qu’ils avaient tenté de cacher !
Cet aveu formidable, succédant brusquement à une dénégation formelle, la perte du Bourget et aussi la nouvelle de l’arrivée de Thiers pour mendier à Bismarck un armistice provoquèrent l’explosion du 31 octobre.
Pour les détails de cette journée historique, dans laquelle mon jeune âge m’empêcha de jouer le moindre rôle, je renvoie le lecteur aux diverses histoires de la guerre de 1870 – 1871 et principalement à l’Histoire de la Commune, de Lissagaray. Je relaterai seulement l’impression produite dans notre quartier, qui n’en ressentit que les contrecoups moraux, se trouvant séparé par les deux bras de la Seine de l’Hôtel de Ville où se déroula toute l’action.
D’abord le bruit circulant, vague au premier moment, ensuite plus affirmatif : le gouvernement trahissait. En temps de guerre ou de crise violente, l’accusation de trahison est celle qui se propage le plus facilement dans les foules. Le gouvernement dit de « la Défense Nationale » s’était-il lié par un pacte ignominieux à l’ennemi tout en feignant de le combattre ? On ne peut le dire, mais il n’en est pas moins certain que ses défaillances et son refus de céder la place à des éléments plus énergiques équivalaient à une véritable trahison.
Puis cette autre nouvelle : la Commune est proclamée ! On ne disait pas encore les noms de ceux qui remplaçaient les tièdes intronisés du 4 septembre, mais ces noms on croyait les deviner : Blanqui, Delescluze, Pyat, des directeurs des trois journaux qui n’avaient cessé d’ouvrir l’œil sur les hommes de l’Hôtel de Ville. D’aucuns ajoutaient Dorian – resté sympathique au milieu de ses collègues en défaveur – Victor Hugo, Flourens.
Ce dernier, âme de paladin et cerveau de savant, avait joué un rôle d’entraîneur dans l’envahissement de la maison commune. Son nom épouvantait les petits bourgeois de l’espèce du boutiquier Perrin. Par contre, ils eussent accepté Victor Hugo, mais le grand poète demeura en dehors des événements du 31 octobre. Félix Pyat, venu en observateur, n’y joua pas grand rôle. Brillant ciseleur de phrases, révolutionnaire romantique, intègre sans être un apôtre, il n’était point attiré par la griserie de la bataille. Cela n’empêcha pas son arrestation peu après, en même temps que celle de Millière, Tibaldi, Razoua, Vermorel, Lefrançais et quelques autres.
Blanqui et Delescluze, tous deux jacobins et qui ne sympathisaient guère, se trouvèrent, ce jour-là, au poste de combat, à l’Hôtel de Ville. Le premier signant des décrets au milieu de la confusion qui régnait chez les vainqueurs ; le second s’efforçant de sauver quelques épaves du grand mouvement naufragé lorsque Jules Ferry, s’étant échappé d’entre ses collègues prisonniers, fut revenu avec un bataillon de garde nationale – le réactionnaire 106e – « rétablir l’ordre ».
Car telle fut la nouvelle qui nous parvint à la fin de la journée : l’ordre était rétabli. Du coup tous les honnêtes boutiquiers respirèrent et M. Perrin, qui se fût résigné avec douleur à la nécessité d’acclamer Flourens et Blanqui, put se dégonfler tout son saoul en flétrissant les révolutionnaires.
Mon père qui, peu amoureux des galons, n’avait voulu être que simple garde, attendait avidement que se confirmât la nouvelle de la victoire de la Commune. Trompé par les premiers bruits, il avait cru cette victoire définitive et s’en réjouissait, Delescluze et Blanqui lui semblant, bien plus que le pieux Trochu, les hommes de la situation. Quelques gardes de sa compagnie partageaient son état d’âme, mais le capitaine, un nommé Passebon, ancien « marchand d’hommes » (nom sous lequel, au temps du service militaire non obligatoire, on désignait les recruteurs de remplaçants) était naturellement pour le pouvoir « régulier ».
Quand se répandit la nouvelle que le mouvement avait avorté, bien des physionomies changèrent, les unes s’éclaircissant, les autres se rembrunissant. Quelle étude pour un peintre doublé d’un psychologue !
Le gouvernement, sauvé plutôt que franchement vainqueur2Ferry rentrant à l’Hôtel de Ville avec un bataillon réactionnaire, mais ses collègues demeurant à ce moment prisonniers des révolutionnaires, cette chaude journée avait fini par une transaction., s’était engagé à n’exercer aucunes représailles et à donner la parole au peuple. Il se tira d’affaire avec l’escobarderie d’un plébiscite : la population entendait-elle le confirmer en bloc dans les fonctions qu’il s’était octroyées lui-même ?
Appréhendant un saut dans l’inconnu, trois cent vingt et un mille Parisiens, contre cinquante-trois mille, votèrent le maintien au pouvoir de l’incapable coterie du 4 septembre. Rochefort, dont la situation à l’Hôtel de Ville était intenable, donna sa démission.
Dans l’armée, il y eut deux cent trente-six mille oui contre neuf mille non.
Le gouvernement, ayant reçu ce blanc-seing, ne se gêna pas. Il fit arrêter Félix Pyat, Millière, Lefrançais, Tibaldi, Vésinier, Vermorel, Mottu, Razoua, Ranvier, Jaclard et autres républicains socialistes. Pas un bonapartiste n’avait été même inquiété depuis le 4 septembre. Rouher, l’ancien ministre autocratique de l’Empire, avait pu quitter en paix Paris pour aller conspirer à Londres contre la République française !
Le mois de septembre avait été tout d’enthousiasme frémissant ; octobre avait vu les premières désillusions et l’énervement grandir jusqu’à crever en orage ; l’hiver commençait prématurément. Le gaz allait manquer ; la nuit emplissait les rues comme les âmes ; le combustible se faisait rare. Et pourtant aucun découragement dans la masse profonde. La même résolution stoïque de vaincre ou mourir régnait chez tous : hommes, femmes, enfants.
Et, chose remarquable, dans Paris, qui n’avait pas de police ni presque de lumière, pas de crimes, pas d’attentats à la vie ou à la bourse des habitants.
Quelques nouvelles de la province arrivaient par pigeons voyageurs. Les messages, photographiés en caractères microscopiques sur une mince pellicule, étaient insérés dans un léger tube attaché sous l’aile du volatile. On apprit ainsi qu’une armée française s’était formée sur la Loire et, commandée par d’Aurelles de Paladines, avait, après une victoire à Coulmiers, réoccupé Orléans (9 novembre). Ce fut une éclaircie : on put espérer qu’une marche de cette armée sur Paris, combinée avec la sortie en masse que tous réclamaient, viendrait, prenant les assiégeants entre deux feux, débloquer la capitale. La victoire finale était plus que possible.
Mais, pour cela, il eût fallu d’autres hommes que les fantoches de l’Hôtel de Ville. On cherchait Hoche ou Kléber : on n’avait que Trochu.
Cependant, d’incurables confiants lui faisaient encore crédit. Je les vois encore répétant d’un air entendu : « Patience ! Il ne faut rien brusquer. Trochu a son plan. » Plan qui devait aboutir à la capitulation du 28 janvier.
À la fin, devant l’inébranlable résolution des Parisiens de tenir jusqu’au bout, le gouvernement provisoire dut, après avoir perdu un temps précieux, se résoudre à un simulacre de sortie. Le général Ducrot fut chargé de la diriger. Le 28 novembre, il passa la Marne devant Villiers après avoir annoncé dans une grandiloquente proclamation qu’il ne rentrerait dans Paris que « mort ou victorieux ». Le premier élan de ses troupes les avait menées jusqu’à Champigny. L’incapable stratège n’en profita point et, après trois jours de combats incohérents, il repassa la Marne vaincu et bien vivant.
Ce fut dans un de ces combats, livré à Villiers, que tomba, mortellement blessé, le commandant de francs-tireurs Franchetti, riche italien, jeune encore, qui s’était donné corps et âme à la défense de Paris.
Décembre s’annonça, lugubre, sans que fléchit la résolution des habitants. Pourtant la faim les mordait aux entrailles, en dépit de la création de fourneaux économiques. Depuis longtemps, on s’ingéniait à résoudre le problème de manger avec rien ; on élaborait les combinaisons culinaires les plus invraisemblables quelquefois en les décorant de noms pompeux. Le riz à la moutarde, baptisé « riz à la provençale » et le chocolat à la fécule de pomme de terre, remplaçant la crème, qui semblait le souvenir d’un autre âge, étaient des délicatesses très appréciées. Le chocolat ne coûtait pas plus de 9 sous la tablette, bon marché extraordinaire au milieu du renchérissement général ; le riz n’était pas introuvable. Mais les légumes, mais la viande, mais le pain !
Sur la place de la Trinité, un établissement portait l’enseigne « Boucherie cynique ». Le chien s’y vendait 1 fr. 50 la livre ; le chat, plus apprécié, 14 francs pièce ; un demi-chat sans la tête, 6 francs ; un rat, 1 franc. Ce dernier article trouvait moins d’acheteurs.
Des boucheries similaires s’intitulaient « canines » et « félines ». Une autre, qui n’était qu’hippophagique, annonçait la vente de « saucisson chevaleresque ».
La chasse aux animaux domestiques était ouverte. Notre concierge avait la réputation de s’y adonner. Avant la fin du siège, il déménagea subrepticement et, ce jour-là, disparu notre chien. Pauvre Misti, qui dut finir dans une casserole ! C’était un bel épagneul, plein de grâce et d’intelligence, qu’une mère de province avait donné à son fils, étudiant à Paris. Mais le jeune homme jetait sa gourme à Bullier et dans les joyeux cénacles, oubliant chez lui, où il ne rentrait pas tous les jours, le pauvre animal triste et affamé. À la fin, Misti, qui bien que quadrupède n’était pas une bête, prit un parti héroïque : il déserta. Un beau jour, nous vîmes entrer chez nous, par une porte restée accidentellement entr’ouverte, ce déshérité qui, dans son regard humain, nous demandait l’abri et la subsistance. Nous comprîmes ce langage muet, plus éloquent qu’un discours académique et, de ce moment, le nouveau venu fut notre hôte.
Nous ignorions tout de lui : son nom, sa naissance et ses antécédents. Un jour qu’il accompagnait ma mère dans la rue, son maître passant par hasard l’aperçut, l’appela et se fit connaître. Explications courtoises : Misti, rendu à son possesseur légitime, à l’égard duquel il ne semblait pas nourrir de rancune, le suivit sans difficultés. Mais décidément la vie de bâton de chaise de l’étudiant, qui le soumettait à des jeûnes prolongés, n’était-elle pas de son goût, car, au bout de quelques jours, il nous revint et cette fois définitivement.
J’en fus enchanté : Misti nous affectionnait sincèrement. Aux heurs où se terminait la classe à l’institution Boyer, sa robe blanche, tachée, apparaissait soudainement, à la grande joie de mes camarades. « Ecce canis ! s’exclamait un latiniste. On vient te chercher ». Car je n’étais toujours pas autorisé à cheminer seul dans la rue. La rue, gouffre où se perdent les innocents et où se font écraser les piétons !
Un seul défaut – était-ce bien un défaut ? – gâtait les belles qualités de Misti. Il était coureur, préférant l’appel de la rue avec ses périls à la réclusion prolongée dans un appartement. Cela lui occasionna des désagréments et, plus d’une fois, nous dûmes aller le réclamer à la fourrière, où nous arrivâmes à temps pour lui éviter l’extinction finale.
Et, après tant de péripéties émouvants, finir prosaïquement dans la panse d’un concierge dépourvu d’entrailles mais non d’estomac !
Avait-il eu le pressentiment de son sort ? Depuis plusieurs jours, il ne sortait plus guère et, comme attristé des malheurs de la France, il se blottissait sous le grand lit de mes parents, taciturne, lui jadis si folâtre.
Je demande pardon au lecteur de l’avoir entretenu d’un personnage à quatre pattes aussi longuement que d’un bipède de marque. Misti n’était ni un député ni un ministre, mais il valait beaucoup mieux.
D’autres animaux également supérieurs à la race humaine – tout au moins au point de vue moral – la plupart des chevaux de fiacre, les sagaces éléphants du Jardin des Plantes, leurs voisins les ours bruns, noirs ou blancs et les autres gueules inutiles, insultées du nom de bêtes féroces, bien qu’elles n’aient jamais inventé la moindre machine à tuer avaient été abattues. Mais il ne suffisaient pas de ces quelques milliers de kilogrammes de viande pour calmer les tiraillements de deux millions d’estomacs !
La dérisoire ration de 100 grammes de cheval par personne (peau, nerfs et os compris) devait s’acheter deux heures de queue sous la neige et, lorsque commença le bombardement de Paris, sous les bombes. Mes parents et moi célébrâmes le réveillon en mordant un pied de cheval resté inentamable après deux heures de cuisson. Cuisson pour laquelle il nous avait fallu sacrifier une partie de notre mobilier. Car le combustible était à peu près introuvable. De temps à autre mon père disait à ma mère : « Tu devrais aller rue Daubenton ». C’était là que vivait ma grand’mère, dans une pension bourgeoise de cette vieille voie mélancolique et déserte, dont les maisons basses, il y a déjà plus de cinquante ans, évoquaient un siècle mort. Par la porte de la pension, ouverte tous les jours, on apercevait un grand jardin s’étendant entre les pavillons.
Mon aïeule, maintenant septuagénaire, y vivait tranquillement ses derniers jours, au milieu de vieilles dames comme elle, pour la plupart veuves de fonctionnaires ou d’officiers retraités. Mme Comoléra, restée veuve elle-même avec une fille de mon âge, dirigeait l’établissement.
Dans cet îlot du vieux Paris confiné entre la rue Monge, nouvellement percée, large, emplie d’un éveil de la vie moderne et la grille du Jardin des Plantes, ma mère se rendait deux ou trois fois par semaine. Elle y alla tous les jours pendant le dernier mois du siège, lorsque sévit le bombardement, commencé par les Prussiens peu après le jour de l’an.
Les vieilles pensionnaires de la rue Daubenton ne souffrirent pas excessivement du siège. Sédentaires et engourdies par l’âge, elles n’avaient pas les exigences stomacales des adultes adonnés à une vie active. Sans doute aussi, Mme Comoléra avait-elle fait à l’avance d’importantes provisions. À l’exception du lait, des légumes frais, des œufs, du poisson, de la viande et du pain blanc, elles eurent à peu près tout ce qu’il leur fallait. Nous étions plus mal partagés qu’elles.
À peine ma mère avait-elle pris le chemin de la rue Daubenton, mon père, s’armant d’une hache, commençait à massacrer chaises, fauteuils et tables. Nous avions un fort beau mobilier où des scintillantes incrustations montraient des oiseaux multicolores et d’éblouissants papillons tout pourpre et azur volant au-dessus de fleurs invraisemblables. C’était pour ma jeune imagination comme une vision de pays tropicaux où le soleil se reflète dans la nature animée. J’appréhendais de voir toute cette splendeur nacre, laque et palissandre, s’émietter sous les coups de la hache destructrice.
Mais non. La rage paternelle sut se contenir dans de justes limites. Et, lorsque ma mère rentrait, après sa première stupeur de voir tables et sièges transformés en amas de combustible, elle se résignait en soupirant :
– Tu as bien fait. Il ne faut pas que Charles ait froid.
Elle s’oubliait elle-même, me couvant de sa sollicitude. Combien de fois ne répétait-elle point :
– Il est si faible, si délicat !
Ce qui n’était pas sans me vexer.
Le pain du siège de Paris est demeuré légendaire : il comprenait toutes sortes de matières, excepté de la farine. Les granules pierreux et la paille hachée entraient par contre, avec le son, pour une part importante dans sa composition. D’un ton brun tirant sur le noir, et d’une senteur désagréable, il évoquait, par antithèse, le souvenir douloureux des pains viennois, des croissants et des brioches de jadis. Longtemps après les événements de l’Année Terrible on vendait encore, sous un couvercle de verre, des échantillons de ce pain.
Près d’un demi-siècle plus tard – revanche de l’inexorable Némésis – l’Allemagne devait, à son tour, connaître le mauvais pain de guerre.
Mais celui d’outre-Rhin, bien que raillé avec une finesse d’hippopotame sous le nom de pain « K. K. »3Krieg Kommis Brot (pain de munition de guerre)., ne pouvait soutenir la comparaison dans l’horrible avec le pain du siège de Paris. La fécule de pomme de terre, dans le pain allemand, remplaçait avantageusement le son, la paille et la pierre.
Un grand régal, malheureusement trop rare, c’étaient les bettes blanches, sœurs, ou tout au moins cousines, des betteraves rouges – car le monde végétal lui-même présente des différences de couleur dans les familles. Ces chénopodées avaient été jusqu’alors réservées à l’alimentation des bestiaux, demeurant ignorées ou dédaignées des humains – tout au moins des citadins. Maintenant, elles étaient justement appréciées, et les intrépides qui se glissaient entre les lignes françaises et allemandes pour aller marauder dans les champs abandonnés étaient salués comme des sauveurs lorsqu’ils rapportaient, les vendant à bon prix, quelques-unes de ces racines devenues une délicatesse de gourmets.
Lorsque le 160e bataillon était de garde aux remparts, nous allions, ma mère et moi, apporter à mon père une gamelle emplie de ces bettes cuites à l’eau, puis fricassées à la graisse de cheval. Les autres femmes et enfants de gardes nationaux en faisaient autant et des repas familiaux s’établissaient en plein air, sous la bise glacée, auprès des canons en batterie.
Et, pourtant, si les vivres faisaient défaut, ils n’étaient point inexistants. Déjà, vers le 6 novembre, alors que circulaient des bruits d’armistice, créés par la présence de Thiers, on avait vu des légumes, des choux surtout, reparaître à la devanture des marchands de quatre-saisons. Le beurre, monté à 20 francs la livre (il devait par la suite, atteindre 50 francs), était redescendu à des prix abordables.
Plus tard, lorsque la capitulation de 28 janvier mit fin au siège, on devait voir, soudainement surgis des sous-sols, des amoncellements de pommes de terre s’étaler dans les locaux des marchands en gros.
Ces féroces spéculateurs qui, avant le ravitaillement, se hâtaient de sortir leurs denrées cachées, avaient préféré les laisser pourrir dans l’humidité des caves plutôt que de les livrer à des prix normaux. Ils avaient attendu, toujours sans le trouver arrivé, le moment où les Parisiens, succombant à la fin, eussent payé ces tubercules au poids de l’or.
Je me rappelle ces pommes de terre gâtées, qui formaient des montagnes de pourriture dans la rue des Halles. C’était une infection et, pour éviter l’empuantissement, on dut les vider par tombereaux dans la Seine.
Le gouvernement, ne déployant de sévérité que contre les républicains ; avait laissé les accapareurs se livrer bien tranquillement à leurs manœuvres, véritable complot contre la vie des assiégés. Il ne poursuivit même pas ces misérables, que le peuple, quatre-vingts ans auparavant, eût accrochés sans cérémonie à la lanterne !
- 1La collection du journal Le Combat, publié pendant le siège de Paris, ne se trouve pas à la Bibliothèque nationale. – Note du site « La Presse Anarchiste » : cette collection semble maintenant accessible… Avis aux curieux.
- 2Ferry rentrant à l’Hôtel de Ville avec un bataillon réactionnaire, mais ses collègues demeurant à ce moment prisonniers des révolutionnaires, cette chaude journée avait fini par une transaction.
- 3Krieg Kommis Brot (pain de munition de guerre).