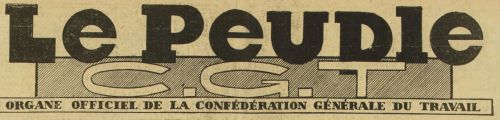Chapitre XVI
Tentative insurrectionnelle et télépathie
Dans cette partie de ma vie allant de l’enfance à l’adolescence, je me suis attaché décemment à parler peu de ma personne, beaucoup moins intéressante pour le lecteur que les événements dont elle était témoin.
Cependant, il est un épisode qui, je crois, malgré son caractère personnel, vaut d’être raconté. Il marque ma première arrestation, qui devait être suivie de beaucoup d’autres ! Il offre aussi un exemple, que n’eût pas dédaigné Camille Flammarion, aux personnes — dont je suis — qui considèrent rationnellement la télépathie comme une manifestation de la force universelle qui transmet ses vibrations entre les cerveaux humains aussi bien qu’entre les astres.
Au moment où les robes rouges venaient de frapper mes parents d’un verdict infâme, qu’elles croyaient définitif, je suivais attentivement dans les journaux les évènements politiques. J’étais maintenant non plus un gamin mais un adolescent capable de se former des idées générales et d’échafauder un plan d’action.
Je savais que si le peuple de Paris et des grandes villes voulait résolument la République — une République réelle — dans les hautes sphères on s’agitait pour « étrangler la gueuse ». Les royalistes, divisés en légitimistes et en orléanistes, n’avaient pu se mettre d’accord, mais un certain réveil bonapartiste se faisait dans des milieux remuants, vu avec sympathie par les grands chefs de l’armée. Napoléon III, malgré Sedan, avait conservé des partisans ; il en avait même regagné quelques-uns après les massacrés de mai 1871, en se déclarant « l’empereur des ouvriers », jeu qui lui avait déjà réussi après les journées de juin 1848. Il était mort des suites d’une opération chirurgicale, tentée pour lui permettre de « pouvoir monter à cheval », selon la tradition des prétendants, mais il laissait un rejeton, « le petit Badinguet », comme on l’appelait ironiquement — celui qui, jouant au soldat, avait ramassé une balle à Sarrebrück.
Ce jeune héritier de la tradition napoléonienne, poussé par l’ambition égoïste de sa mère, pouvait être dangereux. On s’attendait même à ce que Mac-Mahon, ancien favori de la cour des Tuileries, qui haïssait la République sans chérir l’orléanisme, et qui avait dit en parlant de l’éventualité d’une tentative légitimiste : « Les chassepots partiraient tout seuls ! » se prononçât pour une restauration de l’Empire. N’était-ce pas l’Empire qui lui avait donné faveurs, titre ducal et maréchalat ?
L’élection dans la Nièvre, du baron Bourgoin, actif agent bonapartiste, avait été considérée comme un symptôme sérieux.
L’idée me vint d’exécuter une entreprise certainement très romantique, mais cela n’était pas pour m’arrêter. Avec ma timidité d’allures, que j’ai conservée jusque dans la vieillesse, je n’ai jamais été poltron, estimant, d’ailleurs, qu’il n’arrive que ce qui doit arriver.
N’étais-je pas fils d’un ex-garibaldien dont la vie, comme celle de son chef, avait été un tissu d’aventures ? Et le romantisme révolutionnaire n’a-t-il pas fait maintes fois plus que la pondération prudente — souvent lâche — des politiciens classiques ?
Sans confident, sans complices, me disant, comme la Médée de Corneille : « Moi seul, et c’est assez ! » je rédige une proclamation au peuplé de la capitale.
Une proclamation non pas communarde, ni même simplement républicaine, mais, au contraire, empreinte du plus pur esprit bonapartiste :
« Habitants de Paris, disais-je en substance, l’Empire renaît aujourd’hui de ses cendres (sic). Ralliez-vous autour du régime qui vous a donné vingt ans de prospérité et de paix ! »
De paix ! Il fallait certainement un beau toupet pour l’affirmer. Mais n’était-ce pas l’ex-langage textuel tenu jadis par Louis Bonaparte : « L’Empire c’est la paix ! »
Quelle était mon intention en mettant au monde ce morceau de grandiloquence boursouflée dans le genre napoléonien ?
Celle-ci : annoncer que le coup d’État bonapartiste auquel on s’attendait tous les jours, s’accomplissait en ce moment même, et, placardant des copies de ma proclamation dans les quartiers les plus avancés d’idées, créer une effervescence insurrectionnelle. À Belleville, dans le faubourg Saint-Antoine, là où la Commune avait eu ses plus résolus défenseurs, le sentiment populaire qui couvait, comprimé par l’état de siège, pouvait faire explosion. Coups de main sur les postes et les prisons, saisies d’armes, délivrance des captifs, c’étaient choses possibles. Tant pis si parmi ces captifs il s’en trouvait de frappés pour des faits autres que politiques ! Marianne, comme le Dieu massacreur d’Albigeois, reconnaîtrait les siens.
Et puis après ?
Après, on serait allé aussi loin que possible, ouvrant la porte à l’imprévu aussi bien qu’aux prisonniers !
En placardant ces manifestes dans la nuit, je pensais bien que, le lendemain matin, en allant à leur travail, les ouvriers les auraient lus, commentés en s’attroupant. Et moi, me mêlant aux groupes, j’aurais lancé sans scrupule toutes les fausses nouvelles susceptibles de créer une émeute. « Mais oui, messieurs — ou citoyens — on se bat près des boulevards : j’en viens ; j’ai vu des gens qui élevaient des barricades, et, sur la rive gauche, il paraît que ça chauffe ! »
On pourra dire que cette tentative était enfantine, ridicule, folle — on pourra d’autant mieux le dire qu’elle n’a pas réussi. Peu m importait : dans sa préparation je ne compromettais que moi. Dans l’exécution, je me serais naturellement fait un devoir de payer plus que tout autre de ma personne.
Il y aurait eu des victimes ?
Hélas ! on n’a pas encore trouvé le moyen de faire des omelettes sans casser d’œufs. Napoléon Ier, sacrifiant des millions d’humains à son ambition me paraît un monstre, bien qu’il ait aujourd’hui encore des adorateurs. N’est-ce pas la fin qui justifie les moyens ?
La fin, c’était la délivrance des victimes du sabre versaillais ; le moyen, c’était, en l’occurrence, le mensonge, la propagation de fausses nouvelles ; choses très vilaines en elles-mêmes dans la vie privée, mais d’un usage courant en politique.
Barbès, Blanqui, Garibaldi et combien d’autres, qui poursuivaient des fins hautement humanitaires, n’ont-ils pas, tous désintéressés qu’ils fussent, fait casser nombre de têtes ?
Manquant de matériel d’imprimerie — et, d’ailleurs, je n’eusse su m’en servir — je copie à la main une vingtaine d’exemplaires de ma proclamation. Je les signe carrément : « Le comité impérialiste », suivi d’une demi-douzaine de noms n’appartenant à personne.
Puis je quitte ma chambre Saint-Paul, me disant que je n’y reviendrai peut-être jamais. Dans une serviette d’avocat j’emporte mes proclamations.
Le soir est arrivé. En attendant la nuit qui me permettra d’afficher les placards incendiaires, je me dirige vers la Bastille. La boutique d un marchand de couleurs est encore ouverte : j’y entre et achète un bâton de colle à bouche de deux sous. Car je n’ai pas de pot à colle, de colle et de pinceau.
Les moyens me manquent, mais non la volonté !
Dix heures du soir, les boutiques sont fermées ; dans le faubourg Saint-Antoine, les passants se raréfient : on n’est pas noctambule sous l’état de siège. D’ailleurs, ce n’est pas samedi et les prolétaires qui, le lendemain, iront à leur travail de bonne heure, ne s’attardent pas à flâner.
Cependant j’attends encore, et c’est seulement lorsque l’obscurité s’épaissit que je me mets à l’œuvre.
À l’angle de la rue de Charonne et du faubourg, sur un mur nu, où elle se détachera parfaitement, je colle ma première affiche.
Je monte ensuite vers Charonne, tourne vers le boulevard extérieur, le suivant jusqu’à Belleville, et, sur tout ce parcours placarde d’autres exemplaires.
Tout va bien jusqu’ici. Je traverse le canal et me dirige vers le faubourg Saint-Martin ; je le remonte et continue l’affichage.
Un peu au-dessous de la rue Lafayette, j’aperçois deux gardiens de la paix qui font leur ronde. L’endroit me paraissait propice à la pose d’un placard : je voulais justement provoquer des attroupements dans le voisinage de Saint-Lazare, la hideuse prison qui commande le débouché du faubourg Saint-Denis sur le boulevard de Magenta.
Je laisse passer les deux agents et, quand je les crois éloignés, j’orne le mur d’une nouvelle affiche. Après quoi je tourne à gauche, dans la rue Lafayette, continuant de coller.
L’obscurité nocturne est tempérée par la lumière des becs de gaz.
Je viens de tourner encore à gauche — il est écrit que, toute ma vie, j’irai de ce côté-là ! — je m’engage dans une petite rue longeant le chemin de fer de l’Est et que j’ai su, depuis, être la rue d’Alsace.
Soudain, des coups de sifflet fendent l’air ; des pas galopent derrière moi : ce sont les deux agents qui accourent.
À droite, par une petite rue transversale, d’antres surgissent, se précipitant sur moi. À gauche, j’ai le parapet qui me sépare de la voie ferrée « et, en contre-bas, celle-ci à trente pieds au-dessous de moi !
Si je ne puis me lancer moi-même dans ce gouffre, peut-être pourrai-je y lancer ma serviette avec le restant des proclamations ? Mais je n’en ai pas le temps. Les agents bondissent, ils s’emparent de ma personne et de la serviette. Tant pis ! Advienne que pourra. Je ne ressens que l’amertume de mon coup manqué.
Les policiers m’emmenèrent droit devant moi, à un poste de police, depuis supprimé, qui existait alors à l’entrée de la rue d’Alsace.
Détail que j’ignorais. Ainsi, en me dirigeant d’instinct vers la prison autour de laquelle je voulais préparer l’effervescence et la révolte de la rue, je m’étais fourvoyé dans le plus parfait traquenard.
J’ai perdu la partie mais ne m’affole pas : en un clin d’œil j’ai envisagé la situation et ma décision est prise : je jouerai la folie.
Il est assez concevable qu’un jeune collégien, dont la famille vient d’être aussi horriblement frappée et qui ne doit plus entrevoir pour lui-même qu’un avenir de misère matérielle et morale, puisse sentir sa raison vaciller sous le choc. Il me faudra donc délirer assez pour donner à supposer en transport au cerveau.
Après ? Eh bien ! après j’aurai soin de recouvrer ma lucidité, car si je me sens prêt à risquer ma vie dans en but élevé, je ne tiens nullement à finir mon existence dans un cabanon en recevant des douches.
Je pénètre dans le poste de police, non insurgé victorieux suivi d’une bande, mais captif escorté d’une demi-douzaine d’agents. C’est ma première arrestation : ce ne sera pas la dernière. Toutefois, ma résolution n’est pas entamée, et lorsque le chef de poste me fixe, se préparant à m’interroger, avec quelle hauteur je le toise !
Il me demande mes noms et prénoms. Me redressant superbement, l’œil fulgurant, la voix vibrante d’un orgueilleux mépris, j’annonce :
— Louis-Napoléon Bonaparte, empereur des Français !
Cette déclaration inattendue produit un certain saisissement, mais elle est accueillie avec incrédulité. Sur le même ton, digne d’un bon acteur de mélodrame, je déclare que, fils et héritier de Napoléon III, j’ai débarqué en Normandie, venant d’Angleterre, avec le fidèle docteur Conneau1Henni Conneau, premier médecin de l’empereur Napoléon III dont il avait antérieurement partagé la captivité au fort de Ham. pour faire valoir mes droits à la couronne impériale.
Et, parlant au chef le langage de l’autorité, je gronde, je menace :
— Malheur à vous, prononcé-je, si vous oubliez le respect dû à votre maître ! Quand je serai monté sur le trône, je me souviendrai.
— Il a l’air bien fêlé, murmure un vieil agent à moustache et impériale grisonnantes.
Ce certificat de folie me flatte, malgré la tristesse de la situation : il paraît que je joue bien mon rôle.
Le chef de poste réserve son appréciation, mais il envoie des policiers battre le quartier en quête d’autres affiches et d’autres afficheurs.
Le vieux sergot a dû appartenir à l’ex-police impériale : son âge et la coupe de sa barbe permettent, du moins, de le supposer. Peut-être ressent-il au fond de lui-même une vague sympathie pour l’adolescent qui, fou ou non, assume la personnalité de l’éventuel Napoléon IV.
Il m’indique du doigt un lit de camp.
— Couchez-vous là, me dit-il d’une voix pas trop rude.
« Mieux vaut être assis que debout et couché qu’assis », dit un proverbe arabe. Je m étends sur le lit de camp et feins de m’endormir peu à peu.
Pourtant le sommeil est bien loin de mon esprit : je songe à l’avortement de mon beau plan et me demande ce qui pourra bien arriver.
Maintenant notre trinité est captive.
N’était l’échec de ma première conspiration, je serais heureux de partager l’infortune de mes parents puisque je n’ai pu les délivrer.
Mais je n’éprouve aucune crainte : lorsqu’une situation est au pire, tout changement qui s’annonce ne peut qu’éveiller l’espoir. Et quelle situation pouvait être pire que la nôtre ?
À travers mes cils baissés, j’entrevois deux agents qui arrivent affairés : en battant le quartier ils ont découvert deux de mes affiches et les apportent victorieusement.
Le chef de poste parait songeur. Il se demande, sans doute, ce que signifie cette histoire d’un conspirateur imberbe qui ce prétend le prince impérial. Mais le problème, pour lui, est insoluble : aussi renonce-t-il à le résoudre. Décision sage que je lis sur sa physionomie : le commissaire de police s’en arrangera.
Cependant, je dois soutenir le rôle que j’ai assumé. Je me livre à quelques essais de ronflement pour feindre ensuite un sommeil fiévreux. Je prononce quelques mots incohérent mais bien dans le style bonapartiste : « Ma famille… Napoléon… Sainte-Hélène. »
Il peut être trois heures du matin lorsque mes gardiens me tirent de mon sommeil apparent. C’est pour me conduire au domicile privé du commissaire de police.
Celui-ci semble fort courroucé — furieux, sans doute, contre l’auteur d’une tentative qui l’arrache au sommeil. Aussi m’interroge-t-il sans la moindre aménité. Je l’entends qui murmure : « Ce crapaud ! » Depuis plusieurs heures la police est sur pied, explorant les alentours du Pont-de-Flandre et de la Chapelle.
Et moi, dans la candeur de mon âme, je me réjouissais de cette ire du commissaire, l’attribuant à des sentiments désintéressés. Je songeais : « À la bonne heure ! Voici enfin un fonctionnaire de la République qui est républicain ! Il me prend pour un impérialiste en herbe. De là son exaspération ! »
Je ne me rappelle pas bien exactement ce que je lui répondis : je sais seulement que je fis montre d’une grande dignité : le « petit Badinguet » ne fut point abaissé en ma personne.
Les agents qui m’avaient amené continuaient de me regarder, plutôt songeurs qu’hostiles. Si l’Empire allait tout de même « renaître de ses cendres », comme je l’affirmais péremptoirement dans ma proclamation, conserveraient-ils leur place et leurs appointements ? C’était sans doute pour eux la grande question.
Lorsque le commissaire a fini de m’interroger et de prendre des notes, l’un d’eux, comme frappé d’une idée subite, me dit, légèrement goguenard :
— Si vous êtes le prince impérial, vous devez connaître l’anglais ?
— Certes.
Il me met sous le nez un livre imprimé dans la langue du général Booth — je crois me souvenir que c’était une Bible — et me dit :
— Eh bien!! traduisez-nous donc ça.
J’ouvre le bouquin et traduis couramment.
Les agents se regardent un peu surpris et semblent se demander si, à défaut d’être, comme je l’affirme, le fils de Napoléon III, je ne suis pas quelque infime émissaire venu en droite ligne de Chislehurst2Lieu où, après la guerre de 1870 – 1871, alla résider la famille impériale.
Cependant, le commissaire, toujours bougonnant, décide de me remettre entre les mains de la justice. C’est elle qui prononcera sur cette épineuse affaire. Je suis conduit… à Saint-Lazare.
Dans cette infecte prison, lépreuse, sordide, dont l’existence est demeurée une honte pour le Paris du vingtième siècle, existe, séparé du quartier des femmes, un cachot nauséabond où sont enfermés les déchets humains : ivrognes ramassés sur le trottoir, rôdeurs et rôdeuses. Ils attendent sur un banc, entre les quatre murs nus, en la compagnie pestilentielle d’un immonde baquet à déjections, que la voiture cellulaire — le « panier à salade » — vienne les enlever comme un tas d’ordures pour les vider au Dépôt. Un poste de soldats les garde et, par un guichet trouant la porte massive, peut les surveiller.
C’est ce même poste qu’on aurait eu à surprendre et à désarmer, ce matin-là, si l’émeute avait pu se produire près de Saint-Lazare.
C’est là que je suis amené. Le local n’est occupé, en ce moment, que par un ivrogne qui hoquette.
Je ne songe guère à dormir sur le banc dans cette atmosphère empestée. Jamais nuit n’aura été plus blanche pour moi que celle-là. Je continue de songer, sans fièvre cependant, attendant les événements.
Lorsqu’on est allé jusqu’au bout de son effort, que toute initiative est, pour le moment, paralysée, c’est souvent une force d’être fataliste.
Du moins jusqu’à un certain point, car mon fatalisme n’est pas de celui qui s’abandonne. Quand on ne peut diriger les événements, tout au moins convient-il de suivre de vue la situation dans laquelle on se trouve sans se laisser aller à l’oubli ou au rêve.
Pour soutenir mon rôle de céphalagique, je m’approche du guichet ouvert et appelle un soldat. Il s’approche, je lui tends mon mouchoir en le priant de le tremper dans l’eau. Ce qu’il fait sans difficulté et je m’applique le linge mouillé sur la tête, comme si la fièvre brûlait mon cerveau. En réalité, la température de mes méninges demeure très normale.
Or, ce même jour, dans l’après-midi, à l’heure réglementaire des visites, je devais voir ma mère au parloir de faveur, comme je le faisais deux fois par semaine. Je songeais avec amertume quelle serait son angoisse d’attendre inutilement mon arrivée, seul réconfort qu’elle eût dans sa poignante situation.
Nous nous trouvions, elle et moi, captifs dans la même prison, séparés l’un de l’autre par des corridors et des épaisseurs de murailles. Eh bien ! au moment même où j’étais peut-être à trente mètres d’elle, la tête enveloppée dans mon mouchoir, ma mère me vit en rêve, empêché d’aller vers elle et le front couvert d’un bandeau qui devait cacher quelque blessure. Aussi, dans la journée, si mon absence l’angoissa douloureusement, elle n’en fut point surprise : elle avait eu le pressentiment d’un malheur.
D’une constitution délicate, dont les perceptions étaient peut-être aiguisées par ses deux maladies : névralgie et gastralgie, ma mère eût été un sujet remarquable pour un psychophysiologiste. Il lui arrivait de ressentir des intuitions étranges : quelque chose comme les phénomènes de cette double vue qu’on a volontiers raillée quand elle se présentait sous le nom de magnétisme — trop souvent exploitée par des charlatans — et qu’on commence aujourd’hui à admettre sous le nom de télépathie. Impressions qui annoncent comme le bourgeonnement d’un nouveau sens chez les humains les plus affinés, tandis qu’elles n’effleurent même pas l’épiderme épais d’autres individus.
Plus tard, j’aurai à citer un autre phénomène du même ordre : la mort d’un déporté perçue par ma mère à l’île des Pins.
Cependant la porte du cachot s’ouvre pour laisser entrer trois ou quatre nouveaux hôtes. L’un d’eux, proprement vêtu, est un jeune homme à l’aspect doux et sociable ; les autres sont quelconques.
Il parait que l’alimentation des prisonniers temporaires est considérée comme une onéreuse superfluité car on ne nous offre que de l’eau claire. Je m’en sers pour mes ablutions. Je crois que le jeune homme sympathique en fait autant ; les autres dédaignent ce soin. À quoi bon se laver ? semblent-ils penser.
Vers midi un roulement de voiture : on nous ouvre et j’aperçois le « panier à salade ». J’y monte pour la première fois de ma vie : ce ne sera pas la dernière.
La dernière fois — sera-ce vraiment la dernière ? — ce fut trente ans plus tard. J’étais accusé d’avoir voulu attenter aux jours précieux du roi d’Espagne et, par la même occasion, à ceux du président de la République française, qui l’accompagnait.
Entre la première et la dernière fois, j’ai fait quelques autres promenades dans ce fatidique panier, où l’on était réellement fort cahoté.
Aujourd’hui, la traction mécanique ayant remplacé partout la traction animale, c’est en auto-cellulaire que les prisonniers sont trimballés. Je souhaite que cette locomotion leur soit plus douce et que la philanthropie bien connue de l’administration pénitentiaire ait songé à faire élargir, sinon les prisonniers, du moins les cellules ambulantes — dix par voiture — leur servant de réceptacle. Cellules qui, en 1905 encore — je n’en ai pas fait l’expérience depuis — eussent pu, pour la commodité, rivaliser avec des cercueils !
Je n’allongerai pas le récit de mon odyssée. À cette époque préhistorique l’anthropométrie n’existait pas encore, mais je connus la toise, la fouille, la salle commune. Rien n’était plus révoltant que cette salle immense où, de quatre heures de l’après-midi à 9 heures du matin, une multitude d’hommes de toutes catégories et de tous âges couchaient côte à côte, à même des paillasses vermineuses étendues sur une planche horizontale. De l’autre côté de la cloison, c’était la salle commune des femmes et on peut juger des conversations ordurières qui s’engageaient entre sexes différents.
Il y avait là un pauvre diable de poète miséreux et trembleur, qui, après avoir, pendant quarante ans, chanté le vin et les beautés joyeuses, s’était permis quelques vers indépendants effleurant la politique. Il habitait la zone révolutionnaire de Belleville, dans un galetas. Cela avait suffi pour lui créer une réputation — combien apocryphe ! — de chantre de la Commune, Tyrtée du drapeau rouge, et le faire appréhender.
Il y avait un type de bellâtre, amuseur et financier véreux, poursuivi pour escroquerie et qui se vantait d’avoir procréé à droite et à gauche quatorze enfants, mais non de les avoir élevés, laissant généreusement ce soin à leurs mères, créatures à ses yeux sans importance.
Il y avait un grand roux, maigre et solide, que j’ai revu un peu plus tard à bord du Var, rasé et sous la livrée matriculée du forçat. Il se vantait d’avoir bravement combattu pour la Commune et c’eût été très bien si cet individu, qui n’avait pas trouvé son pain cuit en venant au monde, n’eût choisi pour moyen d’existence le cambriolage. C’était pour répondre de méfaits étrangers à tout idée sociale qu’il allait comparaitre devant les tribunaux.
Son voisin de paillasse était un Lorrain d’une vingtaine d’années, qu’il affectionnait à la façon virgilienne du pasteur Corydon, et il n’attendait même pas la nuit pour le lui prouver.
D’ailleurs, il n’y avait pas, à proprement parler, de nuit dans ce caravansérail lamentable, où dès la rentrée de quatre heures le gaz dardait sa flamme jaune.
Cette agglomération humaine a pour se soulager un cloaque indescriptible : une véritable mer de fange. Eh bien ! quarante-trois ans plus tard j’ai été indigné de trouver à l’École militaire, affecté à la satisfaction du même besoin, un retiro aussi immonde. Pas à l’usage des officiers, naturellement, non plus que des sous-officiers, mais pour l’infime troupeau des non-gradés. Car dans nos pays latins il semble que, civile ou militaire, libre on pénale, la vulgaire multitude n’ait droit qu’à l’ordure !
À 9 heures du matin et jusqu’à 4 heures de l’après-midi, c’est le préau. De la salle commune, on défile, portant sur le dos sa paillasse grouillante, qu’on dépose dans un magasin et qu’on reprendra à l’heure du coucher ; on reçoit sa boule de son et l’on va, pendant sept heures, enfermer son oisiveté dans une basse-fosse, à vingt ou trente par préau. Les prisonniers jouissent de la double compagnie du baquet à déjections, déposé dans un coin, et d’un gardien somnolent, assis sur une chaise, à l’entrée. Pour déjeuner, une terrine d’eau chaude, qualifiée soupe ; pour dîner, une potée de légumes — pommes de terre bouillies ou riz avarié — dans la même terrine.
On ne demeure là, en général, que trois ou quatre fois vingt-quatre heures J’y suis resté une dizaine de jours, contemplant invariablement au-dessus de ma tête, encadré entre de hauts murs aux fenêtres fermées, un pan de ciel bleu.
Cet azur semblé narguer le prisonnier, lui dire : « À deux pas, c’est la lumière, le mouvement, la vie ! C’est la liberté ! »
J’avais eu soin de recouvrer la lucidité.
Puis, un beau jour, brusquement, ç‘a été l’élargissement pur et simple, sans formalité, sans la moindre comparution devant un juge d’instraction, ou un médecin aliéniste.
Les mêmes autocrates qui, se prévalant de l’état de siège, avaient contre mes parents accumulé arbitraire sur illégalité pour arriver à patauger dans le conflit des juridictions civile et militaire, la décision de l’une allant bientôt annuler le verdict de l’autre, n’osaient maintenant sévir contre l’adolescent. Pourtant, celui-ci avait tenté un acte tombant sous le coup de la loi ! Était-ce un remords qui les empêchait de sévir ? C’est peu probable. Bien plutôt, ils devaient se dire que le mieux pour eux était d’étouffer une affaire qui pouvait rappeler avec un fâcheux retentissement leur crime imbécile.
- 1Henni Conneau, premier médecin de l’empereur Napoléon III dont il avait antérieurement partagé la captivité au fort de Ham.
- 2Lieu où, après la guerre de 1870 – 1871, alla résider la famille impériale.