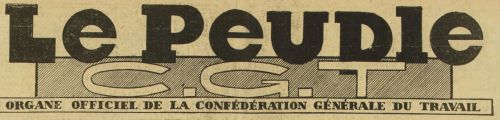XIV
L’«ordre » règne
Nous trouvâmes un abri au numéro 24 de la rue de la Clef, dans une pension bourgeoise tenue par une dame Rogier-Bénard.
Mentant impudemment, comme il est nécessaire de le faire en semblable circonstance, nous nous présentâmes comme une famille bien pensante fuyant, épouvantée, son domicile, proche du Panthéon que les fédérés menaçaient de faire sauter. Mes parents donnèrent pour référence le nom de ma grand’mère, veuve d’un universitaire et mère d’un médecin militaire, laquelle vivait dans le voisinage. À la pension Comoléra on ignorait que mon père fût un capitaine de la Commune.
Cette référence suffit pour nous faire accueillir.
Mon père, vêtu d’un dolman bleu marine, avait, en route, arraché les bandes rouges de son pantalon et jeté son képi galonné. L’absence de coiffure eût, cependant, infailliblement éveillé des soupçons. Dans la rue Monge, où sifflaient les balles, toutes les boutiques étaient fermées. La chance fit rencontrer à ma mère, marchant en éclaireur — tandis que mon père formait l’arrière-garde plus directement menacée — une vieille mendiante qu’elle avait souvent secourue.
Brave femme ! Sur une histoire invraisemblable que lui conta ma mère, et dont elle ne dut pas croire un mot, elle se précipita sur la devanture fermée d’un chapelier. À coups de poing et de pied, elle contraignit le patron à ouvrir sa porte.
Combien fut ahuri le commerçant de voir faire irruption chez lui une cliente en pareil moment ! Acheter un chapeau alors que Paris était à feu et à sang !
Mais las affaires sont les affaires ! Et puisque l’occasion s’en présentait, l’homme vendit un couvre-chef très sortable. Ma mère courut l’apporter à mon père qui attendait sous une encoignure. Et nous pûmes faire ainsi une entrée décente à la pension Rogier-Bénard.
Il était temps !
Nous fûmes installés dans une petite chambre donnant sur une cour intérieure. Cette pièce attendait à une sorte de cabinet avec fenêtre sur les toits voisins.
Mon père, qui s était débarrassé de toute arme, se rappela soudainement que ses poches contenaient
encore quelques cartouches. Il s’empressa de les jeter, non dans la cour, naturellement.
Il n’y avait pas très longtemps que cette opération prudente venait d’être exécutée lorsqu’un officier de ligne, suivi de quelques soldats, parut dans la cour. Les Versaillais occupaient le quartier !
Bien que je n’ai jamais été dépourvu de sang-froid, contraste bizarre avec ma timidité, mes parents m’ont dit depuis que j’étais, à ce moment-là devenu très pâle. Pâleur excusable : mon père allait peut-être être fusillé !
Mais Mme Rogier-Bénard fut très bien.
— Monsieur, dit-elle à l’officier qui venait perquisitionner, il n’y a dans ma maison que des dames âgées et des vieillards.
L’officier n’insista pas : il salua et se retira avec ses hommes.
À ce moment-là, le Panthéon, débordé, entouré comme un îlot par des flots de pantalons rouges, succombait presque sans lutter, comme Montmartre.
Mais un formidable bruit de bataille emplissait l’air, venant du sud. Canonnade grondante, roulements de fusillade, feux de salve se croisant. C’était à la Butte-aux-Cailles, défendu par Wroblewski. Là, les bataillons du 13e , entre autres, le légendaire 101e, soutinrent, du 23 au 25, l’assaut de deux brigades.
Mme Rogier-Bénard m’avait emmené dans une sorte d’observatoire mansardé, d’où l’on n’apercevait que des toits, mais où l’on entendait mieux que partout l’épouvantable fracas de fa lutte.
Celle-ci se continua jusqu’au lendemain.
Vers la soirée, l’Infiltration versaillaise s’accentua dans le voisinage du Jardin des Plantes. Les solats vaquaient dans les rues, bien accueillis par les boutiquiers, en particulier par les marchands de vin. Des gens leur offraient à boire.
Il eût été dangereux pour les bourgeois que nous nous prétendions être de se claquemurer à la pension, alors que tous les amis de l’ordre se montraient dans la rue.
Pourtant, on était à la merci d’une rencontre. Que de vengeances lâches se sont accomplies alors ! Débiteurs se débarrassant de leurs créanciers, ou créanciers assouvissant leur colère sur des débiteurs insolvables ! Maris envoyés à la mort par les amants de leurs femmes ou par celles-ci impatientes de rompre leur chaîne !
Il suffisait d’une dénonciation : la moindre, la plus invraisemblable. Les vainqueurs fusillaient à volonté.
Les soldats que nous vîmes dans la rue Censier, proche de la nôtre, étaient littéralement fous. Grisés à la fois de poudre et de sang, ils hoquetaient une ivresse de meurtre. Ils colportaient les racontars les plus inouïs.
— Ces communards ! grondaient-ils, ce sont des monstres, des bandits. Tous ceux des nôtres qu’ils font prisonniers, ils les pendent par les pieds et les égorgent.
— Est-ce possible ! exclamait mon père.
Il jouait bien la stupeur indignée. Sans doute eût-il voulu ajouter : « Êtes-vous bien sûrs de ce que vous
dites ? » Mais il se retint : il n’eût pas été prudent de paraître incrédule et son accent étranger suffisait, en pareil moment, pour lui jouer un mauvais tour.
Alors que dès le le début des hostilités, les Versaillais infligeaient les pires sévices à leurs prisonniers, quand ils ne les massacraient pas, les fédérés traitaient les leurs avec la plus grande humanité.
La légende des pétroleuses de la Commune, tout aussi véridique que celle des soldats pendus par les
pieds, fut inventée pour justifier les exécutions sommaires qui firent de Paris un charnier.
Nous dînâmes à la table commune des pensionnaires, affectant une sérénité combien légitime ! La prise du Panthéon n’allait-elle pas nous permettre de rentrer chez nous ?
Chez nous !
Nous avions échappé ce premier jour, mais les exécutions sommaires se succédaient et la situation demeurait angoissante.
Le 25, la rive gauche tout entière était au pouvoir de l’armée. Wroblewski, menacé d’être tourné par les Gobelins, s’était replié sur la rive droite avec un millier d’hommes et deux canons, débris de ses forces.
Ce jour-là, Delescluze se fit tuer stoïquement sur la barricade du Château-d’Eau.
Nous demeurâmes terrés rue de la Clef, feignant de craindre, en bourgeois trembleurs, un impossible retour offensif des fédérée. Nous ignorions les nouvelles et pressentions seulement que la Commune râlait.
Il en fut de même le 26. Dans la soirée, une immense clarté violette, d’une intensité aveuglante, vint illuminer le ciel au nord. C’étaient les docks de la Villette qui flambaient : cet incendie éblouissant, qui se différenciait des autres pourpre et or, éclaira la campagne dans un rayon de dix lieues.
Mais nous ne pouvions, sous peine d’éveiller les soupçons, prolonger notre réclusion. Et, dans la matinée du 27, nous partîmes tous les trois prendre l’air de Paris.
Nous nous acheminâmes non vers le Panthéon mais dans une direction tout opposée, vers la Bastille, nous donnant l’air satisfait d’une famille en agréable promenade.
Dans les rues, les passants, très clairsemés, se dévisageaient avec circonspection.
Et voilà que, soudainement, rue Buffon, nous apercevons une figure connue : heureusement celle d’un
brave homme.
Très pâle, l’individu vient nous serrer la main et, la voix tremblante d’émotion, nous conta son odyssée.
Il n’avait pas servi la Commune, mais il avait conservé aux pieds ses godillots du premier siège. Cela avait suffi pour le faire remarquer et arrêter.
Ses dénégations avaient été accueillies par des ricanements.
— Prenez votre escouade et fusillez-moi cette canaille ! avait commandé l’officier en faisant signe à un caporal d’emmener le prisonnier.
Par une chance presque miraculeuse, le cabot n’était pas comme son chef, dépourvu d’intelligence et
de cœur. En conduisant vers le mur fatal le malheureux qui continuait de protester et de gémir, il l’avait laissé s’échapper.
Combien d’autres, qui n’avaient pu renouveler leurs chaussures, ont été passés par les armes pour simple port de godillots !
Nous quittâmes le rescapé en nous souhaitant mutuellement bonne chance et continuâmes notre route.
La place Valhubert, le pont d’Austerlitz et la rue Lacuée portaient les traces d’une chaude lutte.
Sur la berge de la rive droite, près du pont, le cadavre d’un artilleur fédéré était étendu sur le ventre, le visage trempant dans la Seine.
Deux terrassements à hauteur d’homme barraient en partie le boulevard de la Bastille. Adossés contre ces retranchement gisaient, le teint cireux, raidis dans l’immobilité suprême, deux chasseurs à pied que les vainqueurs n’avaient pas trouvé le tempe d’enlever. Là était tombé la veille, au cours d’une reconnaissance nocturne, leur commandant Ségoyer.
Sur l’autre rive du canal Saint-Martin, le Grenier d’abondance achevait de se consumer ; l’incendie durait depuis quarante-huit heures.
La Bastille avait résisté deux jours. Tenus en échec par la barricade frontale de la rue Saint-Antoine, arrêtés par l’incendie du Grenier d’abondance, les Versaillais s‘étaient, par une passerelle jetée au confluent du canal, glissés le long de la berge de la Seine, la remontant rapidement sous le pont d’Austerlitz pour surgir sur le quai de Bercy et prendre à revers la barricade du pont. Les canonnières de la Commune, qu’ils avaient trouvées abandonnées au pont Royal, les avaient appuyés de leur feu dans cette opération.
Et, le 26, la Bastille, prise à revers, comme toutes les autres redoutes, avait succombé.
Pourtant, le 27 on se battait encore dans Paris. Sur la grande place que dominait, toujours immuable sur sa colonne, le génie de la Liberté, un cordon de lignards barrait l’entrée du faubourg Saint-Antoine et celle du boulevard Richard-Lenoir : les insurgés tenaient encore, bien que sans espoir, dans Belleville et aux Buttes-Chaumont. Quelles devaient être leurs pensées en cet instant suprême ! Mon cœur se serra en pensant à ces derniers combattants, héros sacrifiés d’une cause perdue.
Nous obliquâmes à gauche, en passant auprès du Grenier d’abondance. La pierre s’y était transformée en lave brûlante, ruisselant à terre. J’en ramassai un petit bloc, refroidi mais encore malléable, que j’ai conservé longtemps comme souvenir, qui dis parut, ainsi que tant d’autres. De mes reliques du passé je n’ai gardé, à travers les tempêtes de ma vie, que les cheveux de mes parents et un petit cabas brodé par ma mère dans son enfance.
Nous entrâmes dans la rue Saint-Antoine, prolongeant notre déambulation jusqu’à l’Hôtel de Ville. Une force invincible nous entraînait à voir ce qui restait de Paris, que noua aimions tant, après le passage du cyclone de fer et de feu.
La Maison Commune n’était plus qu’un amas de décombres. Que de souvenirs héroïques planant sur ses ruines ! À gauche, au coin de la rue Saint-Martin, une maison s’était effondrée, fumante encore et, sous l(amoncellement des gravats mêlés de ferraille, gisait un cadavre de fédéré.
Nous venions de dépasser de quelque cent mètres la caserne Lobau. Nous ne nous doutions pas qu’elle était transformée en abattoir ou, pour aller plus vite, les vainqueurs expédiaient à la mitrailleuse des centaines de prisonniers à la fois. Cette tuerie avait lieu dans la cour et les murs épais en étouffaient l’écho.
Le lendemain 28, un dimanche, nous pouvions lire, placardée sur les murs, cette brève proclamation de Mac-Mahon :
Habitants de Paris,
L’armée de la France est venue vous sauver. Paris est délivré.
À quatre heures, les dernières positions occupées par les insurgés ont été enlevées par nos soldats.
Aujourd’hui, la lutte est terminée ; l’ordre, le travail et la sécurité vont renaître.
Le maréchal de France,
commandant en chef,
DE MAC-MAHON,
duc de Magenta.
L’ordre régnait en effet : la fusillade était en permanence. Dans chaque arrondissement était instituée
une cour prévotale qui envoyait à la mort les prisonniers par fournées. Le Père-Lachaise, les Buttes-Chaumont, le parc Monceau, le bois de Boulogne, la caserne Lobau étaient les principaux abattoirs. Mais il s’en trouvait d‘autres.
Camille Pelletan, dans son livre La Semaine de Mai, a évalué à 35.000 le nombre des victimes fusillées sans jugement par les versaillais. Maxime du Camp, dans Les Convulsions de Paris, ouvrage empli d’une haine sarcastique des communards, réduit ce chiffre à 6.000, ce qui serait déjà plus qu’impressionnant, mais qui est formidablement au-dessous de la vérité.
Le 26 avait été fusillé Millière qui, malgré sa carrière de militant socialiste, n’avait point participé au
mouvement de la Commune et avait même conservé son mandat de député, se bornant a résider à Paris, loin de l’Assemblée. Arrêté illégalement par le capitaine Garcin, il fut aussitôt, sans débats ni même comparution, condamné à mort par le général de Cissey, qui achevait de déjeuner. Quel dessert, cette exécution d’un républicain socialiste !
Comme exemple terrifiant aux ennemis de la société, ses bourreaux décidèrent qu’il mourrait à genoux (deux soldats l’y mirent de force) sur les marches du Panthéon, ils ne s’aperçurent même pas que cet assassinat théâtral, qui les déshonorait, grandissait le martyr. Millière mourut en criant : « Vive l’humanité ! »
Plus tard, le capitaine Garcin, alcoolique invétéré, mourut fou. Le général de Cissey, devenu ministre
de la guerre, sombra dans le mépris public, amant et jouet d une espionne allemande.
Paris était aux mains de ces gens-là !
Nous lisions ces détails dans les journaux, qui avaient recommencé à a paraitre. Bien entendu, à l’exception du Rappel, qui devint l’organe d’avant-garde, c‘est-a-dire de défense républicaine, et du Siècle, très en vogue chez les marchands de vins, Il n’y eut, pendant les premiers temps, que des journaux réactionnaires. C’était la terreur tricolore et même blanche, car les champions de la monarchie légitime, guidés par les évêques, avaient le vent en poupe. Le Bien public, d’étiquette républicaine cependant, avait pour rédacteur en chef Henri Vrignault, qui se vantait d’avoir fusillé grand nombre de fédérés.
Nous avions repris nos déambulations dans Paris, où nous trouvions partout des ruines titaniques. Sur la rive droite et sur la rive gauche, sur les boulevards, dans les rues, même amoncellement de décombres fumants, d’où sourdait encore la flamme et sur lesquels des pompiers venus de province (même de Londres!) dirigeaient les jets de leurs lances.
Rue de Lille, à deux pas de la Cour des comptes et de la Légion d’honneur, dont il ne restait que des pans de façades lézardées, on voyait l’angle intérieur formé par deux pans de murs d’une maison coupée obliquement dans toute sa hauteur. Les cinq premiers étages s’étaient effondrés en tas informe, ne laissant debout que ces deux murs noircis ; mais du sixième il restait un fragment de
mansarde — un triangle d’à peu près deux mètres, qui supportait un lit et une petite table. Il semblait à tout instant que ce bout d’étage, suspendu par miracle dans le vide, dût s’écrouler avec ses pauvres meubles. Qu’était devenu l’occupant ?
L incendie des Tuileries avait détruit entièrement la vieille demeure monarchique, témoin des intrigues et des orgies de la cour impériale. Le feu, qui purifie, avait ici fait œuvre d’art en permettant, après le déblaiement des décombres, l’ouverture d une perspective admirable. Sans doute, aujourd’hui, les flâneurs qui du Carrousel voient s’étendre devant eux, dans un cadre de verdure, une large allée ininterrompue jusqu’à la masse imposante de l’Arc de Triomphe dominant l’horizon, ne songent-ils pas que c’est la Commune qui leur valut cet embellissement édilitaire !
Le ministère des finances, le Palais-Royal, les théâtres de la Porte-Saint-Martin et de l’Ambigu, les grands magasins du Tapis Rouge, et combien d’autres édifices, étaient détruits. Ils se sont, depuis, relevés de leurs ruines.
Les Versaillais ont répandu la légende des pétroleuses, ce qui leur a servi de prétexte pour fusiller des femmes, quelques-unes combattantes, d’autres, ambulancières. Mais un an ou deux après la Commune on arrêta un propriétaire qui, pour toucher son indemnité d’assurance, avait mis le feu à l’un de ses immeubles. Il fut convaincu d’incendie volontaire et condamné. Les débats montrèrent que le même propriétaire avait déjà encaissé des indemnités pour la destruction de trois autres maisons lui appartenant, incendiées pendant la bataille dans Paris. Des innocents n’ont-ils point été fusillés ou jetés au bagne pour le crime de ce pratique monomane ?
Mais tout en contemplant les vestiges de l’horrible épopée, nous cherchions une chambre meublée. Maintenant que la lutte était terminée nous ne pouvions continuer à loger à la pension de la rue de la Clef.
Par cet instinct du pourchassé dont parle Victor Hugo dans Les Misérables, nous cherchâmes à mettre le fleuve entre nous et notre ancien habitat. Sur la rive droite, les rencontres indésirables étaient moins à craindre.
À cette époque, dont nous sépare tout un monde, les maisons de Paris exhibaient encore des pancartes portant : « À louer ». Tantôt c’était un grand appartement, tantôt un petit logement, quelque fois une chambre meublée.
Nous trouvâmes un garni convenable rue de Richelieu, et nous nous donnâmes, cette fois, pour une famille arrivée de province. À ce moment il n’était pas permis aux Parisiens « délivres » par l’armée de Mac-Mahon de quitter leur ville soumise aux beautés de l’état de siège, mais provinciaux et étrangers pouvaient y débarquer. Et il arrivait beaucoup d’Anglais, curieux de voir « les ruines de Paris ». Les guides leur en donnaient pour leur argent.
— Very beautiful, indeed ! prononçaient avec conviction des misses admiratives.
Nous quittâmes l’hospitalière maison Rogier-Bénard sans laisser soupçonner à sa tenancière quels êtres dangereux elle avait soustraits à la juste vindicte des lois.
D’autres étaient moins heureux que nous. Je me rappelle, entre autres scènes tristes, un long convoi de prisonniers, encadrés de soldats, et dans lequel il y avait des femmes.
Par la rue de Rivoli, sous les regards des passants qui n’osaient s’apitoyer, ils s’acheminaient, exténués, silencieux, dignes cependant, dans la direction de Versailles. Versailles, la ville monarchique qui venait de saigner Paris, ville du travail et de la Révolution.