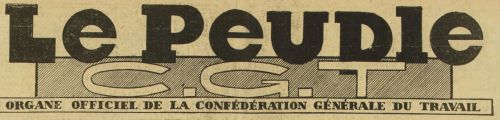Chapitre XV
Justice civile et justice militaire
J’ai parlé peut-être un peu trop longuement de la guerre de 1870 et de la Commune qui l’a suivie. Il m’a semblé que ces formidables événements, dont mon cerveau de treize ans avait été impressionné, devaient être pour les lecteurs d’un intérêt beaucoup plus sensible que mes faits et gestes de gamin.
Je résumerai les événements qui suivirent jusqu’à notre départ pour la Nouvelle-Calédonie.
Nous déménageâmes nombre de fois pour effacer notre trace. L’état de siège durait toujours ; le général Ladmirault, gouverneur de Paris, investi de pouvoirs discrétionnaires, en usait largement.
Les fusillades sommaires avalent cessé, mais non les exécutions 1La dernière eut lieu en 1875 : c’était celle d’un soldat qui s’était trouvé à une des manifestations de la Bastille, antérieures au 18 mars, le jour même où une foule exaspérée avait jeté à l’eau l’agent secret Vinzentini.; les conseils de guerre, qui jugeaient sans arrêt, se montraient impitoyables. La presse démocratique était
muselée et les revenants du moyen âge siégeant à l’Assemblée de Versailles se ruaient à l’assaut de la
République.
« Étrangler la gueuse » était leur mot d’ordre.
Un jour, soudainement — nous demeurions alors rue Française — le commissaire de police apparut chez nous. Presque poliment, il signifia à mon père un décret d’expulsion qui lui accordait quarante-huit heures pour mettre ordre à ses affaires. Apres quoi, le représentant de l’autorité se retira.
Nous demeurâmes stupéfaits de la bénignité relative de cette mesure. Plus tard, nous en connûmes la cause.
Le ministre de l’Intérieur était alors Ernest Picard qui, par son mariage avec une demoiselle Liouville, se trouvait alors allié à la famille de ma mère. En compulsant les listes et dossiers de communards contumax, il avait rencontré le nom de mon père : Malato de Cornet, gendre de l’universitaire Amand Hennequin. Le ministre avait eu des égards pour le nom et la parenté ; il avait prononcé la mesure la moins rigoureuse en pareil moment : l’exil d’un révolutionnaire.
Sans perdre de temps, nous tînmes conseil. Ou aller ? La période des deux sièges et de la grande terreur versaillaise avait porté un rude coup à la situation financière de mes parents. Mon père qui, doué d’une infatigable activité, aimait à brasser des affaires, s’occupant surtout de commission et d’exportation, avait discrètement renoué des relations avec quelques commerçants. Il était en bonne voie et, maintenant, tout craquait !
S’exiler ? Mais où ? En Angleterre ? Aux États-Unis ? Mon père ne connaissait pas un mot d’anglais et ne possédait aucune profession manuelle. Moi, j’avais commencé à l’institution Boyer, puis forcément interrompu, en même temps que l’étude du latin, celle de l’anglais et de l’allemand, telle qu’elle se pratiquait alors à coups de thèmes et de versions, dans la méthode Ahn, laissant l’élève le plus ferré sur la grammaire incapable de soutenir la moindre conversation.
En Belgique, les communards réfugiés étaient traqués par la police. La foule bien pensante était allée briser les vitres de Victor Hugo. En Suisse, en Espagne, il y avait peu à faire.
Nous résolûmes de rester quand même à Paris, en déménageant une fois de plus.
Un gros souci de mon père avait été de voir mes études interrompues par la force des circonstances. Quoique ayant été assez bon latiniste, il n’avait pas le culte des langues mortes ; le grec, notamment, lui paraissait peu utile. Mais, pour arriver un jour au doctorat en médecine — ce qui était mon ambition — il fallait absolument décrocher les deux baccalauréats, ès lettres et ès sciences, pour lesquels la connaissance au moins superficielle du grec classique était de rigueur.
J’avais commencé tout seul l’étude de la langue d’Euripide et, entre deux déménagements, je piochais Burnouf. Lecture qui me parut plus aride que celle de Paul de Kock. Cependant, servi par une mémoire peu ordinaire, j’arrivai, malgré les cahots de notre existence, à ne pas me laisser distancer par les bourgeoisillons de mon âge, acquérant cette instruction livresque, tout en surface, qui fait honneur aux forts en thème. Instruction qu’il est nécessaire d’oublier en partie pour s’en refaire soi-même une plus réelle lorsque l’époque de compréhension est arrivée.
Une famille de trois personnes, aux âges et signalements connus et dont le chef possède un fort accent
étranger, a du mal à dissimuler indéfiniment sa trace, même dans une grande ville comme Paris. En rencontrant la piste de l’enfant, on devait tomber sur celle des parents.
Ce fut ma grand’tante qui, venue dans la capitale, après avoir vendu sa maison de Toul, se chargea de
mon placement dans un établissement scolaire.
Deux de ses amies de province, Mme Desloges et la baronne de l’Epinault, qui ignoraient la vie révolutionnaire de mon père, avaient des influences à l’École commerciale Saint-Paul : elles m’y firent admettre facilement. Cet établissement, antérieurement dénommé École des Francs-Bourgeois et fondé d’abord dans le Marais par un pédagogue congréganiste, garde aujourd’hui son nom d’il y a un demi-siècle et est dirigé par des professeurs laïques. J’ignore quel esprit et quelles méthodes y règnent maintenant.
À l’époque où j’y entrai, au milieu de condisciples appartenant à des familles bourgeoises et bien pensantes, l’enseignement des langues mortes n’y était donné que facultativement, la plupart des élèves se destinant au commerce ou à l’industrie Celui de l’anglais et de l’allemand, par contre, était général, sans valoir mieux que dans tout autre établissement d’instruction secondaire. L’histoire y était présentée de la façon la plus fausse et la plus réactionnaire, la littérature soigneusement expurgée. Mais la tenue des livres y était en honneur, ainsi que la musique vocale ou instrumentale : ces deux branches de l’enseignement ne me passionnaient point, non plus que les mathématiques.
Mon père n’était pas charmé de me voir là, mais il me savait assez de discernement et de volonté pour ne point m’y abrutir. Il comptait, d’ailleurs, ne m’y laisser que très temporairement et, en attendant, il favorisait ma passion pour la lecture, qui me permettait d’écouter les divers sons de cloche pour me faire des opinions personnelles.
Comme presque tout le monde, il croyait proches la levée de l’état de siège et l’amnistie. Du coup, certainement, son arrêté d’expulsion tomberait et, reprenant sa liberté d’allures, il me ferait terminer mes études au lycée Charlemagne. En attendant, je servais plutôt de couverture. Comment s’imaginer que ce collégien au képi bleu de ciel, sortant d’un établissement bien pensant en la correcte compagnie de fils de richards, pût être le rejeton d’un farouche communard ?
Mais, hélas ! l’amnistie ne vint pas. Tout au contraire ! Le 24 mai, date fatidique, anniversaire de notre exode dans Paris, Thiers était renversé par l’Assemblée monarchiste et remplacé par Mac-Mahon. Celui-ci formait aussitôt un ministère « de combat » présidé par le duc de Broglie. La première mesure que prirent ces fiers combattants, appelés au pouvoir par le vaincu de Reichshoffen et de Sedan, vainqueur de Paris, fut de réviser dans le sens draconien les dossiers des communards.
Ranc qui, élu membre de la Commune, ne l’était resté que pendant sept jours, après avoir prêché en vain la conciliation, fut poursuivi alors qu’il venait d’être élu député du Rhône. Il n’eut que le temps de se sauver en Belgique pendant qu’on le condamnait à mort par contumace.
Fâcheux présage pour nous, comme pour d’autres !
Un soir, comme j’accompagnais ma mère, elle remarqua dans notre sillage, aux alentours de la rue du Roi-de-Sicile, où nous habitions, les louches allures d’un personnage.
Visiblement, il nous suivait.
Ma mère avait l’horreur de tout ce qui est vil, Ralentissant soudainement son pas, puis se retournant, de façon à être bien entendue de l’homme de la Préfecture, elle me dit à haute voix :
— Sais-tu qu’il existe des individus qui font métier de suivre des honnêtes gens dans la rue et de s’approcher hypocritement pour surprendre leurs paroles ? Ces individus, plus méprisables que les voleurs et les assassins, on les appelle des mouchards.
Sans doute, l’homme ne fut-il pas charmé d’avoir à avaler cette sortie, aussi justifiée qu’imprudente. Cependant, il ne broncha pas : d’autant plus que n’étant point pris à partie directement, il ne pouvait souffler mot sans se dévoiler. La profession de mouchard, comme beaucoup d’autres plus honorables,
a ses exigences !
Nous nous abstînmes de rentrer droit rue du Roi-de-Sicile et, après avoir promené derrière nous l’individu penaud, irrésolu, finîmes par le semer.
Cette rencontre présageait la tempête.
Elle fondit sur nous.
En ce moment, mon père était en voie de rétablir sa situation endommagée par les événements. Sous la gérance d’un cousin de ma mère, A. H…, exempt de toute passion révolutionnaire, il avait créé trois dépôts d’alimentation, les garnissant de marchandises. Déjà, ses établissements étaient en pleine prospérité. L’un d’eux allait être revendu avec un très fort bénéfice. Puis ce serait la tour des autres.
Soudain, mon père reçut d’un ami, fonctionnaire de l’État, cet avis : « Fuyez. Votre dossier a été révisé : un conseil de guerre vous a condamné, par contumace, à la déportation dans un enceinte fortifiée. On est sur votre trace. »
C’était l’écroulement !
Mon père courut chez un avocat de sa connaissance qu’il avait [?] obligé à ses débuts dans le barreau. Il le chargea d’assister ma mère pour liquider la situation dans les meilleures conditions possibles. C’était facile : les marchandises avaient été achetées régulièrement, les unes au comptant, les autres à terme ; pas un sou de dettes ! pas un billet impayé ! Cette mesure prise, mon père donna quelques instructions au cousin, puis il partit pour Bruxelles, où il descendit droit chez Maurice Lachâtre.
Mais l’autorité militaire était maîtresse. En vertu des pouvoirs discrétionnaires que lui conférait l’état de siège, le général Ladmirault fit, d’autorité, arrêter ma mère et notre parent H…, fermer les trois maisons et ouvrir une instruction contre mon père comme… négociant en fuite.
L’affaire se transportait du terrain politique sur le terrain du droit commun !
Le même coup qui, en 1849, avait été jésuitiquement machiné contre Proudhon, fondateur de la Banque du Peuple, pour le déclarer banqueroutier 2«L’arrestation de Proudhon », article d’Alfred Darimon, publié dans le Peuple du 15 juin 1849, reproduit soixante-dix-huit ans plus tard, par le Peuple du 15 juin 1927..
J’étais à ce moment interne à l’école commerciale Saint-Paul, et, tout en continuant mes études, suivais, angoissé, la tragédie familiale.
Mon père, apprenant l’arrestation de sa femme, revint aussitôt et courut chez son avocat. Valait-il mieux se constituer immédiatement prisonnier, dans l’espoir d’assurer la liberté de ma mère, ou bien assurer au préalable la liquidation commerciale ?
Tel était le problème désespérant que se posait le révolutionnaire, qui ne bronchait pas devant le péril de mort mais à qui l’idée d’une flétrissure civile, même méritée, était intolérable.
La police le tira d’embarras en l’arrêtant.
Il n’y avait pas d’affaire plus politique que celle-là : car c’était le communard condamné par contumace et près d’être atteint qui avait fui, non le commerçant solvable et ne devant rien à personne.
Mais dans les époques de répression féroce, c’est une joie des partis politiques de pouvoir déshonorer perfidement leurs adversaires.
Au lieu de la déportation, cruelle mais non infamante, c’était l’enfer ignominieux du bagne qu’on destinait à mon père comme banqueroutier frauduleux, la prison pour ma mère accusée de complicité et jetée dans le hideux cloaque de Saint-Lazare, où grouillent toutes les misères morales, tous les vices, toutes les déchéances !
Et cette double infamie fut pour s’accomplir, s’ajoutant à de longs mois de détention préventive. Au
jourd’hui même, au bout de trois quarts de siècle, emplis de luttes et d’orages, quand je me rappelle ce
moment de mon existence ou je vis mon père qui avait, depuis trente ans, sacrifié sa fortune sa situation et joué sa vie pour la cause de la liberté ; ma mère, d’une bonté et d’une droiture si hautes, comparaître devant des hyènes à face humaine, une rage froide gronde encore en moi.
Ce sont les étreintes d’angoisse, les révoltes de fureur indignée, venues à ce moment-là secouer mon être, qui ont, bien plus qu’un catéchisme socialiste ou anarchiste, fait de moi, pour le reste de la vie, un révolté contre l’oppression et l’injustice.
Mais la destinée est insondable et c’est souvent quand on est au plus bas qu’elle vous relève par un coup de théâtre.
Cette chance in extremis, mes parents et moi l’avons eue souvent dans les situations les plus désespérées.
La justice de la cour d’assises avait prononcé après un réquisitoire menteur où il n’avait guère été question que de politique, de Commune et de la sortie du Mont-Valérien, mon père s’y trouvant, pour les besoins de la cause, transformé de modeste capitaine en chef de bataillon.
Le cousin H…, lui, qui n’avait pas servi la Commune, avait été rendu à la liberté. Mais voici que le conseil de guerre réclame sa proie : c’est à sa juridiction seule qu’appartenait mou père. Et son défenseur Demange, déjà pressenti un grand avocat — le même qui défendra un jour Dreyfus — pose la question sur son véritable terrain : ou la disjonction des sentences avec leur application successive, ou la sentence unique du conseil de guerre. Miracle ! Le conseil de guerre comprend, et, écœuré de l’œuvre des robins, il l’annule en condamnant contradictoirement le révolutionnaire à la déportation simple. Du coup, la procédure et la sentence infamantes sont détruites.
Je suis dans la salle du conseil de guerre, où j’ai entendu notre ancien voisin, l’ex-lieutenant Chanois, rendre hommage à la conduite humaine du capitaine de la Commune.
Au prononcé du jugement, je vois le visage de mon père et celui de son défenseur rayonner. Ils se serrent chaleureusement la main. Puis Demange, qui m’a reconnu, s’avance vers moi et me répète ces paroles d’encouragement qu’il m’a déjà dites dons son cabinet : « Il n’y a plus qu’à attendre l’amnistie. »
Ainsi mon père, qui a déjà, par deux fois, échappé à une sentence de mort eu Italie, échappe au bagne que lui réservaient les magistrats français ! Plus heureux que l’instituteur martyr Pierre Vaux, mort forçat à la Guyane et réhabilité seulement après son décès, il voit la flétrissure effacée par les mêmes juges militaires qui lui rendent sa qualité d’adversaire politique.
De la prison du Cherche-Midi il va être immédiatement dirigé sur le dépôt de Saint-Brieuc, au milieu des communards condamnés à la déportation. Déjà une frégate-transport, le Var, attend en rade de Brest ce troupeau de vaincus qu’il doit transporter à Nouméa.
Naturellement, du même coup, ma mère va se trouver rendue à la liberté. L’inique jugement de la cour d’assises se trouvant cassé pour mon père l’est forcément pour elle. Des chacals de la loi, furieux de voir cette proie leur échapper, ont beau argoter, tenter de retarder la solution : celle-ci est inévitable. Et c’est au moment où le Var va nous emmener tous trois aux antipodes de la vieille Europe, que l’autorité galonnée vient annoncer à la prisonnière qu’elle est libre. De ses dix mois passés au milieu des filles et des voleuses, victimes de la société, moins horribles que leurs gardiens, il ne doit plus rester que le souvenir d’un mauvais rêve.
Cette hideuse masure de Saint-Lazare, où tant de fois je suis allé au parloir voir ma mère, j’y suis retourné depuis, à mon retour de la « Nouvelle », pour visiter une autre femme captive elle aussi, et qui a laissé la réputation méritée d’une sainte laïque : Louise Michel.
La grande révolutionnaire, qui a maintenant sa statue devant la mairie de Levallois-Perret, était condamnée comme instigatrice du pillage d’une boulangerie dans laquelle une foule miséreuse avait pris deux petits pains !
- 1La dernière eut lieu en 1875 : c’était celle d’un soldat qui s’était trouvé à une des manifestations de la Bastille, antérieures au 18 mars, le jour même où une foule exaspérée avait jeté à l’eau l’agent secret Vinzentini.
- 2« L’arrestation de Proudhon », article d’Alfred Darimon, publié dans le Peuple du 15 juin 1849, reproduit soixante-dix-huit ans plus tard, par le Peuple du 15 juin 1927.