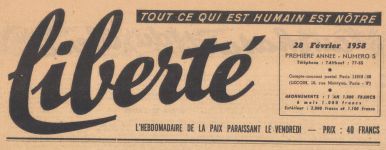Selon Martin du Gard, il faudrait désormais classer les gens en deux catégories : selon qu’ils acceptent ou refusent l’idée de guerre. J’ignore si, partant de ce choix, aux termes inévitablement manichéens, la pensée de l’ancien Prix Nobel se contente d’éclairer majestueusement une protestation de l’esprit ou bien si, débordant le contexte moral et moralisateur — de l’humanisme qui la porte, elle entend assumer la pleine revendication de ce qui constitue, en bref, le véritable refus de la guerre : le refus également physique, social, matériel, le refus dans l’illégalité totale et le risque des désignations infamantes. Je n’écris certes pas ceci dans le but d’éveiller quelque mauvaise querelle au sujet des convictions pacifistes et des moyens mis en œuvre pour leur prêter ce minimum d’efficacité sans quoi toute conception de l’humain peut se trouver paralysée par la gratuité, le confort intellectuel, se figer, en un mot, dans l’abstraction. Il est vraisemblable, en effet, que le jugement auquel incitent de telles attitudes, déterminées non seulement par le choix personnel, mais aussi par le paradoxe des événements, exige des critères plus nuancés. Mais soulever délibérément le problème de l’acceptation ou du refus de l’idée de guerre, n’est-ce pas admettre implicitement de se prononcer sur ceux qui, en effet, refusent l’idée même de la guerre, puisqu’ils n’en tolèrent l’éventualité sous aucune justification, puisque le seul fait de tuer, de frapper, d’exercer la violence, leur paraît incompatible avec la connaissance civilisatrice, spirituelle, philosophique, que l’humanité a prise d’elle-même ?
■
Il est donc bien évident que, de ce point de vue, c’est l’objection de conscience qui porte le plus haut, le plus absolu témoignage, face à un monde hostile, ou ignorant, veule, désespérément incompréhensif. « Ainsi, le seul fait de revêtir un uniforme met votre conscience en danger ? » demandait à l’étudiant Pierre Tourne, le magistrat qui le jugeait. « Oui » répondit simplement Pierre Tourne. Toute la question est là. On peut avoir soi-même une conscience, en être intensément tourmenté, et très honnêtement, malgré tout, désapprouver la sorte d’objection qui se place sous ce vocable, simplement parce que l’on pense, en le déplorant, que les conditions d’existence humanitaire, à l’intérieur des sociétés et dans les rapports entre nations sont encore trop relatives pour qu’une opposition absolue à toute forme de violence — dont on soulignera qu’elle peut prendre parfois, à l’égard du mal, un caractère punitif et défensif — ne risque pas d’aller à l’encontre de son but en favorisant ce qu’elle abhorre : l’acte de tuer. C’est la fameuse théorie du mal nécessaire, et, du même coup, sa négation subtile : le mal qui se transcende ainsi ne devient-il pas le bien ?
■
On répondra, de l’autre côté, que c’est précisément la violence en tant que telle qui est la cause de tous ces maux, puisqu’elle est la dégradation antinomique du concept d’humanité et que l’humanité ne retrouvera sa raison d’être qu’en corrigeant l’instinct qui, perpétuellement, déforme son rôle. « Les événements ne m’intéressent pas, disait Valéry à Gide. Ils ne sont que l’écume des choses. Ce qui m’intéresse, c’est la mer. » Sans doute en est-il un peu ainsi entre les objecteurs et ceux qui raisonnent à partir de données réalistes : ces derniers s’inquiètent du bouillonnement à la surface, les autres songent aux profondeurs. Mais quoi qu’il en soit, un dialogue est possible, dans l’honnêteté ; un vrai dialogue, au sens où l’entend Camus, autre Prix Nobel et membre du Comité pour le secours aux objecteurs de conscience. C’est qu’il n’est plus concevable de maintenir, dans les pays du globe où elle s’exerce toujours, une répression qui, finalement, ne sert à rien ni à personne. Se refuser à toute discussion sur l’objection de conscience au nom de principes bien définis et comme si le service de guerre était toujours allé de soi pour la majorité des hommes qui peuplent la planète, c’est oublier l’Histoire un peu vite, et par exemple que la démocratisation des tâches militaires relève d’une contrainte relativement récente. La conscription, innovation française qui remonte à 1793 et qu’une grande partie du monde a suivie depuis, n’a pas été sans soulever des difficultés d’ordre moral. Mais il est à retenir que, la même année du reste, la Convention se montra plus compréhensive que ne l’est encore, en 1958, l’Assemblée nationale. On en trouvera la preuve dans ce décret pris en faveur des anabaptistes :
« Le Comité de Salut Public arrête qu’il adressera aux Corps administratifs la lettre suivante : Les anabaptistes de France, citoyens, nous ont député quelques-uns d’entre eux pour nous représenter que leur culte et leur morale leur interdisaient de porter les armes et pour demander qu’on les employât dans les armées à tout autre service. Nous avons vu des cœurs simples et nous avons pensé qu’un bon gouvernement devait employer toutes les vertus à l’utilité commune et c’est pourquoi nous vous invitons d’user envers les anabaptistes de la même douceur qui fait leur caractère, d’empêcher qu’on les persécute, et de leur accorder le service qu’ils demandent dans les armées, tel que celui de pionnier et celui de charrois, ou même de permettre qu’ils acquittent ce service en argent. »
■
Dans sa thèse sur l’objection de conscience, Me Jean Gauchon montre comment, au cours du XIXe siècle, s’établit progressivement la distinction fondamentale entre l’insoumission et la désertion. Mais ce sont là des clauses juridiques que le commun des mortels saisit mal, ou qu’on néglige, il est vrai, de lui apprendre. Il sait qu’on est soldat à vingt ans, il le sait presque de naissance et s’il redoute les guerres, il ne voit certes pas ce qui pourrait contrarier cet état de fait. Le conscrit fait partie de la mythologie sociale. Il se promène, un peu ivre, le veston enrubanné, portant sur son cœur l’inscription « Bon pour le service », dont les lettres fragiles ont la couleur et le style de celles qu’on accroche aux couronnes mortuaires.
■
Il y a pourtant beaucoup de pays sans conscrits. Je sais bien qu’il serait ridicule d’entretenir à ce sujet la moindre illusion. La plupart de ces pays n’ont pas institué le service militaire obligatoire pour la simple raison que le stade actuel de leur évolution économique et culturelle ne le leur permet pas, ou bien parce que leur position politique est tributaire du contrôle que les deux blocs exercent sur leur faiblesse. Toutefois, leur degré de pacifisme se mesure, de la façon la plus tangible, aux dispositions qu’ils prennent, en faveur des objecteurs de conscience, dans le cadre d’un statut officiel. En certains cas, malheureusement, l’esprit de discrimination a conduit le législateur à ne reconnaître que les objecteurs religieux ou bien encore à n’accorder, en des lieux où la conscription est obligatoire pour les hommes et les femmes, une dispense qu’au sexe qu’on semble avoir moins de raisons, cependant, de tenir encore pour faible. Le service mixte n’est guère appliqué que dans plusieurs démocraties populaires, dans quelques nations de l’Amérique du Sud ou du Proche-Orient. Partout ailleurs, les hommes seuls sont appelés. Enfin, les nations suivantes reconnaissent les objecteurs de conscience, sans distinction d’aucune sorte, et notamment de quelque philosophie qu’ils se recommandent : Allemagne de l’Ouest, Australie, Autriche, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suède. Vient ensuite un second ordre de considérations, arbitraire celui-là, et qui n’admet que les objecteurs de type religieux : c’est le cas de l’Afrique du Sud, des États-Unis, du Paraguay, qui limite même très étroitement ses dispositions aux membres de certaines sectes, des Pays-Bas, qui les étendent, au contraire, un peu au-delà du facteur religieux et admettent, en marge, le bien-fondé des préceptes moraux de caractère agnostique, et enfin, de la Rhodésie. Israël, où la conscription est obligatoire pour les deux sexes, s’en tient aussi à une objection « religieuse et morale », ne l’imagine que chez les femmes, et plus curieusement encore, ou non sans habileté, chez les femmes célibataires. L’U.R.S.S. a rétabli, depuis le vingtième Congrès, un statut dû à Lénine, mais en le limitant elle aussi, et en ce qui la concerne, de façon assez inattendue, aux objecteurs religieux. La Pologne, tout en faisant respecter son système mixte de conscription, sait faire preuve, parfois, de tolérance. En Bolivie, le refus de servir entraîne essentiellement la perte de la citoyenneté. Certains pays, comme la Belgique, s’efforcent, en préparant le principe de la reconnaissance légale (le gouvernement a déposé un projet devant le Parlement), de temporiser afin de ne pas aggraver la répression. C’est ainsi que la période d’emprisonnement n’excède pas celle du service militaire. Ailleurs, c’est-à-dire là où l’objection est totalement ou imparfaitement reconnue, un service civil remplace, en général, le service militaire et les jeunes gens qui refusent de se laisser incorporer sont affectés à des tâches d’intérêt social. Quant aux pays qui se montrent toujours réticents à l’élaboration d’un statut, les peines qu’ils appliquent sont extrêmement variables, très élevées ou volontairement assouplies par des subtilités d’ordre juridique, répétées jusqu’à ce que l’opposant ait atteint l’âge à partir duquel un homme ne peut plus être mobilisé ou modifiées, au moins dans leur nature coercitive, par l’application de lois d’amnistie. En Allemagne, en Yougoslavie et en Grèce, des objecteurs ont été fusillés pendant la guerre.
■
Quels sont maintenant les pays où la circonscription n’existe pas ? On peut, sauf risque d’erreur, les énumérer ainsi : Afghanistan, Arabie Saoudite, Birmanie, Canada (où lorsque le service était obligatoire, fonctionnait un statut des objecteurs), Ceylan, Cuba, Costa Rica, Côte de l’Or, Éthiopie, Ghana, Haïti, Inde (qui dispose d’un Corps national de Volontaires hommes et femmes), Indonésie, République Irlandaise, Islande, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Maroc, Monaco, Pakistan, Panama, Soudan. On remarquera que, dans cette liste, figurent naturellement beaucoup de pays situés dans les zones de sous-développement économique, des nations qui, comme par exemple, l’Inde, le Laos, le Maroc, Ghana, etc., ont, plus ou moins récemment, accédé à l’indépendance. Parmi ces dernières, le Vietnam et la Tunisie ont toutefois établi la conscription. La Tunisie ne l’applique pas encore et son gouvernement a mis à l’étude un statut concernant les objecteurs. Mais beaucoup d’autres pays ont eu la même initiative, sur le plan parlementaire ou ministériel, et l’on attend toujours qu’il en résulte une mesure effective. Il est aussi des lieux où certains arrangements, sinon avec le ciel, en tout cas avec l’État, conduisent à compenser des exigences d’ordre militaire par la nécessité de pallier divers inconvénients. Il arrive que la loi ne soit pas appliquée, ou bien qu’on n’incorpore pas tout le monde, soit qu’on doive y renoncer financièrement, soit encore qu’on ait trop besoin des représentants de certaines catégories professionnelles pour les envoyer ramasser les papiers dans la cour du quartier.
■
Le régime de la conscription est assez complexe et mériterait, à lui seul, une étude approfondie. Là où les femmes sont également appelées, en Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, ainsi qu’au Chili (où le recrutement se fait toujours par tirage au sort), au Honduras, en Perse et en Israël, des dispositions spéciales interviennent parfois en leur faveur. Il faut du reste préciser qu’en Hongrie, le service féminin concerne les périodes de guerre. Quoi qu’il en soit, on aura pu s’apercevoir, à la lecture de cette étude très générale, et forcément schématique, que beaucoup de nations, et parmi celles qui se recommandent le plus expressément des grandes missions civilisatrices, n’acceptent pas d’assouplir, même très légèrement, leur régime de conscription par le jeu d’un statut des objecteurs, qui pourrait facilement prévoir, cependant, l’établissement d’un service civil. Pour convaincre les autorités de leur bonne foi, la plupart des objecteurs vont jusqu’à réclamer un service plus long et plus pénible que celui des casernes. On peut donc assurer, partant de là, abstraction faite de toute conviction personnelle, de tout argument subjectif, que le risque, du point de vue même qui est celui de la défense nationale, ne serait pas très grand. Le Japon et la Birmanie sont allés jusqu’à déclarer la guerre hors la loi dans leur Constitution. Compte tenu d’une attitude qui n’engage le choix humain que dans les termes, n’est-ce pas cependant hausser l’objection de conscience, acte par essence individuel, jusqu’au comportement moral de la communauté ? On dira que l’altruisme ne jaillit pas miraculeusement d’une proclamation légale. C’est vrai. Mais l’important est dans les prises de position. Si l’on s’obstine, dans certains pays, à rejeter les objecteurs dans un ghetto, faudra-t-il, du même coup, honnir la mémoire d’Einstein, dont on oublie un peu trop qu’il nous a laissé cette déclaration sans ambiguïté : « Les pionniers du monde sans guerre sont les jeunes gens qui refusent le service de guerre. »
Roger Bordier