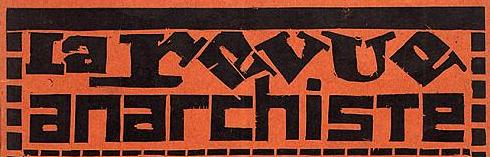Grand’mère nous contait comme, dans son enfance, on passait des heures en classe à apprendre… la révérence. Ce joli salut d’autrefois était assez difficile à réussir, en outre, il prenait du temps.
Aussi n’était-il guère du goût des enfants, qui l’escamotaient ainsi : pinçant la jupe, elles se contentaient de fléchir les genoux sur place, d’où un salut plongeant, plutôt cavalier, qui nous amusait beaucoup. Grand’mère riait en l’exécutant, et nous le lui redemandions souvent.
Ah ! L’étiquette ! Rien de plus curieux que le cérémonial usité chez les parents de Kropotkine pour le bonjour du matin, corvée pesante aux enfants.
Chez nous, c’était un baiser sur chaque joue au lever, au coucher. Toujours deux, et posément, s’il vous plaît. Cette régularité avait quelque chose de glaçant, et bien fait pour dégoûter des baisers.
Les vieilles gens déplorent la politesse qui s’en va. Les enfants ne s’en plaignent pas. La politesse n’est pas la moindre chaîne dont notre formalisme charge les tendres épaules de la toute petite enfance. À peine un bébé commence-t-il à articuler, qu’on lui inflige le supplice du mot « merci ».
Souvent il ne peut encore le prononcer ; n’importe, il n’aura le gateau qu’en échange du mot fatidique ! Il ne se souvient pas, il pleure, on le menace, on le frappe et c’est en sanglotant que le pauvre petit crie « merci » ! Cette scène pénible et fréquente restitue au mot « merci » son sens primitif : « Grâce, miséricorde ! »
Hanté par de tels souvenirs, l’enfant qui grandit déteste la politesse.
J’ai un élève de douze ans, intelligent et sentimental, qui se refuse à dire « bonjour », non seulement aux indifférents mais à sa famille qu’il, aime. Reproches, prières, vexations, punitions, coups, depuis des années tout l’arsenal de l’autorité s’est émoussé contre son aversion tenace. Un antre gamin, fils d’un de nos amis, avait l’horreur des souhaits de nouvel an.
Chaque premier janvier, c’était, de sa part, une invention nouvelle pour en éviter la corvée ; une fois, préférant jeûner, il resta au lit jusqu’à trois heures de l’après-midi ; l’année suivante, il se cacha dans une malle.
Les enfants nerveux, volontaires, doués de personnalité, sont les plus réfractaires à la politesse de commande.
Maints camarades ont hérité des anciens « nihilistes » le dégoût de la politesse bourgeoise, vernis trompeur, et laissent croître leurs enfants sans les habituer à aucune forme de politesse.
C’est une erreur, à mon avis.
La politesse traditionnelle est vraiment haïssable, parce qu’elle est codifiée, raide, hypocrite. Il est juste qu’elle soit bannie de nos rapports. Mais la poignée de mains sincère, sera toujours sans prix.
La « civilité » bourgeoise est cocasse. Elle prétend régler les moindres circonstances de la vie : qui doit passer le premier dans l’escalier ? qui s’incliner ? qui se lever ? ― Camarades ouvriers, vous n’avez pas idée de la foule de minuties auxquelles s’astreignent., en pestant intérieurement, bourgeois et bourgeoises ; c’est abrutissant pour leurs gosses ; c’est si compliqué que les plus « qualifiés » s’y perdent ; et ces dames et demoiselles, en visite, controversent des heures sur le point de savoir si les droits de préséance étaient observés ou violés au cortège nuptial des X.-Y. — « Mlle Z. c’est la mode américaine ! mais est-ce que pour une jeune fille française…?» Les journaux de modes qui pullulent, ont une rubrique des usages mondains, très goûtée des lectrices.
Le type qui la signe « Baronne de X…», est parfois un bohème, un littérateur besogneux, qui l’écrit en fumant sa vieille pipe, et rigolant, in petto des raffinements de politesse « Vieille France » qu’il conseille à ses « charmantes lectrices », notairesses ou filles de sergots.
« Vieille France ». Car le nationalisme s’en mêle. Les pauvres femmes, dont le journal de modes constitue la pâture intellectuelle du dimanche, se contraignent à toutes sortes de comédies ennuyeuses et puériles parce que, ce faisant, elles perpétuent « la pure tradition, la vieille politesse française » !
Et le plus triste, c’est que cette absurde politesse déteint sur le peuple : la petite bourgeoisie singe la grande, la dépasse même en formalisme ; l’employée, l’ouvrière, se font gloire de répéter les mêmes simagrées.
À ce décor vide et trompeur, opposons une politesse populaire, une politesse cordiale, la sociabilité des travailleurs.
Celle-là ne se compose pas de gestes rituels ; pas de pantomime, rien pour le cinéma. Pas de saluts profonds et coups de chapeau, baise-mains, grimaces aristocratiques, dislocations de pantin ; cette imitation des oisifs, classe déchue, est pénible et ridicule chez le travailleur.
Simplement, des manières affectueuses, des prévenances fraternelles, qui adoucissent les frottements inévitables de la vie en commun.
Mais j’insiste pour que ce minimum soit obtenu des enfants.
Rien de plus déplaisant pour un camarade, que de pénétrer dans un intérieur où les adultes sont aimables, agréables à vivre, mais les enfants parfaitement maussades et insupportables, sous prétexte de liberté.
Il faut leur inculquer un minimum de politesse, mais comment ?
Ce n’est pas à l’âge de deux ou trois ans, que l’enfant importun ou rageur devra entendre un beau cours d’éducation du cœur ! Règle générale, il suffit d’opposer le calme et la dignité aux exigences tyranniques du cher petit ; s’il trépigne, hurle, ou grinche des heures, le traiter en malade.
Car la liberté du petit être ne saurait impliquer l’esclavage des parents.
Ceux-ci, bien souvent rongés de soucis, fatigués ou souffrants, doivent s’imposer une discipline volontaire pour rester polis avec leurs proches. Sinon, la vie en commun serait intenable, même dans une société meilleure.
Politesse est caresse.
Habituons nos enfants à la vraie politesse ; ne leur enseignons pas des règles immuables, mais apprenons-leur à raisonner la politesse, à la sentir, à la deviner : le jeune bourgeois cède sa place en wagon, à toute femme, pourquoi ? Question de sexe!! Que notre fils cède la sienne à la maman chargée de son poupon, et laisse debout la pérore portant son chien-chien ; que la jeune fille forte et fraîche se lève pour le vieil ouvrier ; au diable les usages étriqués et rigides ! vive la politesse du peuple, sans prétention, mais affectueuse et sincère !
Eugénie Casteu